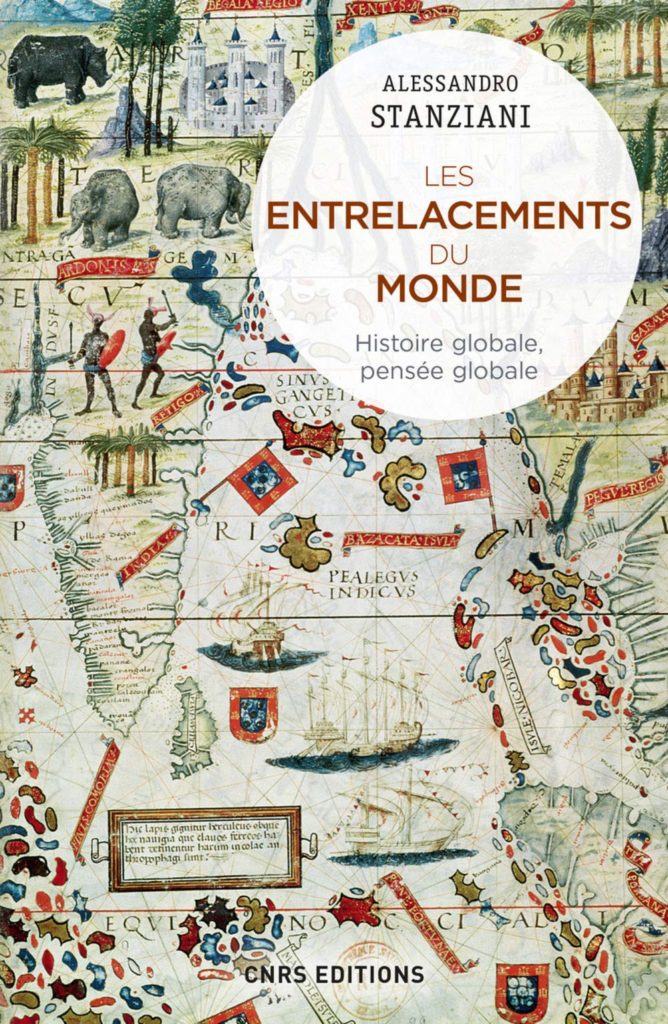Tribune libre
Sur une Terre désormais interconnectée et interdépendante, l’histoire à la française est trop souvent assimilée au micro-, à l’analyse détaillée d’archives nationales et à la biographie des grands hommes… Des méthodologies inappropriées à l’échelle du monde. Ignorant la longue durée chère à Fernand Braudel, elles n’autorisent pas à travailler sur des phénomènes aussi complexes, massifs et transfrontaliers que le présent réchauffement planétaire. Pour cela, il faudra des histoires fondamentalement transdisciplinaires : globales, mondiales, environnementales…
NB : le présent article a été rédigé en décembre 2016, et non publié. Je le reproduis ici en version légèrement actualisée, en introduction à la publication de mon dernier ouvrage : La Nouvelle Histoire du Monde, Sciences Humaines Éditions, 2019.
 La planète se réchauffe. L’humanité altère profondément les écosystèmes. Et il ne se passe pas de jour sans qu’une angoissante nouvelle de plus se fraie un chemin dans notre cerveau. On pourrait croire que l’histoire de manifestations antérieures de ces phénomènes est bien explorée, et que nous pouvons en tirer des conclusions. Que des historiens ont depuis longtemps analysé les impacts des variations climatiques, éruptions volcaniques, famines et épidémies sur les civilisations du passé, que tout est dit à ce sujet, et que les décideurs peuvent s’appuyer sur ce savoir pour prendre des décisions correctement informées sur la façon dont les sociétés et les individus ont pu réagir face à des imprévus de cette sorte.
La planète se réchauffe. L’humanité altère profondément les écosystèmes. Et il ne se passe pas de jour sans qu’une angoissante nouvelle de plus se fraie un chemin dans notre cerveau. On pourrait croire que l’histoire de manifestations antérieures de ces phénomènes est bien explorée, et que nous pouvons en tirer des conclusions. Que des historiens ont depuis longtemps analysé les impacts des variations climatiques, éruptions volcaniques, famines et épidémies sur les civilisations du passé, que tout est dit à ce sujet, et que les décideurs peuvent s’appuyer sur ce savoir pour prendre des décisions correctement informées sur la façon dont les sociétés et les individus ont pu réagir face à des imprévus de cette sorte.
Et il n’en est rien (ou presque).
Oui, bien sûr, Emmanuel Le Roy Ladurie a eu l’immense mérite de défricher certains pans de l’histoire du climat. Quelques historiens[1], souvent jeunes, explorent depuis quelques années ce champ environnemental à nouveaux frais. Mais la vérité, c’est que le monde francophone a un demi-siècle de retard sur la production de ce type de savoir, par rapport à l’anglo-saxon. Et que jusqu’il y a peu, nous n’avions pas même de méthode structurée pour appréhender historiquement le global, le mondial, la complexité.
La Global History est une discipline développée aux États-Unis depuis une cinquantaine d’années, visant à élargir les horizons de l’histoire. Je m’emploie depuis 2005 à populariser ses acquis dans la francophonie, de concert avec quelques universitaires, au premier rang desquels figurent le regretté économiste Philippe Norel, le géohistorien Vincent Capdepuy et l’historien Alessandro Stanziani. Je vais me hasarder à définir l’histoire globale en termes opérationnels[2] : l’histoire globale est une méthode, qui explore le champ de l’histoire mondiale. Cette histoire mondiale est composée de l’ensemble des passés de l’humanité, de ses débuts balbutiants en Afrique voici trois millions d’années à la globalisation contemporaine. L’histoire globale est l’outil qui permet de produire cette histoire mondiale. C’est un outil vivant, dont je dis souvent qu’il est animé par quatre brins d’ADN :
1) L’histoire globale est une approche transdisciplinaire : elle associe à parts égales les autres disciplines des sciences humaines, telles l’économie, la démographie, l’archéologie, la géographie, l’anthropologie, la philosophie, les sciences de la société, ainsi que la biologie dans sa dimension évolutionniste, et les sciences de l’environnement.
2) L’histoire globale analyse le passé sur la longue durée.
3) L’histoire globale porte ses regards sur les grandes distances.
4) L’histoire globale joue sur les échelles, temporelles comme spatiales. Elle restitue un récit qui ouvre grand des fenêtres sur l’histoire du genre humain, mettant par exemple la focale sur une anecdote biographique, avant de s’ouvrir aux dimensions globales de cet événement : un paysan perd sa récolte en 1307 ? Serait-ce parce que la planète subit un coup de froid ? Quelle en est la cause ? Et que nous enseigne ce trouble météorologique quant aux conséquences possibles du présent réchauffement climatique ?
Respecter ces quatre règles permet aussi de satisfaire un objectif annexe : éviter le péché mignon de l’histoire, sa tendance à l’eurocentrisme. L’histoire en tant que discipline académique s’est constituée au 19e siècle, un moment où l’Europe dominait le Monde. Il allait alors de soi que des nations d’hommes blancs dictaient leur loi à tous les autres, les femmes comme les peuples de couleur. Cet impensé de l’histoire a marqué jusqu’à notre langue, notre vision du passé. Et il imprègne profondément nombre de débats actuels, qu’ils tournent autour du féminisme, de l’héritage colonial, des postulats économiques ou énergétiques.
La conséquence immédiate, c’est que nous restons aveugles à ces influences, que nous considérons implicitement comme allant de soi. En premier lieu parce que nous envisageons l’histoire à trop petite échelle. Si le recours intensif à l’archive est indispensable pour ciseler les briques qui permettent de construire une grande histoire, il ne fait pas sens à grande échelle. Oui, bien sûr, il est loisible de citer des exceptions. Quelques historiens polyglottes, capables d’interroger les documents en de multiples langues, tels Sanjay Subrahmanyam ou Romain Bertrand[3], peuvent ponctuellement produire de très instructives « histoires connectées » sur la longue distance, mais ils se voient contraints d’abandonner la longue durée. Leurs fresques décrivent un monde en connexion saisi dans un moment précis, celui de sa genèse moderne aux 16e-17e siècles[4]. D’autres, comme Patrick Boucheron, Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre, ou Georges Jehel autrefois, Romain Bertrand dernièrement, peuvent coordonner de grandes productions collectives d’histoire comparée, mettant en perspective une histoire sur la longue durée[5] ou sur la grande distance[6], élargissant considérablement les échelles auxquelles il est possible de penser le passé[7]. Mais cela ne suffira pas. Car ces entreprises polyphoniques, pour pertinentes et séminales qu’elles soient, ne sauraient permettre de dresser aisément la synthèse des savoirs qu’elles brassent.
Faute d’accepter une véritable histoire transdisciplinaire, associant à « parts égales » (selon la belle formule de Romain Bertrand) toutes les disciplines pertinentes des sciences humaines, l’histoire globale/mondiale se condamne à végéter en France. Quand d’aventure quelques best-sellers de la Global History du monde anglo-saxon sont traduits en français, leurs ventes démontrent un engouement latent du public pour ce type d’histoire – il suffit de penser au succès de Sapiens, de Yuval N. Harari[8], livre qui se serait écoulé à plus de 600 000 exemplaires sur le seul marché hexagonal. Reste que les historiens authentiquement « globaux » qui travaillent depuis la France, faute de trouver éditeur, sont parfois contraints de publier directement en anglais. L’histoire globale, francophone, à la française, est très souvent produite, paradoxalement, par des non-historiens : géographes, économistes, anthropologues, politistes, démographes, archéologues, journalistes… Pour l’essentiel, les historiens français, faute d’accepter les nouvelles méthodes, restent aujourd’hui démunis pour produire ce type de réflexion, à quelques rares exceptions près[9]. Parce que l’histoire académique se fait quasi exclusivement par l’étude directe des sources, des archives. Un prérequis qui n’autorise guère les historiens à s’éloigner de leur champ de compétence, borné par des limites linguistiques, géographiques, culturelles et temporelles. L’histoire globale, sur la longue durée, leur reste inaccessible tant qu’ils restent enchaînés aux archives, sauf formes narratives spécifiques[10].
Les historiens anglo-saxons ont défini deux méthodes pour éviter de drosser le navire de l’histoire globale sur l’écueil des archives, et livrer leur cargaison d’histoires mondiales cohérentes : la compilation de seconde main, par un auteur isolé, des ouvrages relatifs à son objet d’intérêt[11] ; la contribution de grandes équipes de spécialistes, autour d’œuvres similaires[12]. En une démarche de journaliste désireux de relayer cette approche globale, j’ai testé les deux méthodes. Après avoir travaillé l’approche collective[13], je me suis essayé à la seconde depuis 2014, date à laquelle j’ai produit, pour le compte du magazine Sciences Humaines, une histoire mondiale, sous forme d’un épais hors-série exposant les travaux anglo-saxons de World/Global History[14]. Cette synthèse, la première du genre à être publiée en français, a accru ma prise de conscience de l’importance jouée par le milieu naturel dans l’histoire humaine et débouché sur la rédaction de Cataclysmes. Une histoire environnementale de l’humanité.
Faisons d’emblée un sort aux accusations de déterminisme souvent portées à l’encontre de ce type d’histoire large, accusations d’autant plus injustes que la méthodologie globale permet de bien mieux appréhender l’importance des choix sociétaux et individuels dans les bifurcations de l’histoire. Mais posons aussi une évidence ; si l’humanité est bien actrice de son histoire, le théâtre en reste l’environnement. Le milieu dicte les possibles, ne serait-ce qu’en conditionnant les possibilités de production de nourriture.
Il s’ensuit de ce qui précède que seules des histoires environnementales globales permettront à l’humanité de déconstruire les grands récits qui la mènent aujourd’hui au désastre, que ce soit le conte d’une croissance économique sans fin qui apporterait le confort à tous, ou le mythe d’un réchauffement climatique que des accords internationaux et des pratiques de greenwashing suffiraient à contenir dans des limites acceptables. À compiler les œuvres d’histoires environnementales disponibles, émerge à mon sens un pénible constat : l’humanité livre depuis longtemps, pour sa survie puis pour son confort, une guerre à la nature. Cette guerre a commencé avec les premiers outils lithiques, lorsque des hominidés ont dépecé des bovidés dans la savane africaine voici 3,3 millions d’années. Elle était alors de basse intensité, pouvant ponctuellement mener à l’extinction de certaines espèces animales. De fil en aiguille, nous en sommes venus à livrer aujourd’hui une guerre de haute intensité à la nature. Et nous en risquons d’en payer le prix avant la fin du 21e siècle, avec l’épuisement des ressources, l’intensification des frustrations géopolitiques et des inégalités économiques, et le coût croissant des pollutions, tous phénomènes induisant une forte probabilité d’effondrement civilisationnel. Cette trajectoire dangereuse a une histoire longue et complexe, qu’il importe d’étudier d’urgence avec une méthodologie appropriée, pour en déconstruire minutieusement les mécanismes afin de s’efforcer d’en prévenir les effets. Concluons sur une évidence : une telle analyse ne se fera qu’en pensant global.
Laurent Testot
Journaliste et conférencier indépendant spécialisé en histoire mondiale/globale, il a dirigé de nombreux ouvrages, notamment Histoire globale. Un nouveau regard sur le monde (Sciences Humaines Édition, 2008, rééd. 2015). Il est l’auteur de Cataclysmes. Une histoire environnementale de l’humanité (Payot, 2017, rééd. « Poche » 2018, prix Léon de Rose 2018 de l’Académie française) ; Homo Canis. Une histoire des chiens et de l’humanité (Payot, 2019) ; La Nouvelle Histoire du Monde (Sciences Humaines Éditions, 2019).
Notes
[1]Notamment QUENET Gregory, Qu’est-ce que l’histoire environnementale ?, Seyssel, Champ Vallon, 2014 ; MATHIS Charles-François, MOUHOT Jean-François, Une protection de l’environnement à la française ? (XIXe-XXe siècle), Seyssel, Champ Vallon, 2013 ; JARRIGE François, LE ROUX Thomas, La Contamination du monde. Une histoire des pollutions à l’âge industriel, Paris, Seuil, 2017 ; BONNEUIL Christophe, FRESSOZ Jean-Baptiste, L’Événement Anthropocène. La Terre, l’histoire et nous, Paris, Seuil, 2013 ; MOUTHON Fabrice, Le Sourire de Prométhée. L’Homme et la nature, Paris, La Découverte, 2017…
[2]Pour l’exposé des approches méthodologiques, je renvoie le lecteur intéressé à TESTOT Laurent (dir.), L’Histoire globale. Un nouveau regard sur le Monde, Auxerre, Sciences Humaines Éditions, 2008, rééd. 2015, ainsi qu’à STANZIANI Alessandro, Les Entrelacements du monde. Histoire globale, pensée globale (XVIe-XXIe siècles), Paris, CNRS Éditions, 2018.
[3]BERTRAND Romain, L’Histoire à parts égales. Récits d’une rencontre Orient-Occident, Paris, Seuil, 2011 ; SUBRAHMANYAM Sanjay, L’Éléphant, le Canon et le Pinceau. Histoires connectées des cours d’Europe et d’Asie, 1500-1750, traduit de l’anglais par Béatrice Commengé, Paris, Alma Éditeur, 2016.
[4]Noter aussi, pour le 19e siècle, la traduction de OSTERHAMMEL Jürgen, La Transformation du monde. Une histoire globale du XIXe siècle, traduit de l’allemand par Hugues Van Besien, Paris, Nouveau Monde Éditions, 2017.
[5]BOUCHERON Patrick et al. (dir.), Histoire mondiale de la France, Seuil, 2017.
[6]SINGARAVÉLOU Pierre, VENAYRE Sylvain et al. (dir.), Histoire du monde du XIXe siècle, Seuil, 2017 ; BOUCHERON Patrick (dir.), Une histoire du monde au XVe siècle, Paris, Fayard, 2009.
[7]JEHEL Georges (dir.), Histoire du monde. 500, 1000, 1500, Nantes, Éditions du Temps, 2007 ; un livre précurseur qui réussit quant à lui à allier les deux dimensions d’analyse, dans le temps long et l’espace mondial ; une démarche également entreprise avec bonheur par BERTRAND Romain (dir.) et ses cocoordinateurs, L’Exploration du monde. Une autre histoire des grandes découvertes, Paris, Seuil, 2019.
[8]En sus de HARARI Yuval Noah, Sapiens. Une brève histoire de l’humanité, 2011, traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Albin Michel, 2015, se sont aussi distingués les travaux de DIAMOND Jared, De l’inégalité parmi les sociétés. Essai sur l’homme et l’environnement dans l’histoire, 1997, traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Gallimard, 2000, rééd. 2007 ; et de MORRIS Ian, Pourquoi l’Occident domine le monde… Pour l’instant. Les modèles du passé et ce qu’ils révèlent sur l’avenir, 2010, traduit de l’anglais par Jean Pouvelle, Paris, L’Arche, 2011.
[9]On songe ici à GRUZINSKI Serge, L’Aigle et le Dragon. Démesure européenne et mondialisation au XVIe siècle, Paris, Fayard, 2012 ; BEAUJARD Philippe, Les Mondes de l’océan Indien, 2 tomes, Armand Colin, 2012 ; PÉTRÉ-GRENOUILLEAU Olivier, Traites négrières. Essai d’histoire globale, Paris, Gallimard, 2004 ; GRATALOUP Christian, Géohistoire de la mondialisation. Le temps long du monde, Paris, Armand Colin, 2007 ; STANZIANI Alessandro, Bâtisseurs d’empires. Russie, Chine et Inde à la croisée des mondes, XVe-XIXe siècle, Paris, Raisons d’agir, 2012. De ce dernier auteur, en sus de son ouvrage (op. cit.), on lira avec profit son article « Pour une approche véritablement globale de l’histoire ».
[10]On pense ici à la micro-histoire globale, expérimentée avec bonheur par CAPDEPUY Vincent dans 50 histoires de mondialisation. De Neandertal à Wikipédia, Paris, Alma, 2018.
[11]Ce qu’a fait HARARI Yuval N., op. cit., et de manière tout aussi convaincante, McNEILL William H., McNEILL John R., The Human Web. A Bird’s-Eye View of World History, New York/Londres, W.W. Norton & Company, 2003.
[12]TIGNOR Robert et al. (dir.), Worlds Together, Worlds Apart, New York, W.W. Norton & Company, 4e éd. 2014.
[13]Pour les démarches collectives, voir notamment NOREL Philippe, TESTOT Laurent (dir.), Une histoire du monde global, Auxerre, Sciences Humaines Éditions, 2012 ; HOLEINDRE Jean-Vincent, TESTOT Laurent (dir.), La Guerre. Des origines à nos jours, Auxerre, Sciences Humaines Éditions, 2014 ; DORTIER Jean-François, TESTOT Laurent (dir.), Les Religions. Des origines au IIIe millénaire, Auxerre, Sciences Humaines Éditions, 2017.
[14]TESTOT Laurent, « La nouvelle histoire du Monde », Sciences Humaines Histoire, n° 3, décembre 2014-janvier 2015, rééditée en octobre-novembre 2017.