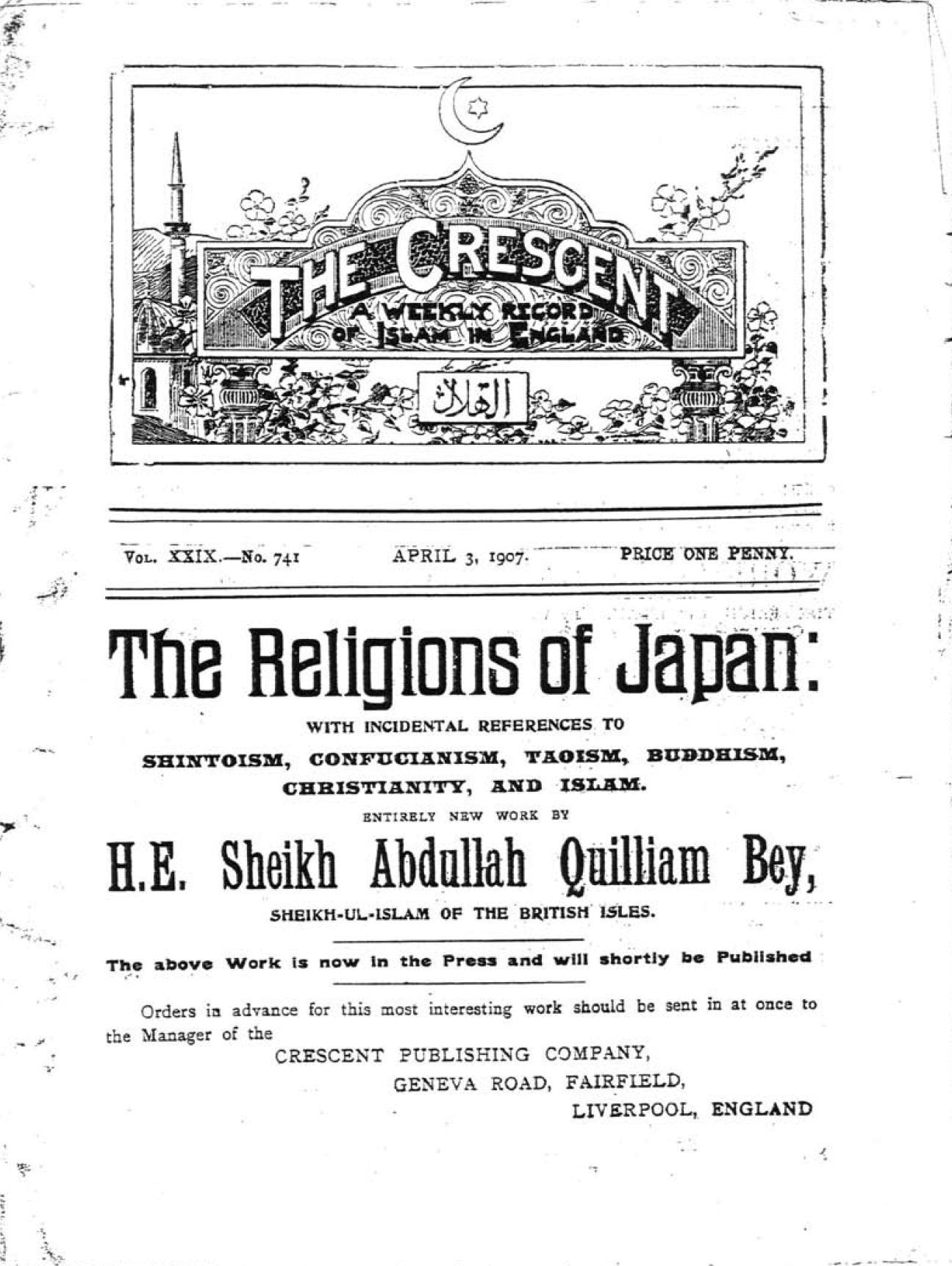Nous entamons, avec ce papier, une série de relectures de ce qu’on pourrait appeler les « grands classiques » de l’histoire globale. L’idée est d’abord de fournir à nos lecteurs une vision à la fois synthétique et vivante des grandes œuvres qui ont fondé ou marqué cette approche. Mais il ne s’agira pas pour autant de fiches de lecture traditionnelles, comme ce blog peut en fournir régulièrement à propos d’ouvrages nouvellement parus. Le but est bien aussi de relire ces travaux importants avec un recul de dix, trente ou cinquante ans, afin de voir comment ils ont « vieilli », leurs approximations éventuelles en regard de l’information désormais disponible, leurs limites en termes méthodologiques au vu des débats ultérieurs, leurs hypothèses parfois implicites et qui se révèlent mieux aujourd’hui… Bref, il s’agira dans cette rubrique « Relectures » de faire un état des lieux sur ce qu’on doit retenir d’œuvres fondamentales ou de livres ayant acquis le statut de travaux majeurs.
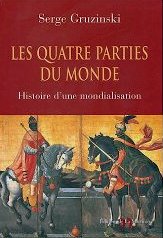 Nous commençons avec un livre étonnant, d’une grande érudition, toujours analytique, et qui s’est vite imposé comme un ouvrage phare en analyse historique des mondialisations. En écrivant Les Quatre Parties du monde. Histoire d’une mondialisation, en 2004, Serge Gruzinski a non seulement remarquablement « décrit » la mondialisation ibérique des années 1580-1640 mais encore approfondi les concepts cruciaux de métissage, occidentalisation, mondialisation. Certes, il se réclame d’emblée de l’histoire connectée, de l’étude des rencontres et des « recouvrements de civilisations ». Mais c’est pour rappeler immédiatement qu’une « histoire culturelle décentrée, attentive au degré de perméabilité des mondes et aux croisements de civilisations (…) ne prend tout son sens que dans un cadre plus vaste capable d’expliquer, au-delà des ‘histoires partagées’, comment et à quel prix les mondes s’articulent ». Et de fait, l’un des apports centraux de l’ouvrage est bien de construire ces articulations entre l’Europe, le Nouveau Monde, l’Asie et l’Afrique en précisant les multiples circulations, humaines, marchandes et informationnelles qui font cette première mondialisation. En ce sens, c’est bien aussi un livre centré sur les interconnexions au sein d’un Monde en gestation, donc préoccupé de cerner ce qui constitue du lien social entre ses composantes éloignées.
Nous commençons avec un livre étonnant, d’une grande érudition, toujours analytique, et qui s’est vite imposé comme un ouvrage phare en analyse historique des mondialisations. En écrivant Les Quatre Parties du monde. Histoire d’une mondialisation, en 2004, Serge Gruzinski a non seulement remarquablement « décrit » la mondialisation ibérique des années 1580-1640 mais encore approfondi les concepts cruciaux de métissage, occidentalisation, mondialisation. Certes, il se réclame d’emblée de l’histoire connectée, de l’étude des rencontres et des « recouvrements de civilisations ». Mais c’est pour rappeler immédiatement qu’une « histoire culturelle décentrée, attentive au degré de perméabilité des mondes et aux croisements de civilisations (…) ne prend tout son sens que dans un cadre plus vaste capable d’expliquer, au-delà des ‘histoires partagées’, comment et à quel prix les mondes s’articulent ». Et de fait, l’un des apports centraux de l’ouvrage est bien de construire ces articulations entre l’Europe, le Nouveau Monde, l’Asie et l’Afrique en précisant les multiples circulations, humaines, marchandes et informationnelles qui font cette première mondialisation. En ce sens, c’est bien aussi un livre centré sur les interconnexions au sein d’un Monde en gestation, donc préoccupé de cerner ce qui constitue du lien social entre ses composantes éloignées.
Le livre s’ouvre sur ce constat intrigant : l’assassinat d’Henri IV a bel et bien été commenté à Mexico, en septembre 1610, par Chimalpahin, religieux indigène d’ascendance noble chalca, dans le journal qu’il tenait. Et c’est son regard, distancié à la fois de la culture hispanique officielle et de son passé indigène, qui intéresse Gruzinski dans la mesure où il relève d’une certaine modernité, laquelle « ferait affleurer un état d’esprit, une sensibilité, un savoir sur le monde né de la confrontation d’une domination à visée planétaire avec d’autres sociétés ». Par ailleurs, Chimalpahin se préoccupe autant sinon plus de l’Asie que de l’Europe, l’ouverture de la route Pacifique vers Manille ayant multiplié les contacts avec des Philippins, Chinois ou Japonais, lesquels viennent métisser davantage un imaginaire amérindien non exclusivement confronté à celui de l’envahisseur ibérique. Il vit de fait dans un « agglomérat planétaire (incluant une bonne partie de l’Europe occidentale, les Amériques espagnole et portugaise de la Californie à la terre de Feu, les côtes de l’Afrique occidentale, des régions de l’Inde et du Japon, des océans et des mers lointaines) qui se présente d’abord comme une construction dynastique, politique et idéologique ». Et l’objet du livre peut alors se définir comme une interrogation sur « la prolifération des métissages – mais aussi de leurs limitations – dans des sociétés soumises à une domination aux ambitions universelles ». Ici se marque d’emblée une dialectique essentielle de l’ouvrage, entre une occidentalisation qui pousse à une acculturation sous des formes nécessairement métissées d’une part, et une visée de domination mondiale, par ailleurs sous l’autorité d’une hiérarchie catholique très prégnante, qui fixe les limites à ne pas dépasser (en l’occurrence la relativisation de l’idéologie européenne par les savoirs indigènes ou métissés) d’autre part.
La première partie du livre (pp. 15-84) décrit alors cette « mobilisation ibérique » qui « déclenche des mouvements et des emballements qui se précipitent les uns les autres sur tout le globe » jusqu’aux microbes échappant à l’emprise des hommes… Elle se caractérise d’abord par la multiplication des institutions ibériques hors d’Europe, lesquelles sont évidemment porteuses de lien social. Mais c’est aussi le mouvement des hommes, certains membres de l’élite faisant plusieurs tours du monde durant leur vie tandis que d’autres multiplient les allées et venues entre colonies et métropoles et que des indigènes devenus riches n’hésitent pas à faire le voyage espagnol. Cette mobilisation débouche aussi sur un commerce désormais planétaire, notamment d’objets de curiosité que l’auteur se plaît à étudier au détriment des flux de métaux précieux (sans doute mieux connus). L’information n’est pas en reste, les nouvelles circulant entre l’Est et l’Ouest dès la première moitié du 16e siècle. Les livres font de même, s’exportant ou voyageant avec les lecteurs, pour finir imprimés à Mexico, Manille, Goa, Macao ou Nagasaki, souvent pour soutenir les campagnes d’évangélisation en langue locale, parfois pour diffuser en retour vers l’Europe les savoirs indigènes relatifs aux vertus de plantes exotiques. La mobilisation ibérique n’est donc pas à sens unique.
C’est plus à l’analyse des métissages que se consacre la deuxième partie (pp. 87-175). On y apprend d’emblée que les techniques artisanales ibériques sont vite diffusées (souvent par des religieux) auprès des indigènes au point que ces derniers en viennent à concurrencer à moindre coût les artisans espagnols, avant d’être repris sous le joug de patrons exploiteurs. On y documente aussi les métissages linguistiques. Les Européens apprennent des rudiments de langues locales tandis que ces dernières s’enrichissent de termes locaux inédits pour qualifier les « nouveautés » importées. Il n’empêche, ce sont les termes ibériques eux-mêmes qui seront finalement adoptés : « L’hispanisation de la langue est une des formes de la mobilisation ibérique (…) et donne lieu à quantité d’appropriations ou de détournements. » Le métissage est aussi humain, permettant tous les mélanges entre Européens, indigènes, Noirs et Asiatiques, aboutissant à créer une plèbe dont l’habitat et le statut sont éminemment mobiles et effraient les pouvoirs institués. En conséquence, ces individus sans métier ou résidence claire sont, à partir de 1622, déportables vers les Philippines, permettant en principe à la Monarchie catholique de « régler ses questions sociales à l’échelle planétaire ». Car fondamentalement, l’ouverture de la route entre Acapulco et Manille a non seulement accru les métissages humains mais encore créé une seconde route vers l’Asie dès 1566, à une époque où la route portugaise est en principe interdite aux Espagnols. À partir de là, Mexico devient une étape vers l’Asie pour ces voyageurs débarquant à Vera Cruz et repartant d’Acapulco. Elle devient aussi métropole planétaire, en position plus centrale, tourne son regard autant vers l’ouest que vers l’est, substituant une vision désormais « occidentale » à la vision européenne du monde. Et les élites indigènes ne sont pas en reste, revendiquant leur rôle dans la formation de ce « Nouveau Monde » pour lequel elles ont abandonné leurs idoles, partageant parfois « la haine du juif et de l’hérétique » ou encore « participant à leur manière du rêve asiatique quand elles saluent Philippe II du titre anticipé de roi de la Chine ». Un imaginaire commun se forge donc. Plus généralement, accumulant anecdotes révélatrices et faits objectifs, Gruzinski est clairement en position d’affirmer que, « par-delà la cohorte coutumière des préjugés, des peurs, des haines et des attirances, la mobilité des hommes et des choses déclenche toutes sortes d’échanges, matériels aussi bien qu’affectifs, qui à force de se reproduire tissent des trames planétaires où vient s’enraciner la mondialisation ibérique ».
La plus longue de toutes, la troisième partie (pp. 179-311) s’intéresse davantage aux outils des savoirs et pouvoirs qui émergent dans la mondialisation ibérique. Et il s’agit d’abord là de rendre leur dû à de nombreux individus engagés « dans une entreprise sans précédent et partout répétée : confronter des croyances, des langues, des mémoires, des savoirs jusque-là inconnus avec ce que pensaient et croyaient connaître les Européens ». Pour ces praticiens ou experts, souvent liés à la Couronne ou travaillant à sa demande, co-existent un objectif de « sauvetage archéologique » et une finalité de « dénonciation de l’idolâtrie ». De ce fait, leur proximité avec l’indigène, leur valorisation des savoirs locaux ne fait jamais oublier qu’il s’agit avant tout de rendre conformes des mentalités (et pour cela mieux en connaître les ressorts). Et de fait, Bernardino de Sahagún ou Diego Durán redonnent une mémoire à ces nouvelles chrétientés tout en consolidant la domination de l’Église. Parfois au risque d’une mise à l’index ou d’un gel des enquêtes… Toujours au péril d’un décentrement des savoirs, d’une inversion des points de vue, voire d’une remise en cause de la tradition européenne. Ainsi en va-t-il des connaissances sur les plantes et les pratiques médicales : Garcia da Orta en Inde ou Francisco Hernández au Mexique montrent l’imbrication pratique des deux types de savoir, les manières américaines de guérir certains maux européens ou encore l’adoption indienne de la « théorie des humeurs ». Si bien qu’au final, « autant que la christianisation ou que l’écriture de l’histoire, l’inventaire médical du monde est un ferment de la mondialisation ibérique », réduisant l’écart entre la manière européenne de soigner et les coutumes locales. Le même type d’hybridation concerne la cartographie, les techniques de navigation ou encore celles de l’extraction minière. Quant à l’histoire des nouvelles terres, elle est au contraire l’occasion paradoxale d’une application des façons de voir héritées de l’Antiquité, des pères de l’Église ou de la renaissance italienne, phénomène qui contribuera par ailleurs à diffuser les œuvres des auteurs anciens dans l’espace mondial ibérique. Mais de toutes parts il s’agit bien d’« introduire ces peuples dans le savoir européen, rattacher ce que l’on sait d’eux au monde tel que le conçoivent les Ibériques, connecter les mémoires, apprivoiser le neuf et l’inconnu, désamorcer l’étrange pour le rendre familier et subjugable ». Et peut-être aussi esquisser les linéaments d’une histoire globale comme chez Diogo do Couto lorsqu’il nous explique que « parce que les Chinois ont découvert les îles aux épices, ce sont eux qui furent à l’origine du grand commerce entre Rome et l’Asie ». En revanche, sur la question religieuse, aucun syncrétisme ni même d’influence mutuelle n’est évidemment tolérable même si Las Casas réalise, dès le milieu du 16e siècle, « un étonnant parcours encyclopédique des religions du globe ». En clair, le rejet n’empêche nullement l’étude exhaustive et le paganisme n’est pas nécessairement un marqueur de sauvagerie comme le montre l’étude du Japon, de la Chine ou de l’Amérique préhispanique… Cette partie se boucle sur la narration de plusieurs histoires individuelles retraçant les parcours de personnages relevant des élites mondialisées de ce siècle, religieuses ou politiques, aux destins souvent stupéfiants d’actualité.
Plus ramassée, la quatrième partie (pp. 315-440) traite des objets, de l’art, de la globalisation de la pensée et des langages. Pour ce qui est des objets, ils circulent tout autant vers les métropoles que dans le sens inverse et leur fabrication se conforme parfois à la demande du marché ibérique. Par exemple, un art manuélin de la sculpture sur ivoire se met en place en Guinée, dès la fin du 15e siècle, chez des artisans qui travaillaient jusqu’alors la pierre à savon… De leur côté les hommes d’église ne se privent pas de commander des objets de culte arborant des traits indigènes (afin de mieux enraciner le culte dans les cultures locales), déterminant un « long siècle d’art chrétien planétaire ». Souvent les objets rapportés sont détournés de leur usage initial ou entrent dans le répertoire symbolique du pouvoir royal (comme les éventails japonais). Tous « correspondent aux manifestations concrètes d’une occidentalisation du monde qui passe par le commerce, la religion, la politique, la connaissance et le goût » et qui « transforme aussi bien les êtres que les choses auxquelles elle s’applique », la main indigène s’occidentalisant pour partie tout en conservant d’importantes marges d’affirmation des talents locaux. Il est fréquent aussi qu’un objet indigène importé « soit retouché ou modifié pour en accroître le prix ou le prestige », traduisant ainsi une mainmise européenne caractérisée. Tous deviennent des objets métis, constituant le revers obligé de la mondialisation à l’œuvre, allant parfois jusqu’à mélanger mythologies grecques anciennes avec leurs homologues indiennes ou préhispaniques, ce qui interdit radicalement de « s’en tenir à la vision d’une occidentalisation réductrice et uniformisatrice ». C’est du reste dans cette partie que l’auteur étudie précisément les différences et relations entre occidentalisation et mondialisation. Ainsi, une pensée de plus en plus occidentalisée, donc aussi métissée, n’en reste pas moins corsetée par l’aristotélisme et la scolastique, comme si « la greffe du Nouveau Monde était la meilleure manière d’en réaffirmer l’universalité ». De ce fait, l’application systématique et récurrente des cadres scolastiques, leur présence dans l’homologation officielle des œuvres publiées relèverait plutôt de l’impérialisme ibérique et de son projet de domination mondiale. Ainsi, la globalisation du latin (mais aussi du castillan ou du portugais) est un phénomène qui va occidentaliser les élites tout en métissant leur langue. Mais c’est du même coup une « dilatation transcontinentale d’un espace linguistique et d’un patrimoine lettré », impliquant leur reproduction à l’identique, donc un phénomène relevant de la mondialisation. Celle-ci concerne « prioritairement l’outillage intellectuel, les codes de communication et les moyens d’expression » tandis que l’occidentalisation, « entreprise de domination des autres mondes, emprunte les voies de la colonisation, de l’acculturation et du métissage ». Mais il s’agit bien là de « deux forces concomitantes (…) indissociables l’une de l’autre, même si chacune se déploie dans des dimensions différentes et sur des échelles distinctes ».
En dépit de toutes ses qualités, ce livre n’est pas sans défaut, avec notamment un plan au final assez peu lisible et une classification des informations parfois discutable. Il est aussi souvent lourd de détails accumulés, d’anecdotes prolongées à plaisir, le plus souvent dans un but analytique précis mais qui tend à se perdre sous l’amoncellement des faits. La dimension économique y est aussi largement absente, au-delà de la description de circuits marchands importants ou des structures d’exercice de l’artisanat. Les flux d’argent vers le reste du monde, avec leurs effets locaux et dans les pays de destination, sont totalement omis. Apparemment à dessein : le « champ de l’économie » semble perçu comme un « enfermement » par l’auteur… Mais de ce fait, l’histoire de la mondialisation ibérique reste ici largement incomplète.
Sans doute pourtant l’essentiel n’est-il pas là. Il est clair en effet, avec le recul, que l’auteur ne privilégie jamais l’analyse des structures sociales et/ou économiques présidant à la mondialisation ibérique pour se focaliser sur le contact entre sociétés sous ses multiples visages. Le lien social est donc plus révélé par des signifiants particuliers – tel objet métis, tel savoir transmis, tel récit ou telle création de langage – que par des analyses objectivantes et de fait peu ouvertes au travail d’interprétation. On reconnaît là tout l’apport mais aussi les limites de l’histoire connectée. Elle nous révèle et fait partager des significations, parfois étranges et sans doute vécues par les acteurs de cette première mondialisation. Elle est donc recherche d’une certaine vérité d’un moment particulier à travers un décentrement salutaire. Elle est en revanche moins pertinente pour éclairer le changement social, dans la longue durée et à une échelle plus large, la lente création des institutions et structures qui ont façonné, peu à peu, notre propre mondialisation…
GRUZINSKI S., Les quatre parties du monde – histoire d’une mondialisation, La Martinière, 2004, réédition Points Seuil, 2006.