Seconde partie du compte rendu par Clément Broche de :
Timothy Brook, Le Léopard de Kubilai Khan : une histoire mondiale de la Chine, Paris, Payot, 2019, 544 p.
Pour la première partie, cliquez ici.
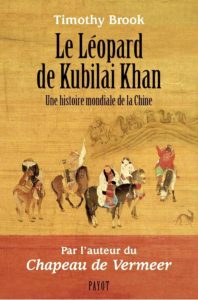
Trajectoires insolites et personnages singuliers
Si certains ont souligné que l’absence de héros qui caractérise parfois l’histoire globale limite l’adhésion du grand public à son endroit (17), le Léopard de Kubilai Khan, lui, n’en manque pas. En effet, bien que plusieurs des protagonistes de Brook soient des inconnus, d’autres figurent parmi les plus illustres de l’histoire chinoise. C’est ainsi que le grand khan mongol Kubilai, le marchand vénitien Marco Polo, le célèbre navigateur Zheng He, ou encore l’éminent jésuite italien Matteo Ricci se retrouvent tous acteurs du récit de Brook. Dans une volonté affirmée de rendre ses recherches accessibles au grand public, ce dernier prend grand soin d’écrire une histoire qui se veut la plus attractive et séduisante possible pour le néophyte. Si la démarche est louable puisqu’elle permet une large diffusion de travaux contribuant à l’écriture d’un récit de l’histoire du monde plus équilibré, cette dernière n’en reste pas moins déroutante pour l’historien. C’est là tout le paradoxe de l’ouvrage de Brook. Ce qui constitue sa principale qualité – la diffusion d’une histoire déoccidentalocentré auprès du grand public – est également sa principale faiblesse. En effet, n’y a-t-il pas un certain poncif à présenter une énième fois d’illustres personnages tels que Kubilai, Polo, Zheng ou Ricci ? Par ailleurs, l’histoire globale de Brook tombe sous le coup de la critique de certains ces collègues ayant menés ces dernières années des réflexions épistémologiques autour de ce champ de recherche et de ses difficultés.
Dans What is Global History, publié en 2016 (18), Sebastian Conrad avance l’idée qu’il faille en finir avec une histoire globale qui serait une histoire de missionnaires et de marchands. Or, c’est précisément ce que propose Brook avec Le Léopard de Kubilai Khan, qui est une histoire mondiale de la Chine à travers le portrait de missionnaires et de marchands. D’autre part, cette somme de récits et de trajectoires individuelles suffit-elle à prétendre faire une histoire mondiale de la Chine ? Là encore, comme le souligne Conrad, où sont les processus qui eux seuls peuvent sous-tendre des changements structurels. L’histoire globale de Brook est-elle véritablement de l’histoire globale ? Ne s’inscrit-elle pas plutôt finalement dans des champs connexes, mais distincts, que sont l’histoire connectée ou l’histoire transnationale ? Certes, dans une perspective qui se veut à la fois micro et macro, Brook joue avec les échelles d’analyse, passant du particulier – « l’histoire au ras du sol » de Giovanni Levi (19) – au général, interrogeant parfois les structures et rapports de pouvoirs – les relations entre le Grand État Ming et la Corée dans le chapitre 5, entre le Grand État Qing et le Tibet dans le 10. Mais cela se fait malgré tout dans des proportions limitées, la majeure partie de l’ouvrage étant consacrée à de l’histoire récit, qui par ailleurs pose certains problèmes sur la forme dans la façon dont Brook la propose.
En effet, Brook a une tendance à scénariser son récit, ce dernier apparaissant telle une scène de film à l’esprit du lecteur :
« Après avoir vérifié que les locaux de la Compagnie anglaise des Indes orientales étaient bien fermés pour la nuit, Edmund Scott gravit les marches menant à sa chambre […] il s’apprêtait à aller se coucher […] Une heure plus tard, un des neuf employés anglais placés sous sa responsabilité vint lui annoncer, hors d’haleine, que le bâtiment était en feu (20). »
De tels procédés stylistiques font parfois passer le récit de Brook pour un roman historique ou de l’histoire romanesque. Aussi, face à tant de détails si précis, le lecteur curieux s’empresse d’aller consulter les notes de l’auteur. Le corps du texte ne contenant aucun renvoi, ce dernier doit donc naviguer dans des notes reléguées à la fin du livre et présentées dans un style peu académique, puisque non numérotées. Il est ainsi difficile pour le lecteur de trouver la référence à une partie précise du texte. Outre cet aspect, Brook s’essaie également à plusieurs reprises à l’histoire contrefactuelle, comme dans le chapitre 7 où il fait parler pendant 4 pages un orfèvre chinois condamné à mort : « Voici ce que l’orfèvre aurait pu, me semble-t-il, penser, même s’il ne le dit pas (21)… » ; ou encore dans le chapitre suivant où ce ne sont là pas moins de 10 pages d’un dialogue imaginaire entre deux fonctionnaires chinois, l’un partisan de l’expulsion des jésuites et l’autre leur étant favorable : « Voici comment leur confrontation aurait pu se dérouler (22). » Là encore, de tels procédés s’avèrent déroutants.
Passé ces quelques réflexions sur la forme, la question se pose de l’efficience du concept de Grand État. Ce dernier permet-il à Brook de proposer une véritable histoire mondiale de la Chine ? S’il remplit pleinement son rôle de fil conducteur du récit, il apparait néanmoins limité sur certains aspects. Il est parfois difficile de faire la distinction entre le travail de Brook et une étude qui se voudrait plus classique, portant sur l’histoire de l’Empire chinois. Si la dimension connectée est bien là, de nombreuses parties du livre sont néanmoins consacrées aux relations avec les marges de l’espace chinois : Mongolie, Tibet, Mandchourie, Corée, Japon, nord du Viêtnam (Dai Viet). Ce constat fait apparaître le concept du Grand État comme limité pour partie. Lorsque Brook se lance dans des connexions plus lointaines, comme dans le chapitre 11 où l’exemple du navire l’Etrusco illustre parfaitement le phénomène de globalisation qui caractérise le tournant entre les 18 et 19e siècles : « Construit aux États-Unis, vendu à Calcutta, enregistré sous le nom d’un autre vaisseau, appartenant théoriquement à un Vénitien d’Istrie, arborant un pavillon toscan, commandé par un Anglais, transportant des marchandises pour des négociants de quatre nationalités au moins et financé par des créanciers de trois, sinon plus (23) », le lien direct avec le Grand État se fait plus ténu. Même constat dans le chapitre 12, où Chinois et Britanniques se rencontrent et interagissent autour de l’exploitation minière en Afrique du Sud. Alors que le cas des coolies permet de mettre véritablement l’emphase sur un phénomène s’inscrivant dans le cadre d’un processus global, on perd néanmoins le fil conducteur de Brook. Parle-t-il ici du Grand État Qing, des Chinois, des travailleurs chinois sous contrat ou du contexte politique de la Grande-Bretagne de l’époque (où Churchill et Chamberlain s’affrontent autour de la question du sort des coolies) ?
Excellent ouvrage pour tout néophyte qui souhaiterait découvrir l’histoire de la Chine par le biais novateur de l’histoire globale, Le Léopard de Kubilai Khan remplit pleinement son objectif consistant à ouvrir de nouveaux horizons au grand public. Pour l’historien en revanche, ce livre n’est pas exempt de défauts. Les problèmes posés par le livre de Brook ne relèvent en aucun cas de la question des compétences de cet éminent sinologue, mais bien du choix de la forme retenue par l’auteur, dans son souhait de proposer un ouvrage facile d’accès. Si la démarche est louable, elle n’en reste pas moins quelque peu déroutante pour l’historien. Alors que Le Chapeau de Vermeer faisait école et bousculait les codes lors de sa parution en 2008, dix ans plus tard, Le Léopard de Kubilai Khan ne semble pas destiné à avoir la même portée. Tandis que l’histoire globale se remettait en question durant la décennie 2010, Brook paraît ne pas avoir considéré certaines des réflexions épistémologiques ressorties des discussions entre historiens, y préférant sa recette de 2008, celle d’une histoire connectée destinée au grand public, une histoire de missionnaires et de marchands.
Le Grand État de Xi Jinping
« Il y a trois mille ans, le peuple de la plaine de Chine du Nord contemplait un monde de dix mille pays […]. En 2019, à l’heure où j’écris cet épilogue […], l’ONU comprend 193 États membres (24). » Dans la conclusion de son livre, Timothy Brook mène de façon fort habile une réflexion sur la Chine contemporaine : sur ses rapports à l’autre (ces 193 États membres de l’ONU), ainsi qu’à ses marges (comme du temps des Grands États Yuan, Ming et Qing) que sont la Mongolie-Intérieure, le Xinjiang, le Tibet, Hong Kong et Taiwan. La Chine d’aujourd’hui, celle de Xi Jinping, interroge. Deuxième économie du monde depuis 2010, cette dernière est plus que jamais présente à l’échelle globale, si bien que depuis le début des années 2000, après avoir vécu les décennies 1980-1990 sous l’ère du consensus de Washington, on parle désormais de consensus de Beijing (25). Dans ces deux modèles qui s’opposent, la proposition de Pékin, peu regardante quant à la question des modes de gouvernance, se montre toujours plus attractive pour de nombreux régimes à tendance autoritaire. Par ailleurs, la Chine ne cesse de redoubler d’efforts – comme avec les super projets de la Belt and Road Initiative, par la multiplication de la ratification d’accords bilatéraux ou multilatéraux, en mobilisant son soft power, ou encore en cherchant à être toujours plus influente dans les instances internationales – pour se rendre séduisante et indispensable. Ce constat amène à repenser la question des relations internationales. Apparaissant en même temps que l’écriture chinoise, il y a plus de 3 000 ans, le concept de Tianxia (26) (« tout sous un même ciel » en français) se veut une volonté chinoise de se présenter en nouvelle puissance normative et potentiel futur hégémon mondial :
« Alors que la politique internationale est incapable d’assurer la paix mondiale, le concept de Tianxia, en tant que ni occidental, ni moderne, mais traditionnellement chinois, pourrait constituer une alternative et permettre une refondation du système politique mondial qui assurerait l’harmonie durable entre les peuples […] Le Tianxia renvoie à l’élaboration d’une sphère au sein de laquelle le système politique de la République populaire est perçu non plus comme l’exception aux grandes puissances démocratiques, mais la nouvelle norme, non plus comme ce qui se situe en marge de l’histoire, mais comme l’alternative à l’Histoire (27). »
Ainsi, si nous sommes tous demain amenés à vivre sous l’ère de Tianxia, l’histoire globale nous sera plus que jamais indispensable et il nous faudra renouer avec la grande histoire mondiale de la Chine et donc nous replonger dans Le Léopard de Kubilai Khan.
Notes
(17) Christophe Charle, « Histoire globale, histoire nationale ? Comment réconcilier recherche et pédagogie », Le Débat, no 175, 2013, p. 60-68.
(18) Sebastian Conrad, What Is Global History, Princeton, Princeton University Press, 2016, 312 p. – traduit par Hélène Bourguignon, Qu’est-ce que l’histoire globale ?, Paris, Nouveau Monde Éditions, 2023, 280 p.
(19) Giovanni Levi, Le Pouvoir au village précédé de L’Histoire au ras du sol : histoire d’un exorciste dans le Piémont du XVIIe siècle, Paris, Gallimard, 1989, 276 p.
(20) T. Brook, Le Léopard de Kubilai Khan, op. cit., p. 217.
(21) Ibid., p. 250.
(22) Ibid., p. 260.
(23) Ibid., p. 355.
(24) Ibid., p. 455-456.
(25) C’est l’actuel vice-président de la Kissinger Associates, Joshua Cooper Ramo, qui théorise le consensus de Beijing en 2004 : Joshua Cooper Ramo, The Beijing Consensus, London, Foreign Policy Centre, 2004, 74 p.
(26) Le concept de Tianxia, oublié depuis l’avènement de la Révolution chinoise de 1911, a été réactualisé par le philosophe chinois Zhao Tingyang dans les années 2000 et tout de suite récupéré par les autorités dans le discours politique officiel du régime : Zhao Tingyang, Tianxia, tout sous un même ciel, Paris, Les éditions du Cerf, 2018, 323 p.
(27) Jean-Yves Heurtebise, Orientalisme, Occidentalisme et Universalisme. Histoire, analyse et méthodes des représentations européennes de la Chine, Paris, MA Éditions, 2020, pp. 205 et 230.

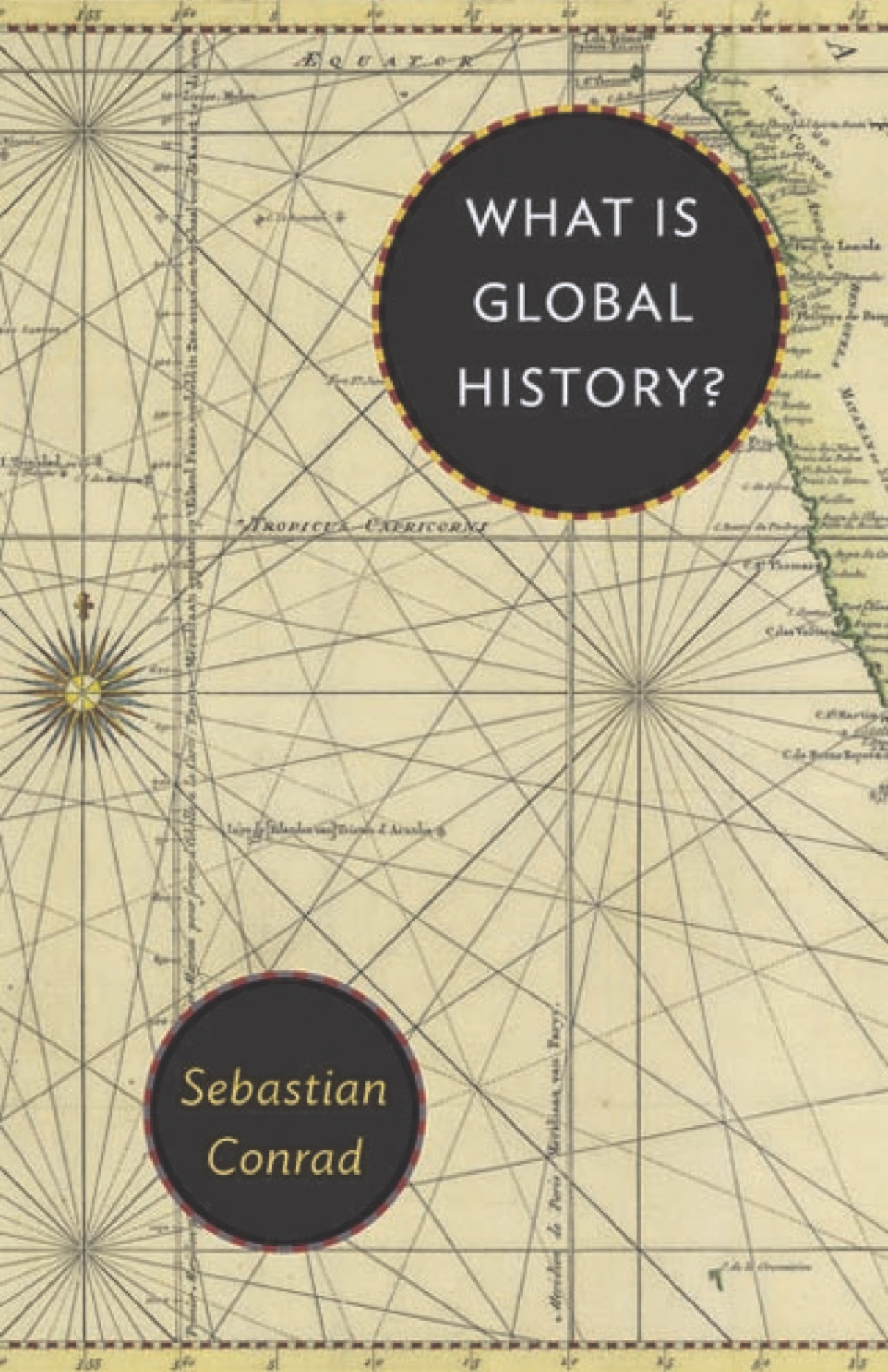


 Paul Ariès.
Paul Ariès.