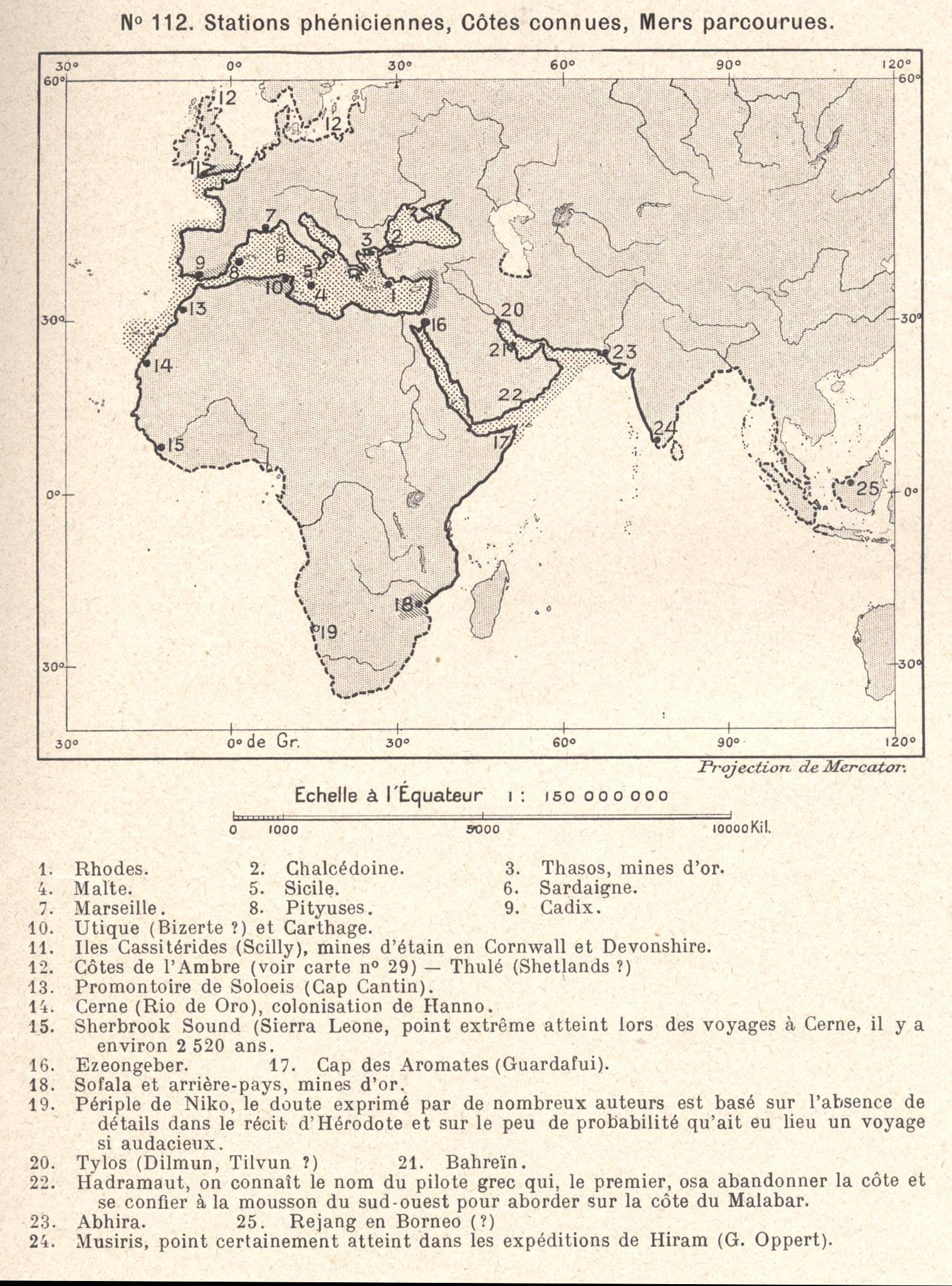Le 11 avril 1963, le pape Jean XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) publiait une encyclique sur la paix dans le Monde. Le texte n’avait en soi rien de surprenant. D’une part, la paix est une valeur fondamentale, au moins théorique, du christianisme ; d’autre part, le catholicisme est par essence universel (katholicos) : le Monde ne pouvait qu’être son horizon. De fait, le premier paragraphe inscrit l’encyclique dans la longue tradition d’un droit naturel d’origine divine :
« La paix sur la terre, objet du profond désir de l’humanité de tous les temps, ne peut se fonder ni s’affermir que dans le respect absolu de l’ordre établi par Dieu. » (§1)
Ce que les hommes, trop souvent, tendraient à oublier :
« Mais la pensée humaine commet fréquemment l’erreur de croire que les relations des individus avec leur communauté politique peuvent se régler selon les lois auxquelles obéissent les forces et les éléments irrationnels de l’univers. Alors que les normes de la conduite des hommes sont d’une autre essence : il faut les chercher là où Dieu les a inscrites, à savoir dans la nature humaine. » (§6)
Ce sont ces lois qui doivent, devraient guider les hommes :
« Ce sont elles qui indiquent clairement leur conduite aux hommes, qu’il s’agisse des rapports des individus les uns envers les autres dans la vie sociale ; des rapports entre citoyens et autorités publiques au sein de chaque communauté politique ; des rapports entre les diverses communautés politiques ; enfin des rapports entre ces dernières et la communauté mondiale, dont la création est aujourd’hui si impérieusement réclamée par les exigences du bien commun universel. » (§7)
Et voici, pour un historien du global, la raison pour laquelle un tel texte peut être considéré comme une source de l’histoire de la mondialisation, ou du moins de sa métahistoire. Avec l’encyclique Pacem in Terris, le monde, ensemble absolu des êtres humains, est clairement devenu le Monde, ensemble des hommes pris dans leurs interrelations à l’échelle du globe. Or cette unité de l’humanité globale, si elle est d’origine divine, n’en résulte pas moins d’une histoire très humaine :
« Les récents progrès de la science et de la technique ont exercé une profonde influence sur les hommes et ont déterminé chez eux, sur toute la surface de la terre, un mouvement tendant à intensifier leur collaboration et à renforcer leur union. De nos jours, les échanges de biens et d’idées, ainsi que les mouvements de populations se sont beaucoup développés. On voit se multiplier les rapports entre les citoyens, les familles et les corps intermédiaires des divers pays, ainsi que les contacts entre les gouvernants des divers États. De même la situation économique d’un pays se trouve de plus en plus dépendante de celle des autres pays. Les économies nationales se trouvent peu à peu tellement liées ensemble qu’elles finissent par constituer chacune une partie intégrante d’une unique économie mondiale. Enfin, le progrès social, l’ordre, la sécurité et la tranquillité de chaque communauté politique sont nécessairement solidaires de ceux des autres. » (§130)
C’est donc bien cette mondialisation contemporaine qui nécessite, aux yeux de Jean XXIII, d’actualiser le droit naturel d’obédience chrétienne en une nouvelle cosmopolitique des hommes. En rappelant l’impératif de veiller au « bien commun universel » (communis omnium utilitas), le pape évoque la nécessité de créer une « communauté mondiale » (universarum gentium societas), seule apte à gérer ce bien commun. La mondialisation pourrait ici s’entendre dans un sens qui rappellerait ses premiers emplois, comme un processus de socialisation à l’échelle du Monde en vue d’une gouvernance mondiale dont le but serait le bien-être de chacun.
« Êtres essentiellement sociables, les hommes ont à vivre les uns avec les autres et à promouvoir le bien les uns des autres. Aussi, l’harmonie d’un groupe réclame-t-elle la reconnaissance et l’accomplissement des droits et des devoirs. Mais en outre chacun est appelé à concourir généreusement à l’avènement d’un ordre collectif qui satisfasse toujours plus largement aux droits et aux obligations. » (§31)
Parmi l’ensemble de ces droits et devoirs, signalons au passage le droit au travail, qui est aussi une prise de position contre le communisme :
« 18. Tout homme a droit au travail et à l’initiative dans le domaine économique. […]
21. De la nature de l’homme dérive également le droit à la propriété privée des biens, y compris les moyens de production. »
Et le droit à émigrer/immigrer, fondé sur la fraternité humaine :
« Tout homme a droit à la liberté de mouvement et de séjour à l’intérieur de la communauté politique dont il est citoyen ; il a aussi le droit, moyennant des motifs valables, de se rendre à l’étranger et de s’y fixer. Jamais, l’appartenance à telle ou telle communauté politique ne saurait empêcher qui que ce soit d’être membre de la famille humaine, citoyen de cette communauté universelle où tous les hommes sont rassemblés par des liens communs. » (§25)
Comment assurer cette gouvernance mondiale ? Jean XXIII apporte deux réponses. La première est une invitation à calquer les relations internationales sur les relations interpersonnelles, le changement d’échelle n’impliquant pas de changement des principes moraux.
« Nous affirmons à nouveau l’enseignement maintes fois donné par Nos prédécesseurs : les communautés politiques ont, entre elles, des droits et des devoirs réciproques : elles doivent donc harmoniser leurs relations selon la vérité et la justice, en esprit d’active solidarité et dans la liberté. La même loi morale qui régit la vie des hommes doit régler aussi les rapports entre les États. » (§80)
Toutefois, Jean XXIII conclut à l’échec de la coopération internationale :
« 133. Autrefois, les gouvernements passaient pour être suffisamment à même d’assurer le bien commun universel. Ils s’efforçaient d’y pourvoir par la voie des relations diplomatiques normales ou par des rencontres à un niveau plus élevé, à l’aide des instruments juridiques que sont les conventions et les traités : procédés et moyens que fournissent le droit naturel, le droit des gens et le droit international.
134. De nos jours, de profonds changements sont intervenus dans les rapports entre les États. D’une part, le bien commun universel soulève des problèmes extrêmement graves, difficiles, et qui exigent une solution rapide, surtout quand il s’agit de la défense de la sécurité et de la paix mondiales. D’autre part, au regard du droit, les pouvoirs publics des diverses communautés politiques se trouvent sur un pied d’égalité les uns à l’égard des autres ; ils ont beau multiplier les Congrès et les recherches en vue d’établir de meilleurs instruments juridiques, ils ne parviennent plus à affronter et à résoudre efficacement ces problèmes. Non pas qu’eux-mêmes manquent de bonne volonté et d’initiative, mais c’est l’autorité dont ils sont investis qui est insuffisante.
135. Dans les conditions actuelles de la communauté humaine, l’organisation et le fonctionnement des États aussi bien que l’autorité conférée à tous les gouvernements ne permettent pas, il faut l’avouer, de promouvoir comme il faut le bien commun universel. »
La deuxième réponse est donc un appel à un dépassement des États :
« 137. De nos jours, le bien commun universel pose des problèmes de dimensions mondiales. Ils ne peuvent être résolus que par une autorité publique dont le pouvoir, la constitution et les moyens d’action prennent eux aussi des dimensions mondiales et qui puisse exercer son action sur toute l’étendue de la terre. C’est donc l’ordre moral lui-même qui exige la constitution d’une autorité publique de compétence universelle. »
Par ailleurs, Jean XXIII attire l’attention sur les limites du découpage étatique et de la mondialisation du modèle de l’État-nation :
« 94. Depuis le XIXe siècle, s’est accentuée et répandue un peu partout la tendance des communautés politiques à coïncider avec les communautés nationales. Pour divers motifs ; il n’est pas toujours possible de faire coïncider les frontières géographiques et ethniques : d’où le phénomène des minorités et les problèmes si difficiles qu’elles soulèvent.
95. À ce propos, Nous devons déclarer de la façon la plus explicite que toute politique tendant à contrarier la vitalité et l’expansion des minorités constitue une faute grave contre la justice, plus grave encore quand ces manœuvres visent à les faire disparaître.
96. Par contre, rien de plus conforme à la justice que l’action menée par les pouvoirs publics pour améliorer les conditions de vie des minorités ethniques, notamment en ce qui concerne leur langue, leur culture, leurs coutumes, leurs ressources et leurs entreprises économiques. »
Malgré bien des passages marqués par le conservatisme moral de Jean XXIII, l’encyclique de 1963 peut ainsi être lue comme une forme d’altermondialisme. Jean XXIII, dans l’avènement du Monde, voit l’œuvre de Dieu et ne peut qu’encourager cette mondialisation, mais il en déplore aussi la violence et les inégalités. Ses prises de position sont très politiques en s’inscrivant dans les débats de l’époque, notamment dans les chapitres intitulés « Signes des temps », expression clé du concile Vatican II. Ainsi, selon Jean XXIII, trois caractérisent l’époque : la « promotion économique et sociale des classes laborieuses » (§ 40), « l’entrée de la femme dans la vie publique » (§ 41) et la fin de la colonisation.
« 42. Enfin l’humanité, par rapport à un passé récent, présente une organisation sociale et politique profondément transformée. Plus de peuples dominateurs et de peuples dominés : toutes les nations ont constitué ou constituent des communautés politiques indépendantes.
43. Les hommes de tout pays et continent sont aujourd’hui citoyens d’un État autonome et indépendant, ou ils sont sur le point de l’être. Personne ne veut être soumis à des pouvoirs politiques étrangers à sa communauté ou à son groupe ethnique. On assiste, chez beaucoup, à la disparition du complexe d’infériorité qui a régné pendant des siècles et des millénaires ; chez d’autres, s’atténue et tend à disparaître, au contraire, le complexe de supériorité, issu de privilèges économiques et sociaux, du sexe ou de la situation politique.
44.- Maintenant, en effet, s’est propagée largement l’idée de l’égalité naturelle de tous les hommes. Aussi, du moins en théorie, ne trouve-t-on plus de justification aux discriminations raciales. Voilà qui représente une étape importante sur la route conduisant à une communauté humaine établie sur la base des principes que Nous avons rappelés. Maintenant, à mesure que l’homme devient conscient de ses droits, germe comme nécessairement en lui la conscience d’obligations correspondantes : ses propres droits, c’est avant tout comme autant d’expressions de sa dignité qu’il devra les faire valoir, et à tous les autres incombera l’obligation de reconnaître ces droits et de les respecter. »
Le pape appelle ainsi à un nouvel ordre mondial fondé sur la solidarité :
« Pour satisfaire à une autre exigence du bien commun universel, chaque communauté politique doit favoriser en son sein les échanges de toute sorte, soit entre les particuliers, soit entre les corps intermédiaires. En beaucoup de régions du monde coexistent des groupes plus ou moins différents sous le rapport ethnique ; il faut veiller à ce que les éléments qui caractérisent un groupe ne constituent pas une cloison étanche entravant les relations entre des hommes de groupes divers. Cela détonnerait brutalement à notre époque, où les distances d’un pays à l’autre ont à peu près disparu. On n’oubliera pas non plus que, si chaque famille ethnique possède des particularités qui forment sa richesse singulière, les hommes ont en commun des éléments essentiels et sont portés par nature à se rencontrer dans le monde des valeurs spirituelles, dont l’assimilation progressive leur permet un développement toujours plus poussé. Il faut donc leur reconnaître le droit et le devoir d’entrer en communauté les uns avec les autres. » (§ 100)
Et sur une meilleure répartition des richesses :
« 101. Personne n’ignore la disproportion qui règne en certaines zones entre les terrains cultivables et l’effectif de la population, ou bien entre les richesses du sol et l’équipement nécessaire à leur exploitation. Cet état de choses réclame, de la part des peuples, une collaboration qui facilite la circulation des biens, des capitaux et des personnes.
102. Nous estimons opportun que, dans toute la mesure du possible, le capital se déplace pour rejoindre la main-d’œuvre et non l’inverse. Ainsi, on permet à des foules de travailleurs d’améliorer leur condition sans avoir à s’expatrier, démarche qui entraîne toujours des déchirements et des périodes difficiles de réadaptation et d’assimilation au nouveau milieu. »
L’encyclique fut le testament spirituel de Jean XXIII, décédé quelques mois plus tard. On pourra la juger comme un vœu pieux, elle n’en demeure pas moins un texte important sur la mondialisation, la « planétisation », comme l’écrivait alors Pierre Teilhard de Chardin.
Bibliographie
Pacem in Terris, texte en latin.
Pacem in Terris, traduction française.
M.A. Glendon, R. Hittinger, M. Sánchez Sorondo (dir.), 2013, The Global Quest for Tranquillitas Ordinis Pacem in Terris, Fifty Years Later, Vatican, The Pontifical Academy of Social Sciences [en ligne].