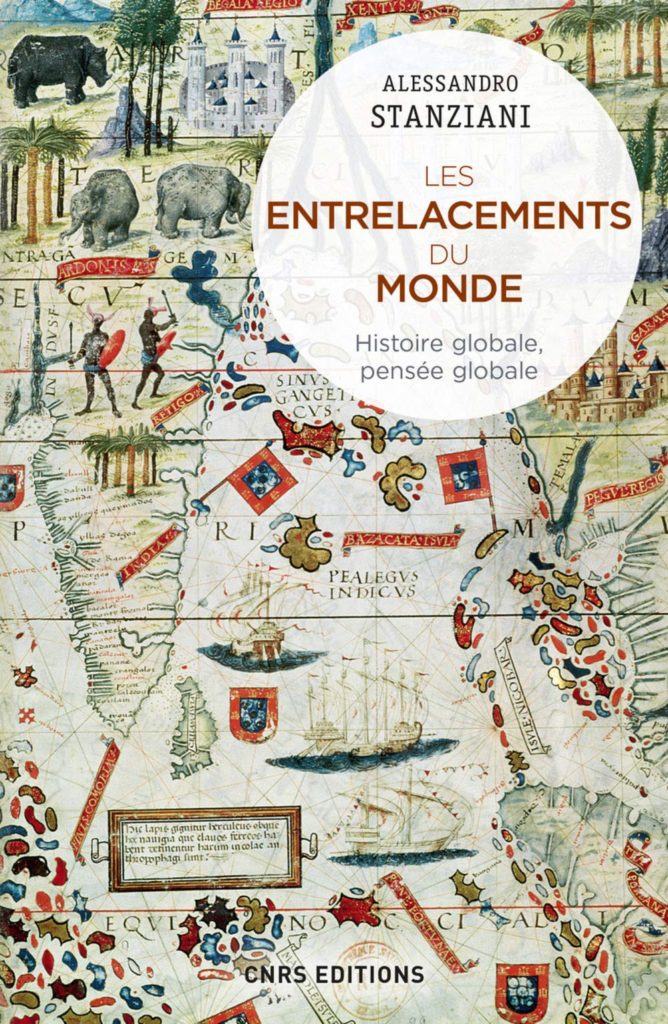Compte-rendu du livre de Sebastian Conrad, What is Global History (Princeton, Princeton University Press, 2016).
Par Mathieu Roy, doctorant à l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
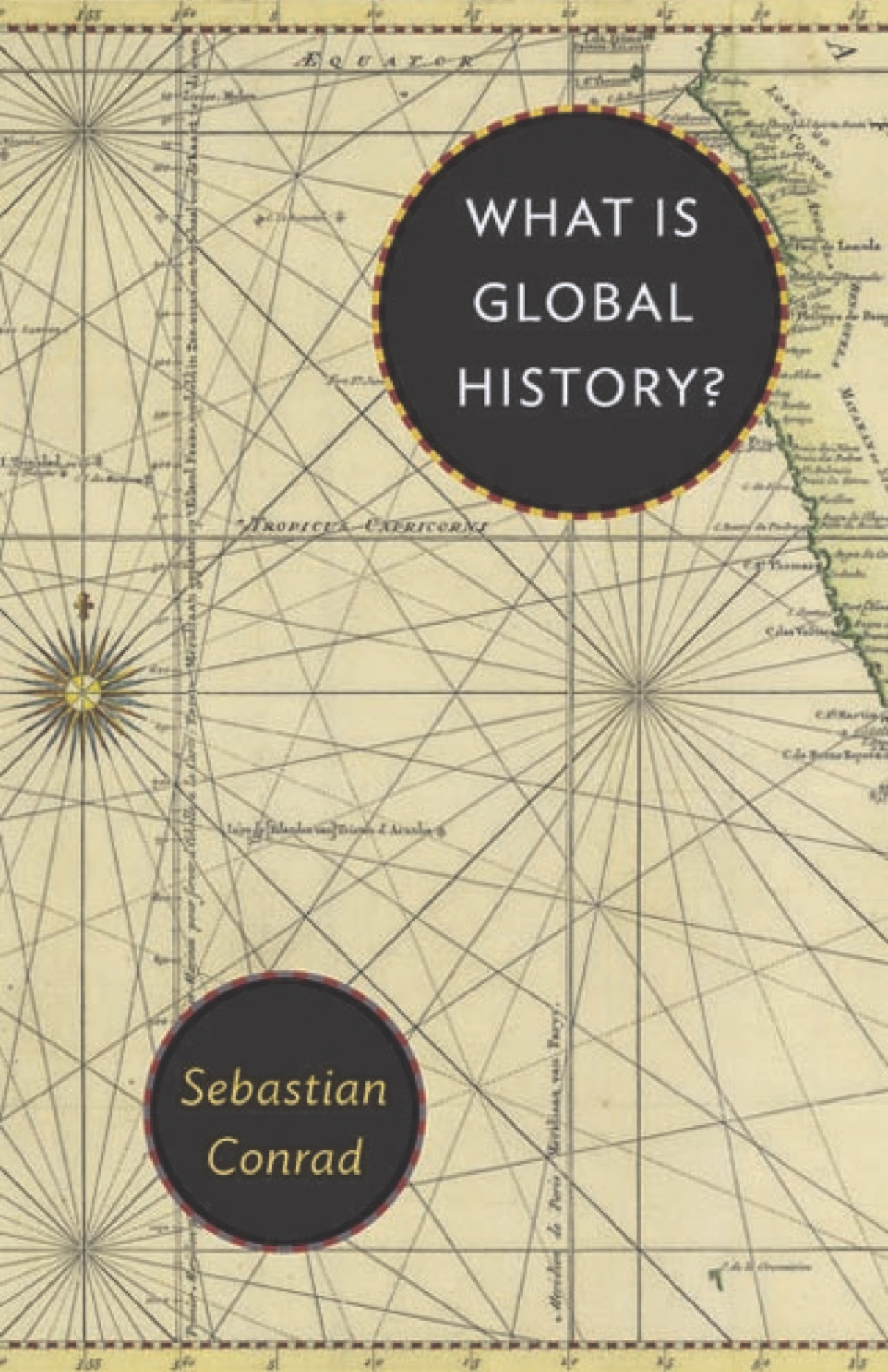
Près de trente ans après la montée en popularité de l’histoire globale, la parution d’une synthèse sur cette approche se faisait toujours attendre. Il s’agissait là d’une lacune importante de l’historiographie à laquelle s’attaque l’ouvrage de Sebastian Conrad What is Global History?, paru en 2016 aux Presses universitaires de Princeton. La maison d’édition est réputée pour ses parutions en histoire globale, qui comprend parmi les œuvres les plus marquantes de la discipline, à commencer par The Global Condition de William H. McNeill[1], The Emergence of Globalism d’Or Rosemboin[2] et Globalization: A Short History de Jürgen Osterhammel et Niels P. Petersson[3]. Le fait de publier aux côtés de ces historiens n’est pas anodin. Il témoigne d’une volonté d’inscrire cet ouvrage dans les débats qui animent les praticiens de l’histoire mondiale. Ainsi, bien plus que de simplement définir ce qu’est l’histoire globale, l’ouvrage de Conrad est guidé par une volonté, d’une part, d’expliquer les spécificités méthodologiques de cette approche et, d’autre part, de souligner ce qui caractérise sa pertinence contemporaine, appelant ainsi à un renouveau historiographique.
Sébastian Conrad est un historien allemand s’intéressant à l’histoire intellectuelle, postcoloniale et globale. Ses recherches ont porté principalement sur l’Allemagne et le Japon. Sa thèse de doctorat, publiée sous le titre The Quest for the Lost Nation: Writing History in Germany and Japan in the American Century[4] porte sur les mémoires de la Seconde Guerre mondiale dans l’Allemagne et le Japon des années 1990. Conrad y analyse les conséquences des changements sociopolitiques mondiales de la fin du 20e siècle. Dans ses ouvrages German Colonialism: A Short History[5] et Globalisation and the Nation in Imperial Germany[6], le professeur de l’Université libre de Berlin s’intéresse aux relations entre le nationalisme allemand et la mondialisation. Il montre déjà, avant la parution de What is Global History?, son inscription dans le boom que connaît l’histoire globale depuis quelques années.
Des approches en compétition
L’auteur aborde dans ses premiers chapitres (chap. 1-3) la genèse de l’histoire globale. Au cours de l’ère de domination des puissances européennes, du 16e au 19e siècle, une conception eurocentrique est montée en puissance, cette dernière étant guidée par une théologie du progrès doublée d’un idéal de supériorité civilisationnelle[7]. Conrad met ensuite l’accent sur le changement de paradigme survenu suite à la Seconde Guerre mondiale. Une vision matérialiste de l’histoire inspirée par la lutte des classes, le marxisme et l’universalisme a gagné en popularité au cours de cette période[8]. Ce courant amène l’historien à rendre compte des approches en compétition dans l’histoire globale. La deuxième sous-partie de l’ouvrage de Conrad (chap. 4-7) est sans doute sa plus intéressante. Elle s’intéresse à la méthodologie de l’histoire globale, celle-ci étant intrinsèquement liée à la pertinence sociale que l’historien lui accorde. Cette partie de son œuvre démontre que le renouveau épistémologique de l’histoire globale ne peut pas être dissocié de cette façon de pratiquer d’histoire. Les chapitres 8-10 misent sur l’écriture contemporaine de l’histoire globale. L’auteur y plaide pour sa façon de concevoir cette approche. Selon lui, le positionnement de l’écrivain, autant individuel que national, influe sur la manière de produire l’histoire.
Le corps de l’argumentaire gravite autour de l’analyse des échelles spatio-temporelles. Plutôt que de miser sur l’analyse des connexions, Conrad propose de mettre en exergue les processus d’intégration sur lesquels l’histoire globale reposerait ultimement[9]. Sa description des multiples mécanismes d’intégration spatiale l’amène à promouvoir une variante des méthodes déjà explorées par l’historiographie, celle-ci basée sur la pluralité des échelles et des causalités. Pour l’historien : « One task of global history as a perspective is precisely to understand the relationship of different causalities operating at a large scale[10]. » Au surplus, Conrad s’affaire à démontrer que l’histoire globale n’est pas en opposition avec d’autres formes d’échelles de connexions et qu’elle peut être écrite de plusieurs angles. Celui-ci renchérit : « The most fascinating questions are often those that arise at the intersection between global process and their local manifestations[11]. » Une telle proposition contredit la fausse opposition entre le local et le global souvent soulevée par les détracteurs de l’histoire globale. L’historien positionne sagement son courant de façon complémentaire aux préoccupations découlant d’autres projets historiographiques[12]. L’histoire nationale doit avoir sa place dans la constellation des savoirs historiques, mais différemment de celle occupée actuellement. Ce champ doit selon lui reconnaître que les acteurs nationaux agissent à partir d’un contexte plus vaste et selon une conscience globale. Incidemment, les acteurs doivent être vus comme pensant à leur nation au regard de et en reconnaissance d’un contexte global. De même, l’auteur valorise la compréhension de l’émergence du nationalisme et de l’État-nation au 19e siècle dans ce contexte plus vaste[13]. On peut sentir en filigrane de cette proposition une amertume face à la reconnaissance de ce cadre chez les historiens sans qu’il soit sérieusement pris en considération.
Le choix des échelles
Qui plus est, Conrad aborde en profondeur le rapport au temps au sein de l’histoire globale afin de démontrer comment cette variable peut être traitée différemment. L’intellectuel allemand plaide pour une prise en considération de différentes échelles temporelles en fonction de leurs buts analytiques[14]. L’auteur donne l’exemple de la montée en puissance de la Chine à partir du 20e siècle pour avancer que :
« China’s present rise was not predicated on any of these factors alone. It was not determinated in the long run, but it was conditioned by a range of historical circumstances. […] As with space, such a scaling of the past, or jeux d’échelles, is the best methodological tool to accommodate different temporalities. The global dimension is not intrinsically connected to any one of these time frames. Global perspectives can be integrated on every level, from macro-accounts spanning several centuries and more, to the analyses of the short-term and even the crucial moments[15]. »
L’auteur rappelle par la suite que le choix des échelles relève toujours de choix normatifs, puisqu’il implique un jugement sur les forces motrices des phénomènes historiques. Pour cela, il n’y a guère de raisons pour lesquelles, selon Conrad, l’histoire globale devrait être moins orientée que peut l’être l’histoire nationale. Ces propos démontrent encore une fois comment la démarche de cet ouvrage surpasse la simple explication de l’histoire globale comme genre historiographique. Par exemple, ce dernier prend au sérieux la suggestion de plusieurs historiens d’établir des rapprochements entre le temps géologique de la Terre – l’Anthropocène – et celui des sociétés humaines, afin de mieux comprendre les bouleversements qui affectent nos sociétés contemporaines[16]. L’historien explore lui aussi des spatialités alternatives, en donnant des exemples associés à l’histoire environnementale, de la santé mondiale ou bien des organisations globales[17]. Tout au long de son ouvrage, Conrad appelle à faire preuve de prudence sur ce point, car même ces approches peuvent comporter des angles morts, exclure des populations ainsi que des types de changements. Sa réflexion sur la méthodologie, essentiellement, vise à tisser des rapprochements afin de parfaire la Big History. Ce faisant, elle vise à faire évoluer sa propre discipline en plaidant pour une approche structuraliste qui prend en compte l’influence des structures sur l’activité humaine tout comme le rôle de celles-ci sur les individus[18]. De surcroît, l’auteur réussit à dépasser la fausse dichotomie entre agentivité et contingence en plaidant pour une analyse hétérogène.
Un projet historiographique partagé
En s’interrogeant sur la position des historiens dans le processus de production du savoir et en prenant position pour un nouveau fondement historiographique, Conrad offre des pistes de réponses aux problèmes épistémologiques soulevés envers la notion d’objectivité en histoire. De même, il surpasse les impasses auxquelles peuvent mener ces réflexions en ne tombant pas dans un excès de relativisme. En supplément, cette réflexion amène de l’eau au moulin pour l’élaboration d’un projet historiographique partagé. L’auteur s’interroge habilement sur les catégories qui dictent notre pensée et assume le positionnement de l’histoire globale dans la création d’un monde commun[19]. Compte tenu de l’importance qu’il accorde à cette question, il est clair que Conrad souhaite que l’histoire globale influe, comme approche, sur l’ensemble des champs d’études historiques.
À l’instar d’auteurs tels que Jack Goody, Ashis Nandy et Dipesh Chakrabarthy avant lui, l’écrivain plaide pour une histoire globale s’arrimant à la décolonisation. À cet effet, son travail s’appuie sur de multiples concepts issus des études postcoloniales[20]. Suivant cette logique, l’auteur en appelle à écrire pour réduire les inégalités entre le Nord et le Sud, les inégalités de classes et les mécanismes d’exclusion[21]. Conrad se montre intéressé à penser le monde commun auquel peut contribuer l’histoire globale à l’écart du monde de significations imposé par l’impérialisme. Pour cette raison, le chercheur tente de se dissocier, au cours de ses premiers chapitres, de l’histoire globale produite au cours de la Guerre froide, des approches marxistes et de surpasser le paradigme ouvert par William H. McNeill. Sa synthèse identifie judicieusement les impasses dans lesquelles le courant postcolonial peut mener, comme verser dans l’afro-, le sino- ou l’islamocentrisme. La promotion d’une approche globale intimement liée à un regard critique envers le processus de globalisation est un aspect central de l’œuvre de Conrad, cette dernière arrivant à maturité dans son ultime chapitre. Pour lui, « one of the crucial tasks of global history is to offer a critical commentary on the ongoing globalization process[22] ». L’historien appelle également à dépasser les positionnements culturel, géographique et linguistique afin de comprendre la position des historiens. En ce sens, il se montre tout aussi intéressé par ce qui dépasse les frontières de l’Europe que par ce que les historiens non européens avancent au point de vue des idées[23]. Les exemples qui jonchent le fil des pages sont très bien appuyés. Ils sont choisis autour des champs d’expertise de l’écrivain, centrés sur le Japon et l’Allemagne. Néanmoins, ses exemples précèdent rarement les 15e et 16e siècles, qui marquent le début de la colonisation européenne. Ainsi, l’auteur reproduit dans sa critique de la globalisation une certaine part d’eurocentrisme. De même, il ne va que rarement mentionner l’Eurasie comme aire d’interaction commune, mais plutôt s’en tenir à une division assez classique entre les continents.
Quelques éléments critiques
L’analyse déployée tout au long de l’essai se situe principalement au plan discursif. Ce faisant, l’intellectuel s’inscrit dans une approche misant sur l’étude des représentations et des perceptions. Cela saute aux yeux en lisant son dernier chapitre (« Global history for whom? ») axé sur le langage, les hiérarchies dans les formes d’écriture, le public et la posture des historiens. Or, quelle est la place de la culture matérielle, pour Conrad, au sein de la méthodologie de l’approche globale? Il s’agit-là d’un angle mort important de son ouvrage. De plus, on ne peut passer sous silence le manque d’insistance de l’ouvrage sur l’utilisation des sources en histoire globale. En effet, l’approche globale doit-elle insister sur l’analyse de la culture matérielle ou sur le travail de synthèse ? Y a-t-il un équilibre à atteindre entre l’utilisation de ces deux éléments ? Alors que certains intellectuels ont par le passé maintes fois souligné ces limitations de l’approche globale, il est étonnant que l’auteur ne leur consacre qu’une si mince place, étant donné leur potentiel à remettre en question la faisabilité même de cette forme d’histoire. Ce thème aurait été d’autant plus cohérent considérant l’angle choisi par l’auteur, axé sur son application contemporaine. Mentionnons enfin que l’auteur lance gratuitement à plusieurs reprises des pointes envers l’œuvre de William H. McNeill, sans toutefois expliciter ce qu’il reproche à ses travaux. On se demande bien, à la fin de notre lecture, ce que Conrad peut bien avoir envers cet historien qui a tant ouvert le champ de l’histoire globale.
Cinq ans de réflexion
Chose certaine, malgré les limitations abordées, ce travail convient à toute personne intéressée à en savoir plus sur le développement de l’histoire globale et l’étude des dynamiques mondiales. Il s’agit d’une excellente porte d’entrée pour mieux comprendre les débats, limitations et objets de cette approche, ainsi que d’un exercice de synthèse réussi. En somme, quelle est la contribution de l’ouvrage de Conrad à l’historiographie contemporaine ? Peut-on dire qu’il a gagné son pari ? Trente ans après la montée en popularité de l’histoire globale comme champ disciplinaire, l’ouvrage de Conrad nous offre une belle synthèse du déploiement, de la méthode, des défis et de la pertinence de ce champ d’études. Ces travaux viennent offrir davantage de légitimité à cette approche encore contestée par plusieurs et poser les bases d’une nouvelle approche globale en dehors du paradigme de la Guerre froide. Cinq ans après sa publication, cet ouvrage a fait couler beaucoup d’encre et provoqué des discussions stimulantes au sein de la communauté universitaire[24]. Cela prouve hors de tout doute à quel point la francophonie gagnerait à ce que cette œuvre, d’une grande pertinence historiographique, soit traduite en français. Enfin, si Conrad ouvre son ouvrage sur les propos provocateurs de Christopher A. Bayly affirmant que tous les historiens sont des historiens du monde[25], l’auteur de cette synthèse aura réussi à prouver à son auditoire qu’effectivement, tous les différents types d’histoires doivent tendre la main à l’approche globale.
[1] William MCNEILL, The Global Condition, New Jersey, Princeton University Press, 2017, 200 p.
[2] Or ROSEMBOIN, The Emergence of Globalism, New Jersey, Princeton University Press, 2018, 352 p.
[3] Jurgen OSTERHAMMEL, Globalization: A Short history, New Jersey, Princeton University Press, 2009, 200 p.
[4] Sebastian CONRAD, The Quest for the Lost Nation: Writing History in Germany and Japan in the American Century, Berkley, University of California Press, 2010, 400 p.
[5] Sebastian CONRAD, German Colonialism; A short History, Royaume-Uni, Cambridge University Press, 2011, 246 p.
[6] Sebastian CONRAD, Globalisation and the Nation in Imperial Germany, Royaume-Uni, Cambridge University Press, 2010, 497 p.
[7] Sebastian CONRAD, What is Global History?, New Jersey, Princeton University Press, 2016, p. 24-31
[8] Ibid., p. 31-36
[9] Ibid., p. 129.
[10] Ibid., p. 108.
[11] Ibid., p. 129.
[12] Ibid., p. 136.
[13] Sebastian Conrad, « History on Tape – Interview with Sebastian Conrad », op. cit., 33 min 12 sec.
[14] Sebastian Conrad, What is Global History?, op. cit., p. 142.
[15] Ibid., p. 149.
[16] Ibid., p. 145, 147 et 159.
[17] Ibid., p. 119-121.
[18] Ibid., p. 161.
[19] P Ibid., p. 181, 186 et 233.
[20] Ibid., p. 172-173.
[21] Ibid., p. 184.
[22] Ibid., p. 216.
[23] Sebastian CONRAD, « History on Tape – Interview with Sebastian Conrad », Op. cit., 43m23s.
[24] Voir par exemple : Daria, TASHKINOVA, « Review: What Is Global History?” by Sebastian Conrad », Global Histories, vol. 2, no. 1, oct. 2016, p. 111–113 ou Emily, « What is Global History? by Sebastian Conrad (review) », Canadian Journal of History, Vol. 52, No. 2, autumn/automne 2017, p. 409-411.
[25] Sebastian CONRAD, What is Global History?, Op. cit., p. 1.