Nous publions ici le premier volet de « Histoire globale, pensée globale », texte constituant l’introduction du dernier livre d’Alessandro Stanziani, Les Entrelacements du monde. Histoire globale, pensée globale (XVIe-XXIe siècles), CNRS Éditions, 2018. Cet article sera diffusé en quatre parties successives : « Des rencontres inattendues : épistémologie historique du (monde) global » ; « Les courants de l’histoire globale au 21e siècle » ; « Comparaisons versus connexions » ; « Histoire globale à la française ? ». Merci à l’auteur et à son éditeur d’avoir accepté cette republication sur le Web.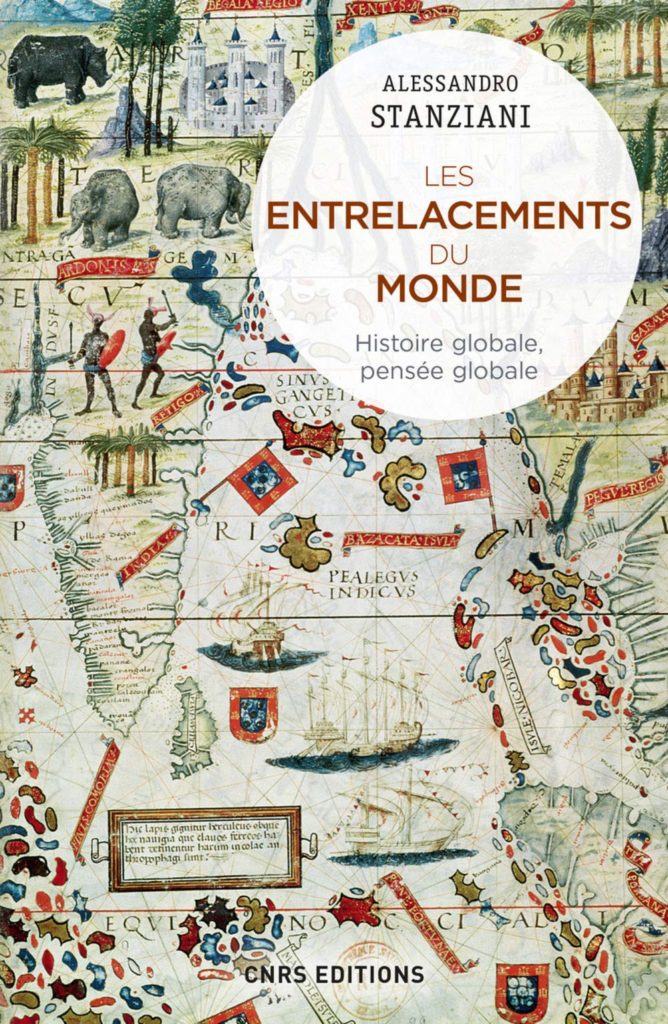
Des rencontres inattendues : épistémologie historique du (monde) global
Il suffit de se promener dans les couloirs de n’importe quelle université française, La Sorbonne, ou toute autre faculté d’histoire, pour remarquer quelque chose de tout à fait commun avec une université à Rome, Moscou, Washington, Delhi ou Tokyo : l’histoire est synonyme d’histoire nationale ; celle des autres pays se trouve dans les départements correspondants d’études chinoises, russes, indiennes ou américaines. Les enseignants et chercheurs de ces départements justifient aisément cette répartition au nom de la « spécificité » du pays ; la Russie n’est pas la France, l’Inde n’est pas la Chine ni le Sénégal. Nous sommes d’accord ; mais pourquoi ce découpage ?
C’est là que la question se complique ; sauf à évoquer des banalités telles que l’État centralisé et les Lumières en France, la frontière et la liberté aux États-Unis, la taille du pays et les mandarins en Chine ou encore la mafia et la pizza en Italie, la question des spécificités nationales et de leur histoire n’est pas si évidente. Il ne suffit donc, comme l’affirmait George W. Bush au sujet du candidat démocrate John Kerry, de « ressembler à un Français » – au sens péjoratif du terme – pour trouver une réponse. Si tant est qu’elle existe, quelle est la spécificité de l’histoire de la Russie par rapport à celle de la France, de l’Allemagne ou de la Chine ?
Cette question ne vise pas à nier toute différence entre les pays, mais uniquement à mieux identifier les dissemblances en évitant de passer nécessairement par une « culture nationale ». La France aux Français, la Chine aux Chinois, la Russie aux Russes, autant de slogans qui se glissent de la rhétorique politique à la politique scientifique. Préserver l’histoire nationale, la faire apprendre aux immigrés, au lieu d’expliquer les relations et connexions entre les mondes, n’est-ce pas là ce que de nombreux responsables politiques en France et dans le monde prêchent de nos jours ?
Les polémiques récentes en France sur l’importance de l’histoire nationale dans les programmes politiques et à l’école en témoignent : la manière de penser l’histoire, notamment dans ses dimensions politiques et dans ses échelles – régionale, nationale, coloniale, globale, internationale – constitue un outil formidable pour réfléchir à la manière dont nous souhaitons former nos enfants. En effet, l’enseignement de l’histoire dans la plupart des universités et écoles françaises se concentre sur l’héritage « gaulois », la République et ses valeurs et, d’un autre côté, la Chine éternelle, l’islam conservateur, l’Inde mystique et la Russie despotique. L’histoire telle qu’elle est enseignée et pratiquée renforce le « mur contre mur » et la représentation du monde comme un choc entre les civilisations. Ainsi, l’introduction, extrêmement timide, de l’histoire africaine et asiatique dans les manuels scolaires suscite les critiques les plus farouches de la part de politiciens d’extrême droite pendant les années 2000, puis de Max Gallo avec ses travaux identitaires, et finalement de Nicolas Sarkozy. Des commentateurs, journalistes et historiens, tels que Alain Finkielkraut, Lorànt Deutsch, Dimitri Casali, Éric Zemmour ou encore Patrick Buisson revendiquent le retour à une histoire synonyme de valeurs nationales. Défense de l’histoire nationale, critique toujours difficile de l’histoire coloniale et ouverture timide vers l’histoire des autres mondes, voici les éléments principaux du débat politique et savant sur le rôle de l’histoire en France. Ces attaques s’adressent en particulier au livre dirigé par Patrick Boucheron (1) dont le succès dépasse, et de loin, la force de ses critiques.
Il n’empêche, les discussions sur cet ouvrage se sont superposées au débat politique proprement dit, François Fillon évoquant l’importance de l’histoire nationale d’un côté, Benoît Hamon et une partie de la gauche défendant Patrick Boucheron de l’autre. En réalité, ces débats ne sont pas une exclusivité française ; ces dernières années, le rôle politique de l’histoire, son enseignement et, dans ce cadre, la relation entre histoire nationale et histoire globale ou mondiale, ont envahi les débats aux États-Unis (notamment avec Donald Trump) comme en Russie, en Inde (avec le parti hindou nationaliste au pouvoir), en Italie, en Chine comme au Japon et, tout récemment, en Pologne et en Hongrie. Pourquoi ? Qu’y a-t-il de si particulier dans l’histoire globale à susciter des réactions extrêmes, dans un sens comme dans l’autre, aussi bien parmi les historiens que parmi les politiciens et dans l’opinion publique ?
Cet ouvrage cherche à répondre à ces questions en les inscrivant dans la longue durée – à partir du 15e siècle – et dans des espaces connectés mondiaux. C’est bel et bien une épistémologie critique et historique de l’écriture de l’histoire dans sa globalité qui est au cœur du présent livre. Les tensions entre philologie et sciences sociales, histoire comparée et histoire connectée, histoire européocentrique (et sa définition même) et subaltern studies seront discutées dans des contextes précis : l’expansion européenne, la formation des États nationaux et des empires, l’essor de la « modernité » puis les catastrophes du 20e siècle jusqu’à la décolonisation et à la globalisation actuelle.
Après avoir présenté les principaux courants de l’histoire globale (chap. 1), la première partie (chap. 2, 3, 4) discutera des relations entre histoire, globalité et philosophie. L’histoire a-t-elle un sens et lequel ?
D’innombrables auteurs ont essayé de répondre à cette question pendant des siècles, non seulement en Occident, mais partout dans le monde. Il n’est pas question bien entendu de discuter tous azimuts ces approches ; nous allons principalement suivre certains courants encore présents de nos jours au sein de l’histoire globale et notamment l’histoire mondiale et universelle (des synthèses générales aux approches post-marxistes). L’argument que nous avançons est que ces démarches s’inscrivent dans un long sillage d’histoire normative, jadis qualifiée de philosophie historique. La disparition présumée de cette dernière, annoncée plusieurs fois après la Shoah, puis après l’écroulement du bloc soviétique, a été en partie compensée par l’émergence d’une histoire globalisante fortement normative. Il est important de tracer ces filiations dans la mesure où elles posent la question des formes d’insertion des historiens dans la cité. Cette démarche liant philosophie et histoire, déjà présente à l’époque médiévale et moderne, s’affirme avec les Lumières (chap. 2), puis avec Marx (chap. 3). Ces auteurs et leur manière d’appréhender l’histoire et sa philosophie sont pris à parti de nos jours par tout un pan de courants qui, à l’instar de Edward Said et des subaltern studies, y voient des postures irrévocablement européocentriques. En réalité, nous verrons que les Lumières offrent des réponses hétérogènes à la globalisation du 18e siècle, tout comme Marx à celle du siècle suivant. La force et les limites de la diffusion des Lumières et de Marx en dehors de l’Europe offrent un banc d’essai pertinent pour répondre à ces questions.
Nous poursuivrons en examinant la manière dont philosophie politique et histoire se sont exprimées dans des contextes totalitaires. La philosophie de l’histoire de l’entre-deux-guerres entretient des liaisons dangereuses avec la thèse d’une décadence de l’Occident. Ces liaisons refont surface de nos jours.
Finalement, nous compléterons le lien entre politique, philosophie et histoire mondiale-universelle pendant la seconde moitié du 20e siècle et le début du 21e, en discutant la thèse de Fukuyama de la « fin de l’histoire » (chap. 4), réponse aux illusions de l’après-Seconde Guerre mondiale et au désenchantement de l’après-1989. En réalité, nous assistons à une résurgence des intégrismes sur fond de globalisation et de crise économique. L’Occident aurait-il gagné la guerre et perdu la paix ?
C’est là que, à côté de l’histoire du monde et de la philosophie de l’histoire, une autre démarche s’impose en histoire globale : l’histoire comparée, notamment dans sa variante socio-économique. Historiens et non-historiens, souvent sans s’en rendre compte, pratiquent couramment ce genre d’exercice lorsqu’ils s’interrogent, par exemple, sur ce qui fait la spécificité de la France, par rapport à la Russie ou à la Chine. Des questions récurrentes telles que : pourquoi y a-t-il des pays riches et d’autres pauvres ?, pourquoi certains pays ont-ils des institutions représentatives et pas d’autres ?, sont redevables de cette démarche comparative.
Nous allons également retracer la généalogie de cette approche suivant un courant particulier, celui qui émerge au 19e siècle avec l’école historique allemande, puis Weber (chap. 5), eet étudier son transfert dans l’économie du développement après la Seconde Guerre mondiale et dans les débats actuels sur la grande divergence entre la Chine et l’Europe. Comme pour l’histoire globale philosophique, la tension entre le modèle et les sources, et donc la question de la normativité de l’histoire, est centrale. Ces discussions seront reliées à des enjeux politiques et sociaux : la signification de l’unification allemande, l’idée même de « retard » en économie, les difficultés des Occidentaux et des pays du Nord à penser la décolonisation sans passer par des perspectives d’efficacité économique et de tiers-mondisme à la limite du racisme. Le retour de la Chine sur la scène mondiale, la manière dont il est appréhendé en histoire globale constituent seulement à première vue un changement de perspective. Car l’ambition de ces démarches est bel et bien celle de suggérer des mesures à adopter pour réduire la pauvreté, introduire la démocratie, etc. l’histoire est alors convoquée pour valider ou infirmer ces perspectives.
Une autre possibilité de faire interagir histoire et sciences sociales consiste à adopter la perspective durkheimienne, particulièrement répandue en France. Nous suivrons l’origine de cette démarche (chap. 6), puis la naissance et l’évolution de l’école des Annales, en s’attachant à Braudel en particulier, jusqu’à la microhistoire globale (chap. 7). La question se pose, en ce cas aussi, de la compatibilité de cette approche avec celles de l’histoire globale. Cet aspect est fondamental pour comprendre le lien, en France, entre l’écriture de l’histoire, d’une part, et les tensions entre la nation, la République et le monde global, d’autre part.
Histoire braudelienne, histoire comparée, histoire économique et sociale, histoire philosophique et universelle (chap. 2 à 7) : voilà autant d’« histoires » qui se trouvent sous le feu critique d’une autre orientation, venant initialement d’auteurs indiens et d’Amérique latine, puis africains et, désormais, occidentaux. Ces auteurs accusent les approches étudiées jusqu’ici – Lumières, Marx, Weber, Durkheim, Braudel, etc. – d’être européocentriques. Tout un pan de l’histoire globale cherche à avancer d’autres perspectives du point de vue des sources, de leur interprétation, des catégories et des modèles. Les quatre derniers chapitres (8 à 11) de la troisième partie prennent au sérieux cette question. Y a-t-il eu « européocentrisme », voire un kidnapping de l’histoire au fil du temps ?
Nous adoptons la même posture que pour les questions précédentes ; au lieu de décider si oui ou non l’histoire occidentale est européocentrique (et probablement elle l’est), si les empires et les colonisations ont en quelque sorte volé l’histoire aux populations autochtones (ce qui est en partie fondé aussi), nous chercherons à comprendre ce que européocentrisme signifie réellement pour des auteurs appartenant à des temps et lieux différents, à partir du 16e siècle. L’européocentrisme doit être qualifié dans ses complexité et latitude historiques afin de pouvoir être discuter et le dépasser dans un monde global. Nous consacrerons une attention particulière à la philologie et à son émergence ; cette discipline est généralement présentée comme la véritable démarche historienne, contre les tentations philosophiques, sociologiques ou économiques discutées dans les chapitres précédents. Nous inscrirons la démarche philologique dans une dimension globale et politique à la fois. La question sera de comprendre si, comme pour la sociologie et l’économie, la philologie est irrémédiablement européocentrée ou si elle offre une autre perspective, et si oui laquelle. Nous ne pourrons répondre à cette question qu’en inscrivant la fabrique des sources (y compris les archives) et leur interprétation dans une histoire des constructions étatiques et de leur évolution. Ces constructions fortement ancrées dans des territoires influencent l’écriture de l’histoire et ses sources. Nous étudierons ces savoirs dès le 15e siècle (chap. 8), ainsi que la relation entre constructions impériales et mémoire historique en Asie et en Europe (chap. 9). Nous continuerons avec l’appropriation de l’histoire des « autres » par les pouvoirs occidentaux, en Inde et ailleurs dans le monde, aux 18e et 19e siècles (chap. 10), mais également les efforts d’écriture d’histoires subalternes dès cette époque. Finalement (chap. 11), nous suivrons les liens entre archives et mémoire historique des grands événements du 20e siècle, de la Révolution russe aux nationalismes indépendantistes, pour terminer avec l’écriture de l’histoire dans les pays du « Sud » à l’époque de la décolonisation.
Dans la conclusion, nous tirerons les fils de ce long voyage dans l’écriture de l’histoire et de la pensée globales en termes d’enseignement, de recherche, mais aussi de rôle dans le débat public.
Alessandro Stanziani
(1) Patrick Boucheron, Histoire mondiale de la France, Paris, Seuil, 2016.
