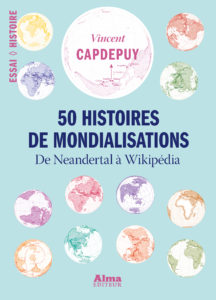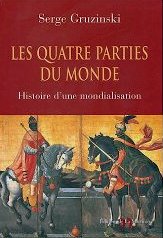Je tiens à remercier vivement Hélène et Mathieu pour m’avoir permis de travailler aux antipodes, dans les archives de la Sarthe.
« L’Europe est atteinte d’un mal qu’elle soupçonne à peine ou plutôt qu’elle ne veut pas voir, de peur d’être trop effrayée […]. Qu’est ce mal ? N’est-ce pas la vieillesse tout simplement ? Non, ce n’est pas vieillesse seulement ; c’est la fatigue, le résultat du surmenage d’abord et de la concurrence ensuite. L’Europe a trop vécu depuis cinquante ans. Elle a développé sa production outre mesure, sacrifié son agriculture à son industrie, donné à son activité un tel essor qu’elle s’est mise sur le pied d’approvisionner de ses marchandises le monde entier. Elle a inventé la vapeur, supprimé les distances et s’est imaginé qu’elle serait seule à bénéficier de ces progrès qui l’ont grisée. » [1]
Le déclin de l’Europe, telle est l’inquiétude de Paul d’Estournelles dans un article paru dans La Revue des Deux mondes en 1896, et intitulé « Le péril prochain. L’Europe et ses rivaux ». Avant, donc, Albert Demangeon, auteur, en 1920, du Déclin de l’Europe. Et Jean-Baptiste Arrault, dans sa thèse, avait bien raison d’affirmer que « le premier XXe siècle, même avant 1914, peut être analysé, et nous avons commencé à le faire, comme une période de crise pour l’Europe » [2].
Paul d’Estournelles, qui occupa diverses fonctions diplomatiques entre 1876 et 1895, abandonna son poste au Quai d’Orsay pour s’engager dans la politique et en 1896, au moment où il publia cet article, il venait juste d’être élu député de la Sarthe. Il continua cependant de se préoccuper des relations internationales, notamment des tensions suscitées par les colonisations, et s’engagea en faveur de la paix mondiale, ce qui lui valut de recevoir le prix Nobel en 1909 avec Auguste Beenaert, autre membre de la Cour internationale d’arbitrage [Pavé 2007].
Une région, en particulier, retenait son attention : l’Extrême-Orient, où les puissances, européennes et non européennes, s’entrechoquaient. Il s’abonna à l’Argus de la presse, qui effectuait une veille éditoriale, et accumula ainsi de très nombreuses coupures de journaux concernant « le péril jaune », selon l’expression en vogue à l’époque (cf. par exemple l’ouvrage de Vambéry, 1904). Ces informations nourrissaient ses réflexions, qu’il exprimait dans ses discours à la Chambre, dans des articles, des conférences, ainsi que dans une riche correspondance. L’ensemble de cette masse documentaire se trouve aujourd’hui dans onze cartons étiquetés « le péril jaune », et conservés aux Archives départementales de la Sarthe. Le fond a constitué la base de la thèse de François Pavé, soutenue en 2011.
Parmi ces papiers, un a retenu mon attention. Court, le texte ne présente à vrai dire que peu d’originalité, mais il n’est pas sans intérêt, surtout dans un cadre scolaire, pour saisir une vision européenne du Monde au tournant des 19e et 20e siècles (cf. en annexe).
L’auteur, Anatole Leroy-Beaulieu, professeur d’histoire contemporaine et des affaires d’Orient à l’École libre des sciences politiques, livre ici un article dans une revue nouvelle qui semble n’avoir que peu duré : 32 numéros répertoriés à la BnF, de novembre 1901 à mars 1903 (Notice). Il s’agit là du premier numéro, et on peut noter que l’auteur se réjouit d’une telle publication :
« Aussi devons-nous féliciter les hommes qui ont entrepris de nous faite connaître cette énigmatique Asie où nos savants et nos explorateurs ont déjà frayé glorieusement tant de voies nouvelles. Il importait à la France, à ses intérêts économiques, politiques, scientifiques, que nous possédions, en langue française, un organe voué à l’étude de cette immense Asie, de l’Asie moderne, de l’Asie contemporaine, de l’Asie orientale surtout, de cet Extrême-Orient qui, bon gré mal gré, s’ouvre aux produits et aux idées de l’Europe. » [3]
La connaissance doit servir la colonisation. L’antienne, connue, est aujourd’hui au cœur de la critique postcoloniale.
De ce point de vue, le découpage du Monde est très classique. Dès le titre, Anatole Leroy-Beaulieu adopte une vision par grandes entités spatiales : l’Asie, l’Europe, et plus loin dans l’article : l’Amérique, l’Afrique. On soulignera cependant l’usage ancien de la notion de « continent », car pour lui, l’Asie, l’Europe, l’Afrique sont bien des « parties du monde » et forment une seule masse terrestre, le « Vieux Continent » – ce qui ne correspond plus tout à fait à l’usage actuel. À l’intérieur de l’Asie, il distingue une région orientale, l’Extrême-Orient, nom qui a été forgé au début du 19e siècle, mais qui ne s’est alors imposé qu’assez récemment [Capdepuy 2008, Pelletier 2011]. À ce pavement se superpose un découpage racial lui aussi très banal pour l’époque : l’homme blanc, l’homme jaune, l’homme noir. Les disjonctions entre les deux structures sont évidentes, mais sont gommées. Contrairement à ce que suggère la dernière phrase par exemple, il n’y a pas coïncidence entre Europe et homme blanc, entre Asie et homme jaune. Quoi qu’il en soit, la combinaison aboutit à une géographie des civilisations où les différences sont essentialisées et naturalisées.
Pourtant, le propos est sans doute moins caricatural qu’il pourrait y paraître à première lecture. Il y a dans le texte d’Anatole Leroy-Beaulieu une mise en garde, l’hégémonie européenne, éclatante au terme du 19e siècle, n’est pas acquise définitivement :
« Notre Occident, si dédaigneux des races qu’il traite d’inférieures, ne saurait impunément l’oublier ; s’il venait à perdre le goût et la faculté des rudes labeurs, s’il laissait s’affaiblir sa capacité de production, l’Extrême-Orient serait là pour recueillir notre héritage. » [4]
L’auteur alerte. Le racisme ordinaire pourrait masquer aux yeux des Européens les évolutions mondiales, qu’on pourrait résumer par le terme de mondialisation. Certes, le mot n’existe pas encore, mais l’adjectif « mondial » commence à se répandre [Capdepuy, 2011] ; et c’est bien un globe mondialisé que décrit Anatole Leroy-Beaulieu en introduction à son article :
« L’axe du monde moderne se déplace en même temps que la scène de l’histoire s’élargit en tous sens. C’est une de choses qui distingueront le XXe siècle des siècles qui l’ont précédé. Le mouvement d’unification de la planète, préparé par les découvertes du XVe siècle, a définitivement fait entrer le globe tout entier dans la sphère politique et économique des peuples civilisés. » [5]
Trois caractéristiques majeures, évoquées par l’auteur, permettent de préciser sa conception du processus de mondialisation.
1) Il constate l’intégration de l’humanité globale dans un seul et même espace, que les géographes ont pris l’habitude depuis les années 1980 de désigner par le mot « Monde », avec une majuscule. On pourrait sans doute contester l’assertion d’Anatole Leroy-Beaulieu sous prétexte que les régions polaires restent des blancs de la carte à l’époque et qu’il existe encore des peuplades inconnues au cœur des forêts équatoriales, mais cela reste marginal.
2) Il pose la question de l’uniformisation civilisationnelle. Le mot « civilisation » apparaît dans l’article dans sa double acception : d’une part, l’auteur considère qu’il existe plusieurs civilisations, au sens de cultures (« la civilisation progressive de l’Europe » et « la civilisation stationnaire de la Chine ») ; d’autre part, il sous-entend qu’il n’existe qu’une seule civilisation, qu’un seul progrès (« au point de vue de la civilisation générale »). Il semble assez évident par ailleurs qu’aux yeux de l’auteur, l’Europe ouvre la voie de la Civilisation, est « le monde civilisé ». Celle-ci se caractériserait avant tout par l’industrialisation.
3) Cependant, la civilisation industrielle, en se diffusant, échappe à l’Europe, se déseuropéanise :
« À l’ère de la politique européenne, a pour jamais succédé l’ère de la politique “mondiale”. » [6]
Trois foyers de puissance peuvent dores et déjà être distingués : l’Europe, l’Amérique, le Japon – ce qui préfigure ce qu’on a pris l’habitude de désigner depuis 1985 sous le nom de « Triade », quoique son inventeur y entendait autre chose [Ohmae, 1985].
On retrouve ainsi une dialectique aperçue par d’autres, notamment Élisée Reclus [cf. le billet sur « L’hégémonie de l’Europe »]. La mondialisation est un processus d’intégration et de diffusion à partir d’un centre qui débouche sur un monde polycentrique. À partir de ce constat, une question se pose pour Anatole Leroy-Beaulieu, c’est celle de la Chine. S’il advenait que la Chine connaisse le même processus de modernisation que le Japon, le Monde en serait profondément impacté :
« Que sera, dans vingt-cinq ans, dans cinquante ans, dans cent ans, le Céleste Empire ? Quelles surprises nous réserve le réveil de la Chine, si elle doit jamais secouer sa torpeur séculaire ? Que prendra-t-elle à notre Europe et que lui apportera-t-elle ? » [7]
C’est ce que résume la phrase introductive : « L’axe du monde se déplace. » L’expression est porteuse d’un discours métahistorique qui trouve son origine dans le thème médiéval de la translation imperii, qu’on trouve développé par exemple sous la plume de C. de Varigny :
« L’axe du monde se déplace. Une force inconnue, un courant irrésistible l’entraîne vers l’ouest. Sortie des hauts plateaux de l’Asie centrale, la civilisation a, dans ses étapes successives, constamment progressé vers l’Occident. […] De Balbek et de Palmyre, de Ninive et de Babylone, d’Ecbatane et de Thèbes aux cent portes, il ne reste que des ruines abandonnées. La civilisation est passée là, elle s’y est arrêtée, puis a repris sa marche vers l’Occident. Athènes, Rome, ont ensuite été ses capitales comme le sont aujourd’hui Paris, Londres et New York, comme le sera demain peut-être San Francisco, la reine du Pacifique. » [8]
Mais certains anticipent, voient déjà, au-delà de l’Amérique, l’Asie orientale émerger. L’enjeu est donc l’hégémonie mondiale et le risque pour Anatole Leroy-Beaulieu que l’Europe perde son rang est lié au facteur travail. Les avancées, qu’il juge cependant nécessaires, en faveur de l’amélioration du sort de classe ouvrière pourraient à terme nuire à la position de l’Europe.
« C’est un fait digne d’attention que le moment où le monde occidental entre en contact étroit avec l’Extrême-Orient est précisément l’heure où les doctrines socialistes tendent à diminuer la force d’endurance et la capacité de travail de l’ouvrier européen. S’il existe vraiment, pour notre avenir, un péril jaune, il est surtout croyons-nous, dans cette coïncidence. » [9]
Mais pour Paul d’Estournelle, le risque est d’avantage dans la guerre qui pourrait ravager l’Europe :
« Mais si je n’exagère le danger, il mérite cependant qu’on y réfléchisse, et qu’on en parle, car il existe et il explique, oui, la concurrence qui menace 1’Europe explique tous ses embarras, son malaise, les maux dont elle souffre ; et c’est déjà beaucoup que de s’en rendre compte ; et cette conviction seule peut apaiser bien des colères, mettre fin à bien des conflits.
Et non pas des conflits seulement d’ordre intérieur ; j’ai montré le parti que nos rivaux lointains tiraient de nos divisions, de nos grèves, mais je n’ai pensé qu’à leur concurrence en temps de paix. Avec quels avantages bien autrement grands ne s’exercerait-elle pas en temps de guerre ! S’ils profitent de nos querelles de famille, s’il suffit d’une révolte de mineurs éclatant en Angleterre pour qu’aussitôt la production et la vente des charbons japonais prenne un essor nouveau et ravisse à l’Europe les marchés qu’elle avait créés à grands frais, que serait-ce le jour où nos ouvriers au lieu de se mettre par milliers en grève sur quelques points, cesseraient partout par millions de travailler pour aller rejoindre leurs régiments ; le jour où la production de l’Europe, arrêtée subitement, laisserait le champ libre, grand ouvert, à des concurrents attentifs et tout prêts à prendre la place ! La guerre finie, les ouvriers européens trouveraient plus difficilement que jamais de l’ouvrage ; l’industrie européenne se verrait fermer un grand nombre des débouchés qui lui restent à l’étranger. Le lendemain de la guerre serait pire peut-être que la guerre elle-même ; et c’est une raison de plus pour que ceux qui pourraient d’un mot la déchaîner et qui la préparent au prix des plus écrasants sacrifices s’attachent en même temps à la prévenir ; pour qu’ils comprennent peut-être ce qu’il y aurait de noble et de grand à vouloir la rendre impossible. Et c’est pourquoi l’Europe, toute l’Europe, malgré tant de difficultés, tant de complications qui la tourmentent, n’a jamais si ardemment et sincèrement désiré la paix ; parce que la guerre ne serait pas seulement la guerre, mais le commencement de temps nouveaux, impénétrables et dont l’obscurité nous fait reculer. C’est pourquoi aussi une responsabilité bien lourde devant l’histoire pèsera sur ceux qui n’auront pas craint d’attrister cette paix, de la rendre sombre et précaire pour satisfaire d’injustes et de malheureuses ambitions. » [10]
Bibliographie
Arrault J.-B., 2007, Penser à l’échelle du Monde. Histoire conceptuelle de la mondialisation en géographie (fin du XIXe siècle/entre-deux-guerres), thèse de doctorat, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en ligne.
d’Estournelles de Constant P., 1896, « Le Péril prochain. L’Europe et ses rivaux », La Revue des Deux Mondes, n° 134, pp. 651-686.
Capdepuy V., 2008, « Proche ou Moyen-Orient ? Géohistoire de la notion de Middle East », Espace géographique, Vol. 37, N°3, pp. 225-238.
Capdepuy V., 2011, « Au prisme des mots. La mondialisation et l’argument philologique », Cybergeo, document N°576, http://cybergeo.revues.org/24903.
Leroy-Beaulieu A., 1901, « L’Asie et l’Europe », La Revue d’Asie, pp. 3-8.
Leroy-Beaulieu P., 1900, La Rénovation de l’Asie : Sibérie, Chine, Japon, Paris, Armand Colin & Cie.
Pavé F., 2007, « Paul d’Estournellles de Constant au cœur de la polémique sur le “péril jaune”. Les raisons d’un engagement intellectuel et politique, 1895-1905 », Études chinoises, vol. XXVI, pp. 285-297.
Pavé F., 2011, Le Péril jaune à la fin du XIXème siècle, fantasme ou inquiétude légitime ?, thèse de doctorat, Université du Maine, en ligne.
Pelletier P., 2011, L’Extrême-Orient. L’invention d’une histoire et d’une géographie, Paris, Gallimard, coll. « Folio histoire ».
Reclus É., 1894, « Hégémonie de l’Europe », La Société nouvelle, pp. 433-443.
de Varigny C., 1886, « San Francisco », Revue des Deux Mondes, Vol. 78, pp. 168-192.
Notes
[1] Paul d’Estournelles de Constant, 1896, « Le péril prochain. L’Europe et ses rivaux », La Revue des Deux Mondes, n° 134, p. 651]
[2] Jean-Baptiste Arrault, 2007, Penser à l’échelle du Monde. Histoire conceptuelle de la mondialisation en géographie (fin du XIXe siècle/entre-deux-guerres), thèse de doctorat, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, p. 443.
[3] Anatole Leroy-Beaulieu, 1901, « L’Asie et l’Europe », La Revue d’Asie, p. 5.
[4] Ibid., p. 8
[5] Ibid., p. 3
[6] Ibid., p. 3 – à noter l’usage des guillemets pour un adjectif qui n’est pas encore totalement familier.
[7] Ibid., p. 6
[8] C. de Varigny, « San Francisco », Revue des Deux Mondes, Vol. 78, p. 168.
[9] Anatole LEroy-Beaulieu, art. cit., p. 7.
[10] Paul d’Estournelles, art. cit., p. 686.
Annexe
Anatole Leroy-Beaulieu, 1901, « L’Asie et l’Europe », La Revue d’Asie, pp. 3-8.
« L’axe du monde moderne se déplace en même temps que la scène de l’histoire s’élargit en tous sens. C’est une de choses qui distingueront le XXe siècle des siècles qui l’ont précédé. Le mouvement d’unification de la planète, préparé par les découvertes du XVe siècle, a définitivement fait entrer le globe tout entier dans la sphère politique et économique des peuples civilisés.
À l’ère de la politique européenne, a pour jamais succédé l’ère de la politique “mondiale”. Les peuples qui veulent conserver leur rang dans le monde sont tous contraints de regarder au loin, par delà les vagues de 1’Océan et par dessus les dunes de sable du désert. Cette nécessité ne s’impose pas seulement aux quatre ou cinq grande puissances qui se disputent l’hégémonie politique ; elle s’impose, presque également, à tous les peuple, grands ou petits, anciens ou récents, qui aspirent à la fortune et qui veulent devenir ou demeurer de peuples riches. C’est, en effet, une question de bien-être ou de richesse, autant qu’une question de puissance. Pas plus à l’économiste qu’au politique, il n’est permis de s’enfermer dans les frontières d’un seul État, si étendues soient-elles. Industrie, finances, commerce, marine, les intérêts essentiels de l’Europe débordement de tous côtés l’Europe. L’avenir des nations européennes n’est plus dans notre étroite Europe. Il est au loin, sur les mers et sur les continents neufs ou en train de se renouveler, au contact de notre civilisation.
L’avenir de l’Europe et des peuples européens, il est surtout dans les deux parties du monde qui forment, avec l’Europe, notre ancien continent et qui sont, en quelque sorte, les dépendances naturelles de l’Europe civilisée, qui ouvrent, en tous cas, à l’activité européenne, depuis longtemps à l’étroit, un double et immense champ d’action.
L’Asie et l’Afrique, les efforts et les rivalités, peut-être les luttes et les conflits pour leur colonisation ou pour leur exploitation, seront, au siècle nouveau, les principaux soucis de la politique et de la diplomatie de l’Europe, que l’envahissante ambition de la grande République américaine menace déjà d’évincer du Nouveau Continent. Heureuse encore l’Europe si la grandissante concurrence du jeune colosse américain ne vient lui ravie ou lui disputer l’hégémonie politique ou économique de l’orient de notre Vieux Continent !
Asie et Afrique sont les deux mondes sur lesquels tous les esprits soucieux de l’avenir de l’Europe doivent sans cesse tenir les yeux fixés.
Aise et Afrique, disons-nous ; l’une ne doit pas faire oublier l’autre. Si grande que soit pour l’Europe, pour la France en particulier, l’importance du continent noir, l’Afrique ne saurait nous faire négliger la vieille Asie.
Si vaste qu’elle soit cette massive Afrique, si riche qu’elle semble en fécondes terres tropicales et en métaux de toutes espèces, quelques trésors cachés que puissent nous réserver ses déserts, elle est bornée et pauvre en regard de l’énorme continent asiatique.
Comparée à l’Asie et aux multitudes humaines qui se pressent dans l’Inde, en Chine, au Japon, l’Afrique semble vide. Et si l’on oppose les races et les peuples qui habitent les deux continents, la supériorité de l’Asie comme réservoir de forces matérielles ou intellectuelles ressort encore plus clairement.
Que l’on se place au point de vue économique, ou au point de vue de la civilisation générale, il faudra des générations, ou mieux, i1 faudra des sièc1es, pour que 1’homme noir puisse entrer en compétition avec l’homme jaune, et l’Afrique rivaliser de population ou de richesse avec 1’Asie.
Aussi devons-nous féliciter les hommes qui ont entrepris de nous faite connaître cette énigmatique Asie où nos savants et nos explorateurs ont déjà frayé glorieusement tant de voies nouvelles. Il importait à la France, à ses intérêts économiques, politiques, scientifiques, que nous possédions, en langue française, un organe voué à l’étude de cette immense Asie, de l’Asie moderne, de l’Asie contemporaine, de l’Asie orientale surtout, de cet Extrême-Orient qui, bon gré mal gré, s’ouvre aux produits et aux idées de l’Europe.
La rencontre, pour ne pas dire le choc de la civilisation progressive de l’Europe et de sa remuante démocratie avec la civilisation stationnaire de la Chine, figée dans ses coutumes trente ou quarante fois séculaires, sera peut-être regardée par nos arrière-neveux comme le plus grand événement de l’histoire de la planète. Qu’adviendra-t-il de cette rencontre de deux mondes si différents ? Quels en seront les résultats pour la Chine et pour l’Europe ? Dans quelle mesure le Chinois saura-t-il et voudra-t-il s’approprier les éléments essentiels de notre civilisation occidentale ? Et quels seront pour l’Europe et pour l’Amérique, pour nos sociétés modernes ct pour nos marchés occidentaux, les conséquences ou les contrecoups de l’ouverture de la Chine, c’est là, j’ose le dire, à l’heure actuelle la question capitale de l’évolution humaine.
La “Rénovation de l’Asie”, selon le titre du livre de mon neveu Pierre Leroy-Beaulieu, tel est le problème qui se dresse devant nous, problème dont personne, ni e savant, ni le politique, ni l’économiste, ni l’ouvrier dans son atelier, ni le moine lui-même dans sa cellule, peuvent se désintéresser, car la solution en importe également à la science, à la politique, à l’industrie, à la religion, et personne ne peut en mesurer d’avance les répercussions matérielles ou morales.
Cette rénovation de l’Asie, qu’a spontanément inaugurée le merveilleux développement du Japon, par qui et pour qui se fera-t-elle ? Par quelles mains ? Sera-ce par des mains européennes, des mains américaines, des mains asiatiques ? La tâche sera-t-elle partagée entre plusieurs puissances, et la France saura-t-elle en prendre sa part ? Comme l’œuvre est énorme et qu’elle sera de longue haleine, avec quels concours matériels ou intellectuels, avec quel maîtres ou quels précepteurs, grâce à quelles règles et à quelles méthodes pourra-t-elle s’effectuer ? Quels bénéfices en pourront retirer la France, l’Europe, le Monde ? Quelles appréhensions en peuvent concevoir notre race blanche et notre humanité occidentale ? Autant de questions d’une importance considérable, qui ne peuvent être tranchées a priori, qui ne sauraient être résolues que petit à petit, par l’étude patiente et scrupuleuse des faits.
L’Extrême-Orient, la Chine en particulier est le grand sphinx dressé en face du XXe siècle. Penseurs et politiques, voyageurs et missionnaires scruteront longtemps sa face jaune et muette avant de lui dérober son secret. Que sera, dans vingt-cinq ans, dans cinquante ans, dans cent ans, le Céleste Empire ? Quelles surprises nous réserve le réveil de la Chine, si elle doit jamais secouer sa torpeur séculaire ? Que prendra-t-elle à notre Europe et que lui apportera-t-elle ? Nous l’ignorons, comme l’ignorent les Chinois eux-mêmes.
L’Extrême-Orient sera-t-il pour l’Europe, une élève docile et un client fidèle, ou bien se montrera-t-il pour nous un hardi rival et un dangereux concurrent ? Les esprits les plus sagaces ne peuvent en décider ; nos yeux ne sauraient percer le mystère chinois, ni s’en détourner.
Une seule chose est hors de doute ; qu’il s’ouvre ou non à notre influence, à nos idées, à nos doctrines, à nos sciences occidentales ; qu’il sache maintenir son indépendance, renouveler ses ressources et concentrer ses forces, qu’il parvienne à acquérir une puissance en proportion de sa masse ; ou, au contraire, qu’il s’en aille peu à peu en morceaux, qu’il tombe sous la domination directe ou indirecte de l’Europe, de l’Amérique ou du Japon, les destinées de l’Empire Chinois importent à tout le monde civilisé, ou mieux à l’humanité entière.
Que nous le voulions ou non, notre sort, à nous occidentaux, dépendra pour beaucoup du sort de l’Extrême-Orient. L’homme blanc et l’homme jaune, définitivement mis en contact, se tiendront de plus en plus dans une dépendance mutuelle.
Ce n’est pas seulement la puissance et la richesse des nations européennes qui sont intéressés à révolution de la vieille mère Asie ; ce n’est pas seulement ce qui préoccupe le politique, le philanthrope ou le patriote ; c’est l’ensemble même des conditions d’existence des peuples civilisés.
Notre Europe est aujourd’hui dominée par 1e noble souci du relèvement des classes ouvrières. Philosophes et politiques, industriels et ouvriers sont d’accord pour mettre les questions sociales au premier rang de leurs préoccupations. Les syndicats, qui revendiquent bruyamment la journée de huit heures, le salaire minimum et les retraites ouvrières croient n’avoir à compter qu’avec les naturelles résistances des patrons et les habituelles indécisions des gouvernements.
Ils n’imaginent pas que le jour approche où l’Europe et 1’Amérique industrielles auront à compter avec un facteur nouveau, avec l’Extrême-Orient et avec l’homme jaune. Ce n’est pas là une des moindres questions que soulèvent l’ouverture de la Chine et l’incorporation de l’Extrême-Orient à la sphère d’activité du monde civilisé. Jusqu’ici l’Européen, l’homme blanc n’a nulle part rencontré de peuples ou de races qui puissent lui disputer le sceptre de l’industrie et l’hégémonie du travail. En sera-t-il longtemps de même ? Cette suprématie de la race blanche, qu’elle doit en grande partie à son énergie et à son labeur, l’Europe moderne et l’ouvrier contemporain sauront-ils la conserver ? Il nous faut l’espérer ; mais peut-être ne sera-ce pas sans luttes.
C’est un fait digne d’attention que le moment où le monde occidental entre en contact étroit avec l’Extrême-Orient est précisément l’heure où les doctrines socialistes tendent à diminuer la force d’endurance et la capacité de travail de l’ouvrier européen. S’il existe vraiment, pour notre avenir, un péril jaune, il est surtout croyons-nous, dans cette coïncidence.
Notre Occident, si dédaigneux des races qu’il traite d’inférieures, ne saurait impunément l’oublier ; s’il venait à perdre le goût et la faculté des rudes labeurs, s’il laissait s’affaiblir sa capacité de production, l’Extrême-Orient serait là pour recueillir notre héritage.
L’Asie ne sera pas seulement pour notre industrie et pour notre commerce un vase champ d’expansion ; elle sera, tôt ou tard, une concurrente. Aussi pouvons-nous affirmer, que politiques ou économistes, sociologues ou socialistes, tous les hommes que préoccupent les transformations sociales du monde contemporain doivent tenir les yeux ouverts sur l’évolution de l’Extrême-Orient. Ce qui est en question, sur les plages des mers de la Chine et du Japon, ce n’est pas seulement l’avenir de l’Asie et de l’homme jaune, c’est, à bien des égards, l’avenir même de l’Europe et de l’homme blanc. »