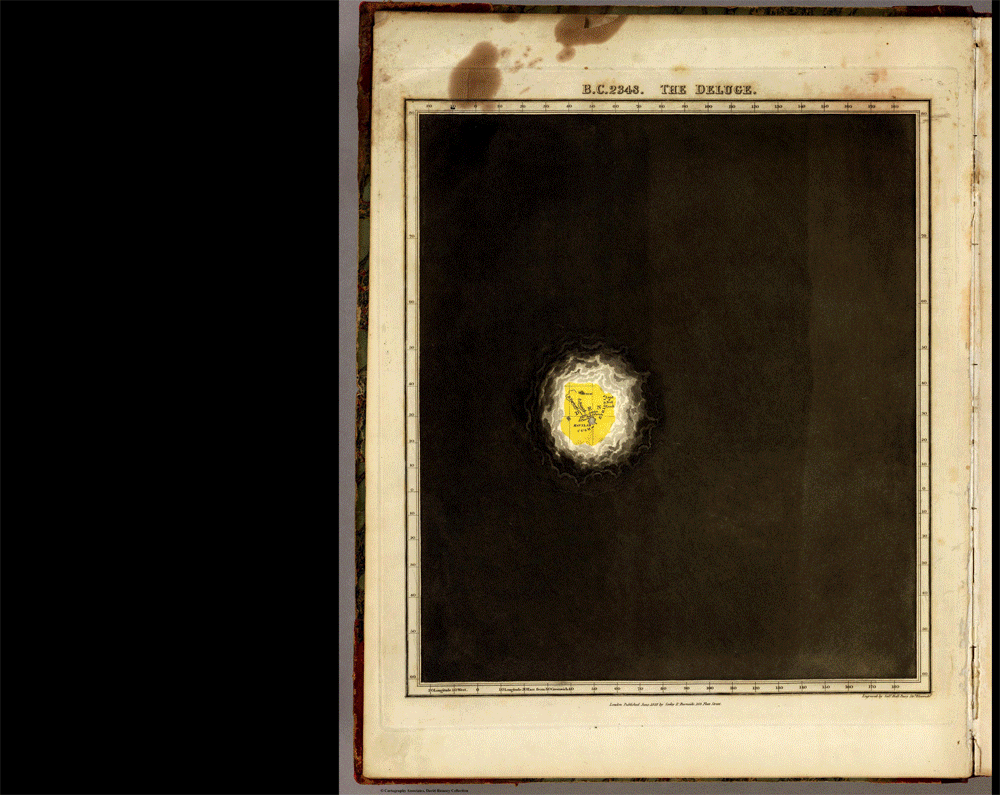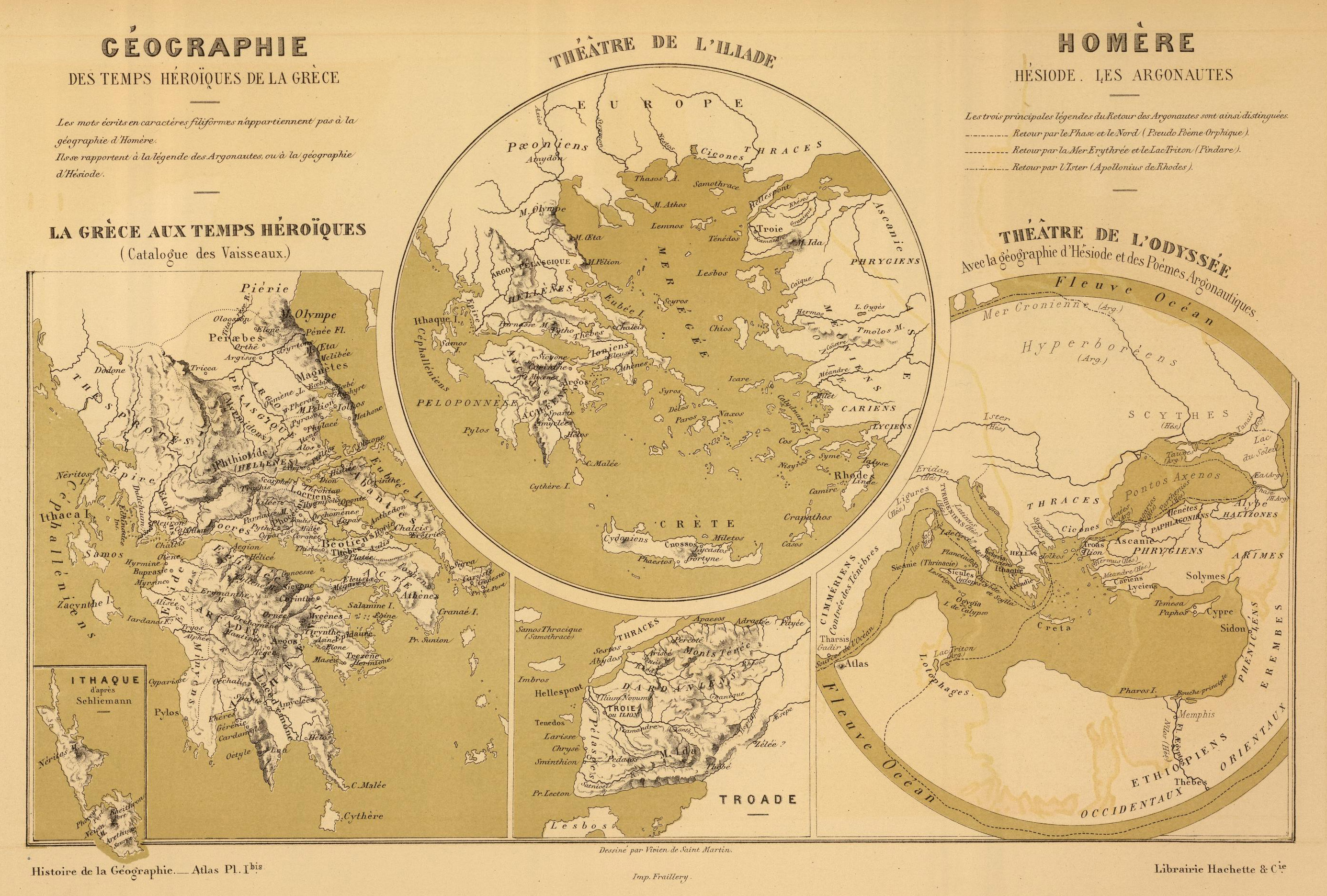Dans mon précédent billet, j’évoquai la scission qui s’était peu à peu faite, à partir du 16e siècle, entre la géographie ancienne et la géographie moderne. Les Grandes Découvertes rendirent rapidement obsolètes la géographie des Anciens, qui devenait ainsi un outil pour l’histoire. C’est ainsi, par exemple, qu’après Abraham Ortelius, Pierre Bertius publiait en 1618 un Theatrum geographiæ veteris, dans lequel il reproduisait l’édition en grec et en latin de la Géographie de Ptolémée avec les annotations de Mercator, ainsi que d’autres œuvres, comme la Table de Peutinger ou l’Itinéraire d’Antonin. La compilation d’œuvres cartographiques passées, d’abord sans ordre chronologique, mettait en lumière le progrès des connaissances cartographiques européennes et aboutit à la « géographie triomphante » du 19e siècle déjà évoquée. Mais ce croisement de l’histoire et de la géographie fut l’occasion d’une autre innovation : l’atlas historique [Hofmann, 2000 ; Goffart, 2003].
Le principe fondamental d’un ouvrage géographique dont le feuillettement même supplée la narration historique a été utilisé pour la première fois en 1651, dans le livre de Philippe de La Rue, La Terre Sainte, mais à une échelle très modeste, puisqu’il n’est composé que de six cartes, ordonnées selon le temps, de l’Exode jusqu’à « la Sourie [Syrie] d’aujourd’hui ». On retrouve le même procédé en 1705 dans le livre de Nicolas de La Mare, Traité de police, où l’auteur retrace en huit plans l’histoire de la ville de Paris, de l’époque romaine au présent. Le premier Atlas explicitement qualifié d’« historique » parut en 1705, à Amsterdam, d’un auteur anonyme, « M.C««««« », probablement Zacharie Châtelain, un huguenot ayant fui la répression de la fin du règne de Louis XIV. Toutefois, si le titre est nouveau, le contenu ne l’est guère et n’est constitué que d’une présentation conventionnelle des pays du monde. En 1705 également, parut une double carte intitulée Theatrum historicum ad annum christi quadringentesimu, « Théâtre historique en 400 de l’ère chrétienne », divisée en une Pars occidentalis et une Pars orientalis. Elle était l’œuvre de Guillaume de L’Isle (1675-1726). Comme celui-ci l’annonçait en marge, « cette carte doit être accompagnée de quelques autres, qui serviront toutes ensemble à faire voir l’état du monde connu dans les différents temps » ; mais une mort quelque peu prématurée n’a pu permettre l’achèvement de cet atlas. Dans les années 1730-1740, le cartographe Johann Matthias Hase (1684-1742), ou Johannes Hasius, réalisa plusieurs ouvrages géographico-historiques qui s’apparentent à des atlas. En 1739, il publia à Nuremberg une Regni Davidici et Salomonaei descriptio geographica et historica, una cum delineatione Syriae et Aegypti pro statu temporum sub Seleucidis et Lagidis regibus mappis luculentis exhibita, et probationibus idoneis instructa ; et en 1742, Phosphorus historiarum, vel Prodromus theatri summorum imperiorum : « Lumière de l’histoire, ou Prodrome du théâtre des plus grands empires ». Témoin également de cette dynamique historico-cartographique, un manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de France, daté de 1747 et attribué à Gilles Robert de Vaugondy (1688-1766), qui s’intitule Atlas des révolutions du globe [*]. L’ouvrage est composé de 66 cartes occupant chacune une double page et couvrant l’Eurasie, de l’Espagne à la Corée. La réalisation en reste cependant assez grossière avec de nombreuses fautes. Enfin, notons, également à l’état de manuscrit, l’œuvre de Michel Picaud de Nantes, par ailleurs inconnu, réalisée en 1763 sur la base d’un mémoire rédigé par un certain Dupré un Atlas des révolutions de l’univers représentées en trente cartes, et qui mériterait une étude approfondie.
Les atlas historiques se multiplièrent au cours du 19e siècle et s’imposèrent comme un genre en soi, bien établi aujourd’hui. Christian Grataloup dans Lieux d’histoire a souligné l’intérêt à étudier ce type d’ouvrages pour le discours géohistorique dont ils sont porteurs [Grataloup, 1996]. Parmi les atlas du début du 19e siècle, l’un se démarque par l’originalité du traitement graphique. Publié en 1830, il a été réalisé par Edward Quin (1794-1828). Le dessein de l’auteur est clairement de proposer un nouveau support à l’enseignement de l’histoire grâce à un ensemble de cartes réalisées à la même échelle afin de montrer la continuité d’un récit mondial qui est celui de l’extension de la domination européenne.
« L’idée directrice de ce volume est de présenter l’histoire connue du Monde comme un tout, plutôt que sous la forme de fragments ; et comme un ensemble cohérent et uniforme, au lieu de parties dessinées selon des proportions variables, et des plans différents, voire opposés.
Quel a été le système commun dans l’instruction de la jeunesse en ce qui concerne cette partie du savoir humain ? Habituellement, on met dans les mains d’un jeune étudiant une Histoire de la Grèce, une autre de Rome, peut-être une de l’Angleterre, et parfois un ou deux volumes d’Histoire universelle, qui, de par son caractère compressée, n’a que peu d’intérêt. Il arrive même que ces récits puissent être accompagnés de quelques cartes, chacune dessinée selon une échelle différente, et se rapportant à une période différente. Et après avoir traversé cette courte formation, dont il est à craindre qu’elle comprenne tout ce que le plus grand nombre des écoliers reçoit, quelles idées de l’histoire du Monde l’écolier garde-t-il ? […] En bref, quelle idée générale peut-il avoir des grandes lignes de l’histoire, quand son attention a été dirigée seulement vers un ou deux points de la surface terrestre, et ce durant une période donnée ?
Il n’est pas souhaitable de sous-évaluer ou de rejeter le fait de présenter à la jeunesse des histoires magnifiques et animées de la Grèce antique et de Rome. Mais dans le même temps, il faut concéder que les passages intéressants ne sont que des fragments, et que si l’attention de l’élève est occupée complètement ou en partie avec eux, il est probable qu’il ne conçoive qu’une idée très imparfaite ou erronée de l’histoire universelle. »[1]
Pour pallier cet enseignement fragmentaire, à la fois discontinu et difforme, Edward Quin proposait une série de vingt-et-une cartes réalisées selon la même échelle, mais partiellement couvertes de nuages noirs selon une logique de dévoilement afin de montrer l’élargissement progressif de la Civilisation, confondue avec une histoire européenne. Les choix graphiques explicitent cette dichotomie civilisation / barbarie :
« Il y a toujours eu, à chaque âge du monde, des parties de la terre non pas inconnues, mais classées, par leur manque de civilisation, de gouvernement régulier, et aux limites connues et reconnues, sous le terme général de pays barbares. Telle était la Scythie durant toute l’Antiquité, tel est l’intérieur de l’Afrique aujourd’hui.
Maintenant, en distinguant les royaumes successifs de la terre dans nos cartes par des couleurs appropriées, il était évidemment impossible d’assigner une couleur distincte à ces parties. Les couleurs que nous avons utilisées généralement pour désigner et distinguer un État ou un Empire d’un autre, et à montrer leurs limites respectives et l’étendue de leur domination, étaient inutilisables pour les déserts peuplés de tribus n’ayant aucune forme stable de gouvernement, ou d’existence politique, ou de limites territoriales connues. Ces types de pays cependant, nous les avons couverts de la même manière à toutes les périodes par un ombrage olivâtre, que l’œil de l’étudiant repérera vite sur les marges de toutes les cartes, et qui désigne à travers toute l’œuvre, les pays barbares et non civilisés auxquels nous avons fait allusion. »[2]
L’atlas se présente ainsi :
Figure 1. L’Atlas historique animé (cliquez pour agrandir), légende des cartes en annexe, David Rumsey Map Collection.
L’animation donne à voir l’atlas comme aucun feuilletage ne pourrait le faire et révèle véritablement l’intention de son auteur : un discours géohistorique du monde. Le terme de « géohistoire » n’est pas un abus ici ; l’auteur lui-même souligne sa volonté de combiner les deux disciplines, ce qui est au demeurant le propre des atlas historiques :
« Chaque carte successive combine donc, en un seul regard, à la fois la Géographie et l’Histoire de l’âge auquel elle se réfère, montrant par son étendue les limites du monde connu, et par ses couleurs les empires respectifs en lesquels le monde est distribué. » [3]
Reste l’originalité même de cet atlas, à savoir le choix de masquer une partie des cartes par des nuages. L’auteur s’en explique dans la préface :
« En faisant ainsi, nous n’oublions pas que les faits réels de la géographie de la terre à ces périodes sont les mêmes qu’aujourd’hui, que la Chine et l’Amérique existaient autant à l’époque de Cyrus qu’à présent, bien qu’inconnues de la plus grande partie des êtres humaines civilisés. Aussi, nous ne devons pas omettre ces pays de nos cartes, bien qu’ils n’eussent pas d’existence, et pourtant nous n’avons pas à les montrer, comme formant une partie du monde connue à l’âge délimité. »[4]
Cette présentation appelle deux critiques. La première est inspirée de la réflexion séminale de Christian Grataloup, à l’orée de Lieux d’histoire :
« L’intention est de ne point se satisfaire d’une sorte de projection de diapositives : l’Histoire produisant de nouvelles configurations géohistoriques que des images, des cartes, enregistrent et donnent à voir. Peut-être les configurations mêmes sont-elles des facteurs de ces changements comme elles peuvent l’être des permanences. Cette hypothèse de l’espace en tant qu’acteur, nous allons l’éprouver. »[5]
La géographie n’est pas simplement l’« œil de l’histoire », pour reprendre l’expression d’Abraham Ortelius, elle ne se limite pas au travail cartographique et à la simple localisation des lieux de l’histoire. La spatialisation doit au contraire aboutir, parfois par l’abstraction et par l’expression schématique, à une véritable géographicisation de l’analyse historique, c’est-à-dire à la mise en lumière des différents facteurs (espaces, milieux, territoires) et des différents acteurs (individus, groupes sociaux, États…) qui constituent le système spatial d’un lieu. De ce point de vue, un atlas historique est un outil pratique, mais il n’est que cela.
La deuxième critique s’appuie sur la réflexion d’un autre géographe, James M. Blaut, développée dans The Colonizer’s Model of the World. L’Atlas historique de Quin fournit en effet une magnifique illustration de ce que Blaut a appelé l’« histoire-tunnel », fondée sur une logique dedans/dehors.
« C’est l’idée que le Monde a un intérieur et un extérieur. Jusqu’à présent, l’histoire mondiale a été, pour l’essentiel, l’histoire de l’intérieur. L’extérieur a été, généralement, considéré comme sans importance. L’histoire et la géographie historique, telles qu’elles ont été enseignées, écrites et pensées par les Européens jusqu’à l’époque de la Seconde Guerre mondiale, et encore (comme nous le verrons) à bien des égards aujourd’hui, se situent, en quelque sorte, dans un tunnel de temps. Les murs imaginaires de ce tunnel sont les limites de la Grande Europe. L’histoire consiste à chercher, dans un sens ou dans l’autre, à l’intérieur de ce tunnel temporel européen et à décider de ce qui arrive, où, quand et pourquoi. “Pourquoi” évidemment implique des connexions avec des événements historiques, mais seulement les événements qui se situent dans le tunnel européen. À l’extérieur de ces murs, tout semble réduit à une tradition immuable, sans temps, sans changement. J’appellerai cette manière de penser “la vision historique tunnel”, ou tout simplement “l’histoire tunnel”. »[6]
Au final, l’Atlas historique de Quin est autant un document pour l’historiographie globale que pour l’histoire globale. D’une part, il montre comment s’est écrit un Grand Récit de la civilisation européenne, un « roman civilisationnel » qui continue de former l’arrière-plan de l’appréhension occidentale de l’histoire du Monde. D’autre part, ce récit cartographique participe de l’histoire globale elle-même comme discours justificateur de l’impérialisme européen. Ce billet complète donc bien le précédent dans l’étude de la place de la cartographie européenne dans ce « vol de l’histoire » dénoncé par Jack Goody [Goody, 2010].
Alors bien sûr, aujourd’hui, ce document doit être pris avec la distance qui s’impose et qui sied à l’historien. Deux siècles, ou presque, après, cet atlas est un objet d’histoire. L’Europe a tourné la page de la colonisation. C’est un fait. Pourtant, comparons un instant ce récit géohistorique aux programmes actuels de collège.
| Classe de sixième |
|---|
| I. L’Orient ancien |
| II. La civilisation grecque |
| III. Rome |
| IV. Les débuts du judaïsme et du christianisme |
| V. Les empires chrétiens du haut Moyen Âge |
| VI. Regards sur les mondes lointains |
| Classe de cinquième |
|---|
| I. Les débuts de l’islam |
| II. L’Occident féodal, XIe – XVe siècle |
| III. Regards sur l’Afrique |
| IV. Vers la modernité, fin XVe – XVIIe siècle |
| Classe de quatrième |
|---|
| I. L’Europe et le monde au XVIIIe siècle |
| II. La Révolution et l’Empire |
| III. Le XIXe siècle |
| Classe de troisième |
|---|
| I. Un siècle de transformations scientifiques, technologiques, économiques et sociales |
| II. Guerres mondiales et régimes totalitaires (1914-1945) |
| III. Une géopolitique mondiale (depuis 1945) |
| IV. La vie politique en France |
Dans le détail, le contenu de l’enseignement est bien sûr différent, mais dans ses grandes lignes, si on laisse de côté l’histoire du 20e siècle qui ne peut pas être prise en compte dans la comparaison, le récit s’inscrit dans la même logique. On observe même des reculs, comme l’attention portée aux invasions mongoles et à la « pax mongolica » ; lorsqu’on voit toute l’importance accordée aujourd’hui à un événement comme la mort de Tamerlan en 1405 [Darwin, 2007], on peut émettre ne serait-ce qu’un regret…. Tout juste, a-t-on fait un peu de place à des « regards », c’est le terme utilisé, vers l’extérieur du tunnel : la Chine, l’Afrique. Et pourtant, ce petit pas de côté a été critiqué, l’Inspection générale a été attaquée, accusée de brader l’histoire nationale[7]. Ceci rappelle, il y a près d’un demi-siècle, les difficultés à mettre en œuvre le programme de terminale de 1957, modifié en 1959, qui était défini par l’étude de plusieurs civilisations : le monde occidental, le monde communiste européen, le monde musulman, le monde de l’océan Indien et de l’océan Pacifique, le monde africain noir. Ceci avait été l’occasion pour Fernand Braudel de rédiger un chapitre de manuel, « Une grammaire des civilisations » [Braudel, 1963], qui connut un regain de notoriété après sa réédition à part en 1987. Mais à l’époque, ce programme fut rapidement allégé des questions portant sur les civilisations extra-européennes dès 1966-1967 pour des raisons soi-disant d’évaluation [Legris, 2010].
On prend alors conscience de l’ampleur de la tâche pour ceux qui voudraient renouveler l’enseignement de l’histoire en France, ouvrir les fenêtres et y faire entrer un peu de globalité ; et pas seulement par l’extrémité du temps présent : la mondialisation est un processus beaucoup plus ancien et les intrications des sociétés, multiséculaires. L’histoire globale se doit de dissiper ces nuages qui continuent d’obscurcir notre vision pour permettre la « déclosion du monde » [Mbembe, 2010].
1) Carte recouverte de nuages montrant la terre connue de la Création jusqu’au Déluge, 2348 av. J.-C. (1646 Anno Mundi). Première période. L’Éden est montré à travers les nuages avec le mont Ararat et la Terre de Nod.
2) Carte recouverte de nuages montrant la terre connue du Déluge, 2348 av. J.-C., jusqu’à l’Exode des Israélites, 1491 av. J.-C. (de 1656 A.M. à 2513). Deuxième période. Au travers des nuages, la carte montre en couleurs les empires et les pays: l’Empire Assyrien, la Syrie, Canaan et l’Égypte.
3) Carte recouverte de nuages montrant la terre connue de l’Exode des Israélites, 1491 av. J.-C., jusqu’à la fondation de Rom, 753 av. J.-C. (de 2513 A.M. à 3251). Troisième période. Au travers des nuages, sont visibles en couleurs les régions précédentes ainsi que l’Asie Mineure, la Grèce et l’Italie.
4) Carte recouverte de nuages montrant la terre connue de la fondation de Rome, 753 av. J-C., jusqu’à la mort de Cyrus, 529 av. J.-C. (de 3251 A.M. à 3475). Quatrième période. Au travers des nuages, est visible en couleurs la Méditerranée, de l’Italie jusqu’à la Perse.
5) Carte avec des nuages laissant voir la terre connue de la mort de Cyrus, 529 av. J.-C., jusqu’à celle d’Alexandre de Macédoine, 323 av. J.-C. (de 3475 A.M. à 3681). Cinquième période. En couleurs avec l’Empire macédonien en cramoisi.
6) Carte avec des nuages laissant voir la terre connue de la mort d’Alexandre de Macédoine, 323 av. J.-C., jusqu’à la partition de l’Empire, 301 av. J.-C. (de 3681 A.M. à 3703). Sixième période. En couleurs avec la plus grande partie en bleu montrant l’étendue de l’Empire.
7) Nuages laissant voir la terre connue de la partition de l’Empire d’Alexandre, 301 av. J.-C., jusqu’à la fin de la Troisième Guerre punique. Septième période. En couleurs s’étirant de l’Espagne et du Maroc jusqu’à la Chine. La Grande Muraille de Chine est visible.
8 ) Nuages laissant voir la terre connue de la fin de la Troisième Guerre punique, 146 av. J.-C., jusqu’à la naissance du Christ (de 3853 A.M. à 4004). Huitième période. En couleurs s’étirant de l’Irlande et du Maroc jusqu’à la Chine. L’Empire romain est visible en jaune, l’Empire parthe en vert, l’Hindoustan en gris et la Chine en marron clair.
9) La Terre connue des Européens visible à travers des nuages de la naissance du Christ jusqu’à la mort de Constantin, 337 apr. J.-C. En couleurs de la Scandinavie et du Maroc jusqu’à la Corée.
10) La Terre connue des Européens visible à travers des nuages de la mort de Constantin, 337 apr. J.-C., jusqu’à la division de l’Empire romain en deux, à la mort de Théodose, 395 apr. J.-C. En couleurs, couvrant de la Scandinavie et du Maroc jusqu’à la Corée. L’Empire romain d’Occident et l’Empire romain d’Orient sont montrés par des couleurs différentes.
11) La Terre connue à travers des nuages de la division de l’Empire romain en deux, à la mort de Théodose, 395 apr. J.-C., jusqu’à la dissolution de l’Empire d’Occident, 476 apr. J.-C. Onzième période. L’Empire romain d’Occident est maintenant identifié en pourpre comme les « Nations nordiques ».
12) Le monde connu à travers des travers de la dissolution de l’Empire d’Occident, 476 apr. J.-C., jusqu’à la mort de Charlemagne, 814 apr. J.-C. Douzième période. Trois empires sont identifies: l’Empire de Charlemagne (jaune), l’Empire grec (jaune-vert) et l’Empire mahométan (vert).
13) Le monde connu montré à travers des nuages de la mort de Charlemagne, 814 apr. J.-C., jusqu’à la dissolution de son empire, 912 apr. J.-C. Treizième période. Des pays en Europe commencent à émerger et la masse terrestre au-dessus de la Scandinavie est montrée pour la première fois.
14) Le monde connu montré à travers des nuages de la dissolution finale de l’Empire de Charlemagne, 912 apr. J.-C., jusqu’à la Première Croisade, 1100 apr. J.-C., Quatorzième période. La carte est dominée par l’Empire germanique, les États mahométans et la Chine. Le Groenland peut être vu dans le coin supérieur gauche.
15) Le monde connu montré à travers des nuages du commencement des Croisades, 1100 apr. J.-C., jusqu’à la division de l’Empire mongol, à la mort de Kubilaï, 1292 apr. J.-C. Quinzième période. L’Empire de Kubilaï khan, en vert olive, domine plus de la moitié de la carte, s’étendant de la Hongrie jusqu’à la Mongolie et la mer de Chine.
16) La carte dépliée montre des nuages aux angles et décrit le monde connu depuis la division de l’Empire mongol, 1294 apr. J.-C., jusqu’à la découverte de l’Amérique, 1498 apr. J.-C. Seizième période. L’Afrique est montrée en entier pour la première fois et la côte oriental de l’Amérique, du Newfoundland jusqu’au bord septentrional de l’Amérique du Sud. Les Indes occidentales sont montrées en bleu.
17) La carte dépliée montre des nuages aux angles et décrit le monde connu depuis la découverte de l’Amérique, 1498 apr. J.-C., jusqu’à la mort de Charles V de Germanie, 1551 apr. J.-C. Dix-septième période. L’Amérique du Sud et les parties orientales et méridionales de l’Amérique du Nord ne sont plus couvertes de nuages. Les Philippines sont aussi visibles.
18) Des nuages sont seulement visibles en bordure de la carte, qui décrit le monde connu depuis la mort de Charles V de Germanie, 1558 apr. J.-C., jusqu’à la restauration des Stuarts en Angleterre, 1660 apr. J.-C. Dix-huitième période. L’Australie est incluse ainsi que les baies d’Hudson et de Baffin (avec d’importantes distorsions). La partie septentrionale de la Sibérie a été découverte.
19) Le monde entier est visible, sans nuage, pour la première fois. Les divisions politiques sont montrées depuis la restauration des Stuarts en Angleterre, 1660 apr. J.-C., jusqu’à l’indépendance des États-Unis d’Amérique, 1783 apr. J.-C. Dix-neuvième période. La région septentrionale du Canada n’a pas été explorée et a été laissée en blanc.
20) Le monde connu depuis l’indépendance des États-Unis d’Amérique, 1783 apr. J.-C., jusqu’à la plus extension de l’Empire français, 1811 apr. J.-C. Douzième période.
21) Le monde connu depuis la plus grande extension de l’Empire français, 1811 apr. J.-C., jusqu’à la fin de la paix générale, 1828 apr. J.-C. Vingt-et-unième période.
Bibliographie
Blaut J.M., 1993, The Colonizer’s Model of the World. Geographical Diffusionism and Eurocentric History, New York, The Guilford Press.
Braudel F., 1963, « Une grammaire des civilisations », in Baille S., Braudel F. & Philippe R., Le Monde actuel. Histoire et civilisations, Paris, Belin, pp. 143-475 ; réédition : Braudel F., 1987, Grammaire des civilisations, Paris, Arthaud/Flammarion.
Darwin J., 2007, After Tamerlane. The Global History of Empire, Londres, Allen Lane.
Goffart W.A., 2003, Historical Atlases. The First Three Hundred Years, 1570-1870, , Chicago/Londres, University of Chicago Press.
Goody J., 2010, Le Vol de l’histoire. Comment l’Europe a imposé le récit de son passé au reste du monde, trad. de l’anglais par F. Durand-Bogaert, Paris, Gallimard [éd. orig. 2006].
Grataloup C., 1996, Lieux d’histoire. Essai de géohistoire systématique, Montpellier, GIP / Reclus.
Hofmann C., 2000, « La genèse de l’atlas historique en France (1630-1800) : pouvoirs et limites de la carte comme “œil de l’histoire” », Bibliothèque de l’école des chartes, Vol. 158, N°1, pp. 97-128.
Legris P., 2010, L’Écriture des programmes d’histoire en France (1944-2010). Sociologie historique d’un instrument de politique éducative, thèse de doctorat, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, disponible sur le site Hal-SHS.
Mbembe A., 2010, Sortir de la grande nuit, Paris, La Découverte.
Quin E., 1830, An Historical Atlas, Londres, L.B. Seeley & Sons.
Notes
[1] Edward Quin, 1830, An Historical Atlas, Londres, L.B. Seeley & Sons, p.1.
[2] Ibid.
[3] Ibid., p. 2.
[4] Ibid., p. 1
[5] Christian Grataloup, Lieux d’histoire. Essai de géohistoire systématique, GIP Reclus, Montpellier, 1996, p. 9.
[6] James M. Blaut, 1993, The Colonizer’s Model of the World. Geographical Diffusionism and Eurocentric History, New York, The Guilford Press, p. 5.
[7] Patricia Legris, « L’introduction controversée des civilisations extra-européennes dans les programmes d’histoire », sur le site Aggiornamento Histoire Géographie.