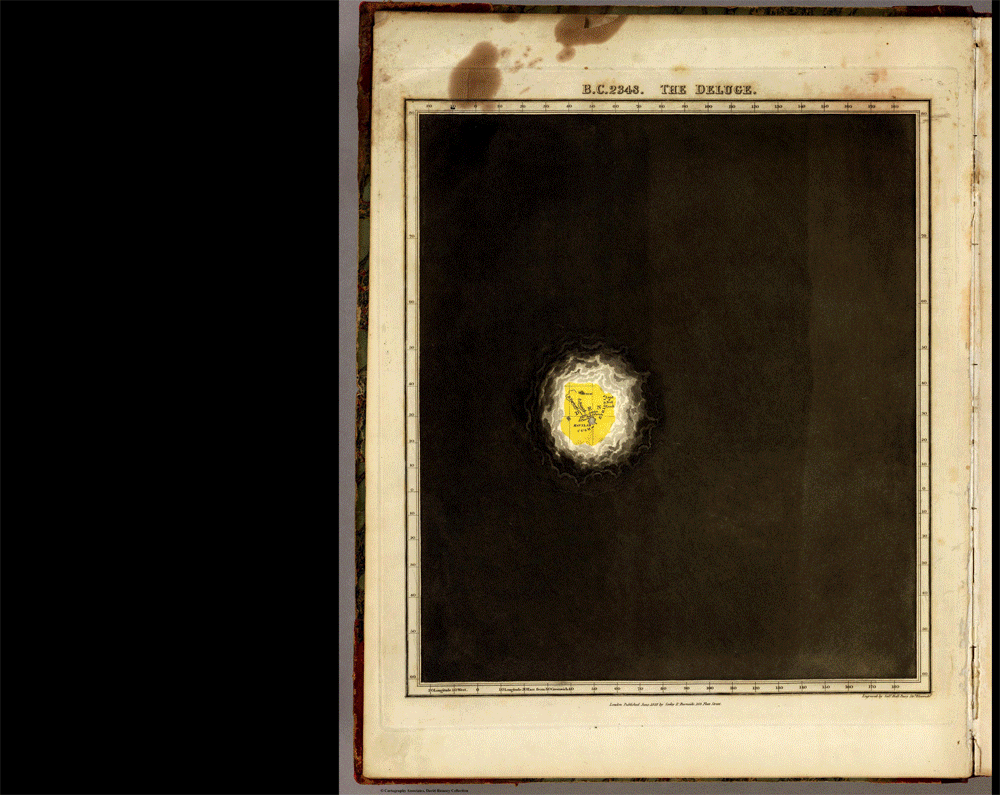Cahiers d’histoire, « Pourquoi l’histoire globale ? », n° 121, avril-juin 2013 [texte intégral en ligne]
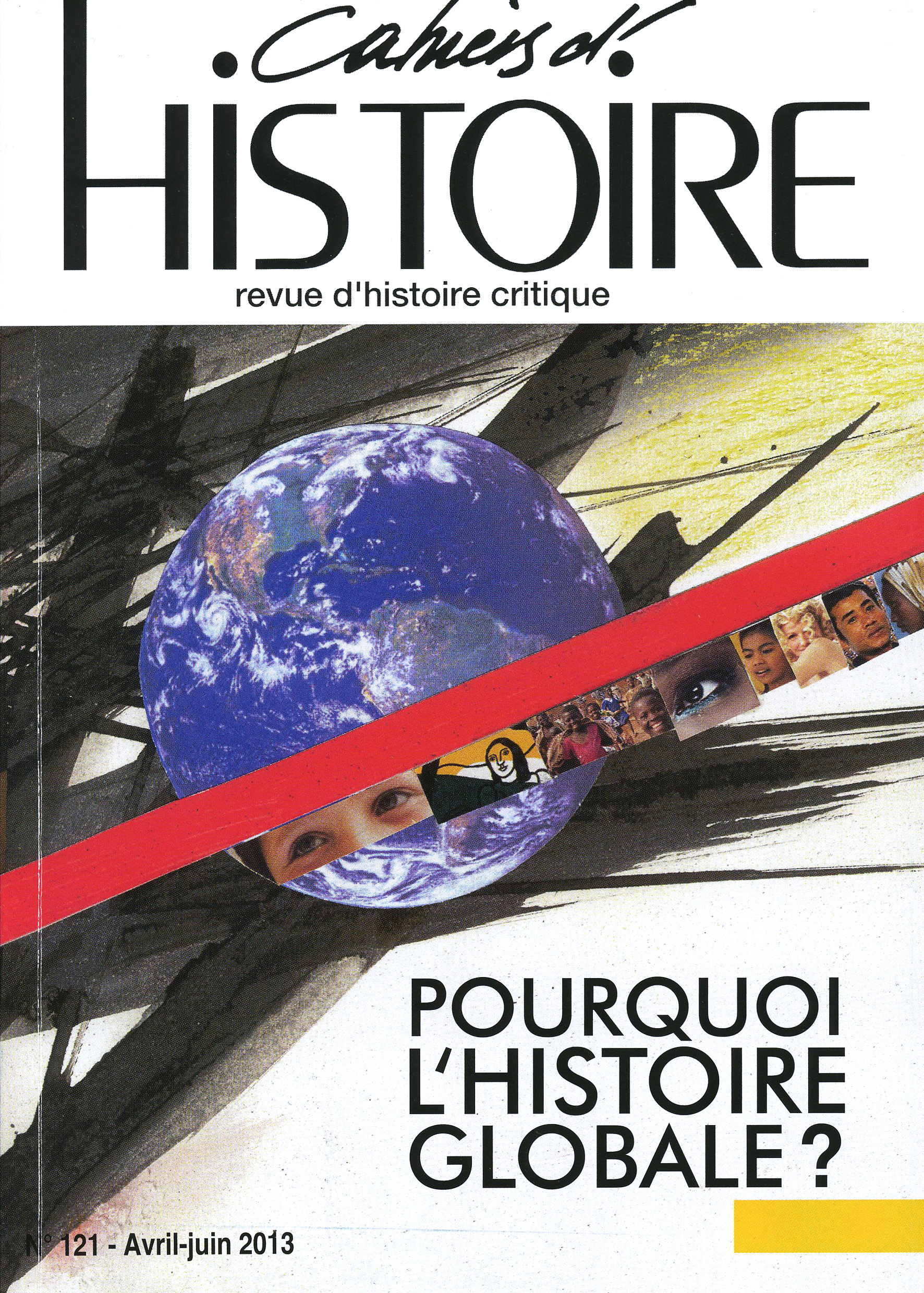 Dans son introduction « Pourquoi l’histoire globale ? », Chloé Maurel fait le constat de la multiplication des publications et de l’institutionnalisation de cette histoire par la création de chaires, essentiellement dans le monde anglo-saxon. Mais d’emblée, un doute surgit lorsqu’elle cite la World History Association, fondée en 1982, et le Journal of World History, créé en 1990. S’agit-il là bien d’histoire globale ? Les exemples cités pour la France, des Traites négrières. Essai d’histoire globale (2004) au numéro de la revue Actuel Marx consacré à l’histoire globale (2013) sont plus probants, quoiqu’on puisse discuter de la dimension globale de l’ouvrage d’Olivier Pétré-Grenouilleau. Qu’est-ce alors l’histoire globale ? On pourrait assez facilement agréer la réponse apportée : « Un ensemble large de méthodes et de concepts, incluant plusieurs sous-courants comme l’histoire comparée, l’histoire des transferts culturels, l’histoire connectée, l’histoire croisée, l’histoire transnationale… » [p. 14]. Que l’histoire globale emprunte à d’autres histoires, il n’y a aucun doute. Si on considère la mondialisation comme un processus complexe de mise en interconnexions des différentes parties du globe, il est tout à fait normal que l’histoire globale recoupe, outre les champs de recherches déjà cités, ceux d’histoire culturelle, d’histoire économique, d’histoire sociale, d’histoire politique ou d’histoire environnementale. Les méthodes et les facettes de l’histoire globale sont nombreuses et on pourrait jusqu’à dire qu’elle est doublement globale : globale au sens ancien du terme, dans la lignée de l’école des Annales, et globale aussi dans un sens que Chloé Maurel délaisse quelque peu. Car quelle est donc cette globalité ? La question demeure en suspens. Selon elle, l’histoire globale serait d’abord « une boîte à outils utile » : par le décentrement du regard, par les comparaisons, par l’échelle mondiale. C’est vrai ; mais si la mondialisation n’est évoquée, ce n’est qu’en passant, à propos des délocalisations, des multinationales. Pourtant, on pourrait défendre l’idée que l’essence même de l’histoire globale est dans son objet d’étude. Ce qui fait, en passant, qu’elle ne prétend pas être toute l’histoire. Aussi constatons-nous encore une fois ce désaccord qui s’installe entre ceux qui ne voient dans l’histoire globale qu’une manière d’approcher l’histoire mondiale, au risque de la rendre complètement floue, et ceux qui défendent l’idée que l’histoire globale, née de la mondialisation, est le rétroviseur de notre société : la volonté d’expliquer la mondialité contemporaine.
Dans son introduction « Pourquoi l’histoire globale ? », Chloé Maurel fait le constat de la multiplication des publications et de l’institutionnalisation de cette histoire par la création de chaires, essentiellement dans le monde anglo-saxon. Mais d’emblée, un doute surgit lorsqu’elle cite la World History Association, fondée en 1982, et le Journal of World History, créé en 1990. S’agit-il là bien d’histoire globale ? Les exemples cités pour la France, des Traites négrières. Essai d’histoire globale (2004) au numéro de la revue Actuel Marx consacré à l’histoire globale (2013) sont plus probants, quoiqu’on puisse discuter de la dimension globale de l’ouvrage d’Olivier Pétré-Grenouilleau. Qu’est-ce alors l’histoire globale ? On pourrait assez facilement agréer la réponse apportée : « Un ensemble large de méthodes et de concepts, incluant plusieurs sous-courants comme l’histoire comparée, l’histoire des transferts culturels, l’histoire connectée, l’histoire croisée, l’histoire transnationale… » [p. 14]. Que l’histoire globale emprunte à d’autres histoires, il n’y a aucun doute. Si on considère la mondialisation comme un processus complexe de mise en interconnexions des différentes parties du globe, il est tout à fait normal que l’histoire globale recoupe, outre les champs de recherches déjà cités, ceux d’histoire culturelle, d’histoire économique, d’histoire sociale, d’histoire politique ou d’histoire environnementale. Les méthodes et les facettes de l’histoire globale sont nombreuses et on pourrait jusqu’à dire qu’elle est doublement globale : globale au sens ancien du terme, dans la lignée de l’école des Annales, et globale aussi dans un sens que Chloé Maurel délaisse quelque peu. Car quelle est donc cette globalité ? La question demeure en suspens. Selon elle, l’histoire globale serait d’abord « une boîte à outils utile » : par le décentrement du regard, par les comparaisons, par l’échelle mondiale. C’est vrai ; mais si la mondialisation n’est évoquée, ce n’est qu’en passant, à propos des délocalisations, des multinationales. Pourtant, on pourrait défendre l’idée que l’essence même de l’histoire globale est dans son objet d’étude. Ce qui fait, en passant, qu’elle ne prétend pas être toute l’histoire. Aussi constatons-nous encore une fois ce désaccord qui s’installe entre ceux qui ne voient dans l’histoire globale qu’une manière d’approcher l’histoire mondiale, au risque de la rendre complètement floue, et ceux qui défendent l’idée que l’histoire globale, née de la mondialisation, est le rétroviseur de notre société : la volonté d’expliquer la mondialité contemporaine.
L’article de Christophe Charle, « Jalons pour une histoire transnationale des universités », illustre assez bien les travers d’une absence de définition rigoureuse de l’histoire globale. Le propos se concentre en réalité seulement sur les universités européennes et leur histoire depuis le 19e siècle. La transnationalisation, qui est effectivement une dynamique forte dans la mondialisation, n’est ici étudiée qu’à l’échelle européenne. On ne comprend pas très bien en quoi ce texte constitue un exemple d’histoire globale. Sinon, en lisant les articles suivant, par l’accent mis en réalité sur l’histoire transnationale.
Katja Naumann propose de revenir sur « L’enseignement de l’histoire mondiale aux États-Unis avant William H. McNeill et son premier ouvrage The Rise of the West (1963) ». La question est celle de la nouveauté, réelle ou exagérée, de l’histoire globale. Y a-t-il rupture ou bien continuité ? Selon l’analyse de Patrick Manning, l’ouvrage de William H. McNeill The Rise of the West a constitué un tournant historiographique dans l’étude des connexions entre les civilisations en faisant la preuve qu’une histoire à l’échelle mondiale est possible et n’est pas seulement du domaine de la philosophie de l’histoire. Au contraire, l’auteure montre bien l’évolution qui s’est produite aux États-Unis depuis le début du 20e siècle dans le récit de la civilisation occidentale tel qu’il avait été écrit en Europe au cours de siècles précédents avec un élargissement aux civilisations non européennes et aux différentes facettes de l’humanité. Elle rappelle notamment l’impact des études anthropologiques durant l’entre-deux-guerres dans une remise à plat des relations entre les différentes cultures. Elle étudie de façon assez détaillée les changements qui ont lieu dans trois collèges universitaires : Columbia, Chicago et Harvard. C’est à Chicago, notamment, qu’on trouve dès les années 1940, Louis Gottschalck, Marshall G.S. Hodgson et William H. McNeill. Les deux premiers contribuèrent après guerre à L’Histoire de l’humanité de l’Unesco. En minimisant la rupture entre histoire mondiale et histoire globale, et en retraçant cette généalogie de l’histoire globale comme un processus proprement états-unien, Katka Naumann entend surtout montrer que le polycentrisme programmatique de l’histoire globale serait contredit par son élaboration au sein de la puissance hégémonique. Elle en arrive ainsi à la conclusion que d’autres histoires mondiales/globales sont possibles, en accord avec les traditions historiographiques nationales, régionales ou locales. N’est-ce pas réduire la dimension transnationale qui a préposé à l’élaboration d’une histoire globale au demeurant multiple ?
Matthias Middell s’interroge quant à lui sur « L’histoire mondiale/globale en Allemagne ». Le titre même de son article révèle l’ambiguïté soulevée au début de notre critique, mais pour s’y attaquer. Les premiers paragraphes sont très fermes là-dessus. La question de la pertinence à parler d’histoire globale à propos des nouvelles recherches sur la guerre de Sept Ans est très juste. Comme il l’écrit, « ce qui fait des auteurs de ces études des global historians, ce n’est évidemment pas seulement leur connaissance des pays lointains et de leurs interdépendances, mais le fait de poser des questions qui ne relèvent pas seulement de leur statut d’expert en exotisme, mais d’apporter une contribution au problème non encore résolu de savoir jusqu’où faire remonter la mondialisation actuelle que nous scrutons si attentivement, et ce que nous pouvons faire d’une telle tradition ». Cependant, il pointe du doigt d’une part les réticences politiques que certains peuvent avoir à l’égard de l’histoire globale, comme instrument de légitimation politique pour les acteurs qui appellent à davantage de mondialisme contre les nationalismes de tous poils, d’autre part le manque de reconnaissance par les historiens eux-mêmes qui reprochent aux chercheurs en histoire globale de ne faire que du travail de seconde main et d’enfreindre ainsi les règles établies de la recherche historique, à savoir l’analyse minutieuse d’archives dans un champ clos dont l’historiographie est parfaitement maîtrisée – sans parler des craintes que les historiens du global ne nourrissent des ambitions hégémoniques sur l’ensemble de l’histoire ! Après cette introduction, Matthias Middell s’attarde plus précisément sur l’histoire globale en Allemagne, sur son institutionnalisation tardive, mais réelle, et sur sa subsomption par l’histoire mondiale. Mais c’est sur l’histoire transnationale qu’il conclut. Celle-ci apparaît finalement comme un moyen de résoudre les tensions épistémologiques créées par l’histoire globale. Si le cadre national est appelé à être dépassé, le travail historique, quant à lui, n’est pas fondamentalement remis en question. L’étude des sociétés ne peut plus se faire sans prendre en considération les interactions avec les autres sociétés. Difficile de ne pas souscrire à un tel programme, mais si l’histoire globale peut se nourrir de telles recherches et appelle à un tel dépassement, elle ne s’y réduit pas.
On retrouve le même glissement dans le texte d’Akira Iriye, « Réflexions sur l’histoire globale et transnationale ». L’article commence par une réflexion anecdotique mais intéressante sur l’utilisation relativement tardive par l’auteur de la notion de « globalization ». Il paraît en effet nécessaire de remettre au centre la notion de mondialisation pour expliquer l’émergence de l’histoire globale. L’auteur rappelle bien également les enjeux qu’il y a à développer un enseignement d’histoire globale permettant de dépasser les perspectives uniquement nationales, au risque de créer des tensions, ce qu’on connaît bien ici (cf. la tribune que j’avais publiée dans les Carnets d’Aggiornamento, « L’oubli du monde »). On restera toutefois plus réservé lorsque l’auteur reprend l’idée que la Première Guerre mondiale marque le début d’une démondialisation, analyse qui s’appuie sur une définition essentiellement économique de la mondialisation quand il faudrait, à mon sens, prendre en considération l’ensemble des flux qui mettent en interconnexion les différentes parties de l’espace-Monde. Toujours à propos de ce premier temps de la mondialisation qui irait, en gros, du milieu du 19e siècle au milieu du 20e, Akira Iriye s’interroge par ailleurs sur les liens qui existent entre mondialisation, occidentalisation, modernisation et impérialisme : peut-on parler de mondialisation pour désigner le processus de domination européenne/occidentale sur le reste du Monde et de transformation socio-économique de celui-ci ? Aussi, selon lui, n’est-ce qu’à la fin du 20e siècle que « la mondialisation s’étendit à l’ensemble de la planète » et que, corrélativement, l’intérêt pour l’histoire globale se développa et qu’on distingua celle-ci de l’histoire mondiale. Il n’est pas anodin qu’Akira Iriye et Bruce Mazlich aient assuré ensemble le cours d’histoire globale à l’université de Harvard de 2001 à 2003. Tous deux défendent l’idée que l’histoire globale porte avant tout sur l’histoire récente. L’auteur, qui, avec Pierre-Yves Saunier, a codirigé le Palgrave Dictionary of Transnational History (2006), en vient alors à développer la pertinence de l’histoire transnationale, qu’on peut considérer comme faisant partie de l’histoire globale, ou comme un champ historiographique en soi, sécant avec l’histoire globale. « L’émergence d’une histoire transnationale suggère une prise de conscience que la nation n’est plus (si elle l’a jamais été) l’unique paramètre de l’identité humaine ou le cadre principal des affaires humaines. Tout individu est un être local et global, avec des identités multiples, dont certaines se comprennent mieux dans le cadre de la nation, et d’autres à travers les appartenances de sexe, de religion, de race, de classe sociale ou d’âge. » L’histoire transnationale peut donc être considérée comme transcalaire, mais aussi ascalaire, elle n’a pas pour objectif premier de comprendre le Monde comme espace et comme société globale. Elle est surtout une méthode pour casser le carcan des nations, ce qui amène Akira Iriye à plaider en faveur de la notion d’« hybridité », qui correspondrait dans l’historiographie française à celle de « métissage ».
Dans « Histoire globale et organisations internationales », Thomas G. Weiss présente la vaste histoire intellectuelle des Nations unies qu’il a coordonnée entre 1999 et 2010. La question posée est assez intéressant, la réponse pas toujours convaincante, mais probablement par manque de place. Les idées de l’Onu ont-elles influencé le monde ? L’argumentation contrefactuelle, originale et rarement utilisée dans l’historiographie française, est peu probante. Si l’Onu n’avait pas été créée en 1945, elle l’aurait été plus tard sous une forme ou sous une autre… Soit. Il y a une nécessité à mettre en place une gouvernance mondiale. Comme il le reconnaît lui-même, ce besoin existe dès la fin du 19e siècle, moment où sont fondées par exemple l’Union postale universelle et l’Union internationale des télécommunications. Dans la diffusion des idées qui ont participé à mettre en forme nos représentations du monde, les différents Rapports sur le développement humain ont sans doute joué un rôle certain, mais les exemples concrets manquent et l’auteur renvoie essentiellement à l’ouvrage auquel il a participé : UN Ideas That Changed the World (2009). On pourrait penser à la notion de développement durable, définie dans le rapport Bruntland de 1987 et dont on connaît le succès planétaire. Les droits de l’homme, avec la Déclaration universelle de 1948, sont un autre exemple de ces idées qualifiées d’« onusiennes ». Même s’il est évident que la question des droits essentiels communs à tous les êtres humains s’inscrit dans une réflexion pluriséculaire, la mise en œuvre de ceux-ci à l’échelle mondiale reste un projet pour lequel l’Onu constitue une référence centrale. Cependant, Thomas G. Weiss n’est pas naïf et c’est un regard critique qu’il porte sur cette organisation internationale. Au-delà de l’influence que celle-ci a eu, la question est bien celle de l’influence qu’elle aurait pu avoir davantage si l’institution fonctionnait mieux et était plus indépendante des États.
Pour terminer ce dossier, Chloé Maurel dresse un panorama des « récents développements en histoire globale dans le monde ». Sans surprise, la confusion demeure entre histoire mondiale et histoire globale, considérées comme équivalentes. Plusieurs objets transnationaux sont listés comme autant de problématiques possibles : les maladies, la faim et la famine, les maladies, les océans, les contacts entre aires de civilisation, les migrations, le fait colonial… On ne reprendra pas ici la liste des œuvres citées. La fragmentation de l’histoire globale nous ramène à la question de ce qu’elle est. On l’avait souligné ailleurs : l’histoire globale ne peut pas avoir pour unique visée la production d’histoires à l’échelle du globe, elle est aussi une perspective géohistorique donnée à de multiples travaux obéissant à d’autres logiques. Les interactions entre les deux démarches sont potentiellement très riches et c’est ce à quoi appelle Chloé Maurel en prenant deux exemples : l’histoire comparée d’une part, l’histoire sociale d’autre part. Cependant, cet enrichissement ne pourra fonctionner que si le cadre théorique et épistémologique de l’histoire globale est clarifié. Les concepts ne sont des passerelles que s’ils sont définis. Celui de Monde reste malheureusement encore trop souvent flou et incertain.