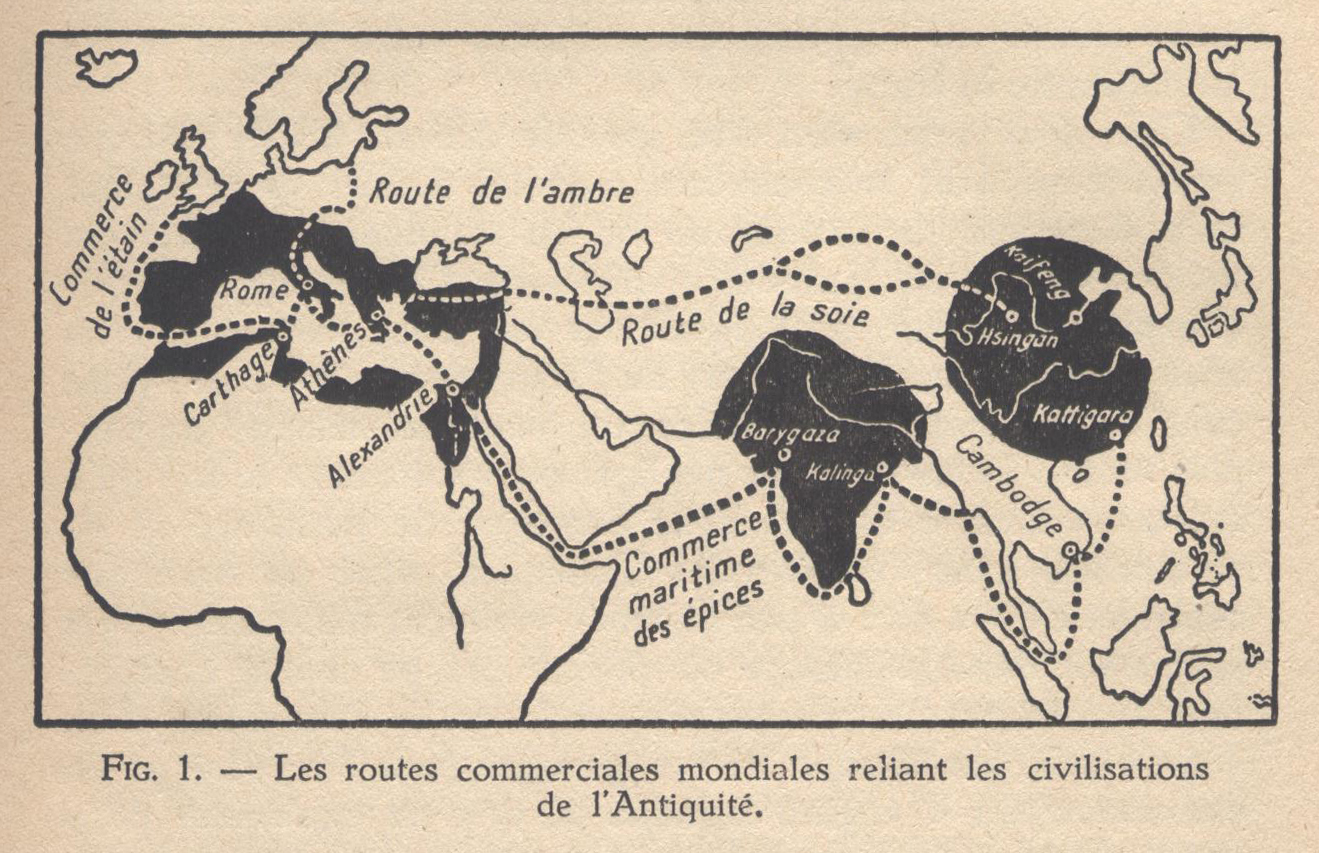L’importance, en histoire globale, des réseaux commerciaux méditerranéens forgés, entre 11e et 15e siècles, par Venise, Gênes et quelques autres, est particulièrement bien connue. Ces réseaux sont notamment associés à ce qu’on a appelé la « révolution commerciale du Moyen Âge » [Lopez, 1974] et ont servi à comprendre ce que pouvaient être les fameuses économies-mondes de Fernand Braudel [1979]. Cette réussite spectaculaire a pu cependant amener à laisser dans l’ombre des structurations économiques assez similaires que connaissait, à la même époque, l’Europe du Nord, plus particulièrement Baltique et mer du Nord, grâce au commerce dynamique pratiqué par les villes de la Ligue Hanséatique. C’est à une incursion dans la logique économique de ces cités marchandes de la Hanse que nous invitons aujourd’hui le lecteur.
Ce que l’on désigne comme le symétrique septentrional de la Méditerranée se compose principalement des ports de la mer du Nord, nés pour la plupart au Moyen Âge (Bruges, Anvers, Gand), des villes de la Manche (Londres), des villes marchandes de la mer Baltique (Lübeck, Hambourg, Brême) et des ports scandinaves (essentiellement Bergen). Mais le Nord de l’Europe dans son ensemble contribua à l’essor de la révolution commerciale des 13e-15e siècles, grâce au fort développement préindustriel que connurent la Flandre, l’Angleterre et l’Allemagne. Par ailleurs, un réseau commercial serré se forma à cette époque : la Ligue Hanséatique.
La pré-industrialisation qui se produisit dans le Nord entre les 11e et 13e siècles est unique à l’époque, et les cités marchandes italiennes, si elles dominèrent les échanges, ne purent égaler le niveau productif atteint alors par le Nord. Néanmoins, en se spécialisant ainsi dans ces nouvelles activités (principalement textile), les villes du Nord de l’Europe durent se limiter à un commerce de biens plutôt de masse, produits dans la zone, laissant le commerce du luxe aux cités italiennes. Ce sont d’abord les innovations techniques dans le domaine de la production textile (avec le rouet et le métier à pédale) qui permirent d’économiser du travail, et jouèrent un rôle fondamental dans l’essor préindustriel de la zone, notamment en Flandre.
Cette région connut en effet un essor inégalé dans la production textile et de la laine. Celui-ci ne se limita pas aux villes les plus importantes, telles que Bruges, mais envahit littéralement les villes de Flandre, créant un véritable pôle industriel. Ainsi, Gand, dont la population était estimée à 50 000 habitants, faisait vivre la moitié de ses habitants de la production de la laine [Lopez, 1974, 182]. Plusieurs villes, parmi lesquelles Bruges, Gand et Ypres, toujours reconnues aujourd’hui pour leurs draperies, affirmèrent leur éclat par leur savoir-faire et la qualité de leurs draps à cette époque.
Le commerce se développa de façon précoce dans cette région fortement productive. A la différence de l’Italie où les talents commerciaux entraînent plus tard une éventuelle production propre, ici c’est la fabrication autonome qui dicte l’évolution commerciale. Située au carrefour de l’Angleterre (grande exportatrice de laine), de la Scandinavie, de l’Europe de l’Est et du Centre, parcourue par de nombreux fleuves praticables (dont la Meuse), desservie par la mer du Nord, la Flandre offrait de réelles perspectives commerciales. Mais la Flandre n’était pas assez puissante pour prétendre à la suprématie à la fois dans la production industrielle et dans le commerce. En ce qui concerne ce dernier, en effet, elle ne put jamais, jusqu’au 15e siècle, remettre véritablement en cause la domination des cités marchandes italiennes.
La pré-industrialisation textile de l’Europe du Nord préfigura la révolution industrielle qui se produirait quelques siècles plus tard. Le drapier de l’époque n’était déjà plus un simple artisan, il possédait déjà les caractéristiques d’un entrepreneur : ce n’était plus un travailleur manuel, il dirigeait une « chaîne de production ». Ainsi, les étapes de production étaient confiées à des ateliers différents, centralisées par le marchand qui récupérait et redistribuait les textiles, et commercialisait le produit fini. D’autre part, les principaux marchands de Flandre ne voyageaient plus : « ils investissaient leurs capitaux dans la production et les prêts, et laissaient à des marchands étrangers la tâche d’importer la laine (surtout d’Angleterre) et d’exporter le drap à leur propre risque et profit » (Lopez, 1974, 184).
Outre sa production textile, le Nord de l’Europe produisait et commercialisait des produits dits « de masse » qui, tout en ne générant pas des marges de profits considérables, étaient tout à fait essentiels à la subsistance et à la croissance de l’Europe entière. Si nous nous rappelons en effet que l’un des facteurs structurels de la révolution commerciale est la mise en circulation des surplus agricoles dégagés à partir du 11e siècle, nous pouvons comprendre l’importance capitale du commerce de céréales (blé et seigle principalement). Base de l’alimentation de la majorité de la population, les céréales étaient produites principalement dans le centre et le Nord de l’Europe (en Allemagne, en France, en Pologne et en Russie). Elles étaient ensuite exportées vers l’extrême Nord et le Sud de l’Europe, c’est-à-dire vers des régions ne pouvant produire ces biens alimentaires indispensables, comme les cités marchandes d’Italie (Venise fut bien sûr grande importatrice de blé) ou la Scandinavie. Le poisson, nourriture moins fondamentale, était tout aussi apprécié. Ainsi, le hareng, pêché dans la Baltique et salé grâce aux mines de sel de Lünebourg, dont les marchands lübeckois contrôlaient la commercialisation, contribua à l’essor précoce de Lübeck. Enfin, la bière, produite sur place, était transportée vers toutes les régions alentours.
Outre ces produits alimentaires, le trafic maritime en « Méditerranée du Nord » se composait de marchandises lourdes, nécessitant un transport adéquat (des navires particulièrement grands), et dont le déplacement présentait des risques élevés. Ainsi, la principale marchandise convoyée était le bois, à une époque où il servait de matériau de base de construction et combustion. Il provenait principalement de Scandinavie et de l’Est de l’Europe (Russie, Pologne) et était convoyé dans toute l’Europe. De même, le goudron, provenant des mêmes régions, était transporté par les marchands allemands. Ces marchands utilisaient les koggen, bateaux lourds, peu agiles et lents, mais adaptés à ces marchandises volumineuses. Enfin, le textile, facteur de développement de toute cette région, connut un circuit commercial particulier, articulant Nord et Sud de l’Europe, et présentant une grande spécialisation entre les zones concernées.
Ce trafic de marchandises ordinaires resta malgré tout limité, même s’il fit la fortune des marchands de la « Méditerranée du Nord ». Non pas que les besoins fussent inexistants ou faibles, mais le coût des transports devant convoyer ces produits volumineux et lourds restait élevé, et les progrès de l’industrie navale à l’époque ne purent compenser des marges de profit assez faibles, évaluées à 5% [Dollinger, 1964, 266], sur des marchandises vendues à des prix modérés.
Mais la « Méditerranée du Nord », c’est d’abord et surtout l’espace d’une puissante diaspora commerciale, la Ligue Hanséatique.
Afin de se prémunir contre le pouvoir des princes, contre les risques inhérents au commerce maritime, et afin d’obtenir des privilèges commerciaux des puissances voisines, les villes allemandes cherchèrent à se regrouper en ligue régionale. Se mit ainsi en place un réseau dense de marchands appartenant aux villes germaniques, qui, se consolidant, donna naissance à la Ligue Hanséatique. Celle-ci leur permit de s’allier pour partager les frais et les risques et tirer le maximum de richesses d’un commerce somme toute peu profitable.
Au cours du 13e siècle, des liens étroits entre les villes marchandes germaniques (Cologne, Hambourg, Brême, Lübeck) se formèrent. Partageant une même communauté d’intérêts (faire fructifier le commerce des produits de la zone) et liés par le partage d’une langue commune (le bas-allemand), les commerçants allemands décidèrent de s’allier en une confédération marchande qu’ils appelèrent la Hanse. Ainsi, les marchands, secondés par les militaires, procédèrent à la structuration de l’espace maritime compris entre la mer Baltique et la mer du Nord, créant ainsi un espace commercial organisé. Officialisée en 1356 à Lübeck, la Hanse fit de cette ville la plaque tournante de ses échanges commerciaux. Jouissant d’une position privilégiée pour lier les deux moitiés de l’espace maritime nordique par voie de terre et éviter ainsi le contrôle des Scandinaves, Lübeck domina ce réseau commercial. Grâce à son industrie du sel (commerce du hareng salé) et aux privilèges accordés en Flandre à tous les marchands appartenant à la Hanse, Lübeck connut son heure de gloire, notamment entre 1370 et 1388, dates de victoires importantes sur le Danemark et sur Bruges. Néanmoins, Lübeck n’exerça en aucun cas une autorité centrale sur l’ensemble des marchands germaniques. Le fonctionnement en réseau et par solidarité établi entre les villes allemandes (on dénombre, selon les époques, entre 70 et 170 villes) [Braudel, 1979, 83] ne laissait en effet, place à aucun Etat, à aucun gouvernement exécutif. Les décisions étaient prises lors d’Assemblées générales, qui regroupaient toutes les villes membres. Curtin [1998, 7-8] voit dans cette Ligue l’expression d’une diaspora commerciale sans pouvoir hégémonique d’une ville sur les autres, soit le contre-exemple même de Venise ou Gênes…
Comme pour les cités italiennes néanmoins, les marchands profitèrent des conquêtes militaires. La présence militaire dans la zone fut facilitée par l’effondrement de la puissance scandinave entre fin du 11e et fin du 13e siècle. Ainsi, en combinant diplomatie et actions militaires, les marchands allemands purent obtenir des privilèges spéciaux dans tous les ports du royaume de Suède et dans tous ceux de Norvège. Ils bénéficièrent également d’un traitement de faveur aux grandes foires de Skänor, qui demeurait le plus grand centre de rassemblement du poisson et où les marchands de Lübeck étaient les plus gros intervenants. De plus, durant les 12e et 13e siècles, les Hanséates encerclèrent les peuples Slaves et Baltes. L’Ordre des Chevaliers Teutoniques, procédant à une croisade en Lettonie et Estonie au 13e siècle, précéda ou appuya les marchands « mélangeant avec adresse propagande chrétienne, force brutale et sens des affaires » [Lopez, 1974, 163]. Que ce soient les marchands, qui imposaient leurs méthodes commerciales et fondaient de nouveaux ports marchands dans la zone, ou les armées, qui menaient de nouvelles conquêtes orientales, la Baltique méridionale et son arrière-pays furent soumis et intégrés dans l’espace commercial mis en place par les marchands germaniques. Enfin, suite à la victoire militaire sur le Danemark (1370) et au blocus victorieux imposé à Bruges (1388), les marchands Hanséatiques obtinrent de nombreux privilèges dans toute la zone et au sein de l’important port flamand. C’est l’époque de prédominance de Lübeck dont les marchands bénéficient également de privilèges à Londres (exemption de taxes).
Néanmoins, ces victoires militaires et commerciales ne découlaient pas, comme à Venise, d’un seul Etat fort voulant dominer la zone, mais de princes se querellant le territoire. Ainsi, les villes germaniques ne purent compenser les nombreux retards de la « Méditerranée du Nord » sur les cités marchandes italiennes, et bientôt de nombreuses failles dévoilèrent la fragilité du réseau allemand, annonçant la grande crise de la fin du 14e siècle.
La performance financière dont Bruges faisait preuve était loin d’être imitée dans le Nord de l’Europe. Celui-ci accusait un réel retard : l’organisation du crédit y était encore rudimentaire, et pendant longtemps seule la monnaie d’argent y fut admise. Dans un espace commercial où le crédit avait acquis une importance cruciale et où les marchands en avaient constamment besoin pour se développer, ce retard s’avéra rédhibitoire. Par ailleurs, l’absence d’autorité exécutive, si elle permit de tisser un véritable réseau de relations privilégiées, n’en demeura pas moins un handicap : les rivalités entre villes germaniques resurgirent, provoquant des ruptures entre marchands de la Hanse. Ainsi, l’incapacité d’une seule ville à gouverner, produire, commercialiser et enfin s’imposer, se fit cruellement sentir. Le commerce existant au nord de l’Europe consistait surtout, on l’a vu, en échanges entre pays peu développés, entre fournisseurs de matières premières et de produit alimentaires. La demande de marchandises de luxe, des produits en provenance de l’Orient restait limitée, peu de gens pouvant se les offrir. La grande crise qui saisit le monde occidental durant la seconde moitié du 14e siècle, imbriquant la grande épidémie de peste noire, une forte diminution de la production, et une contraction des crédits, toucha de plein fouet les Hanséates.
C’est le mouvement des prix en Occident qui pénalisa en tout premier lieu les marchands de la Hanse. Après 1370, les prix des céréales reculèrent, alors que ceux des produits industriels augmentaient. Ce mouvement défavorisa les trafics de Lübeck et des autres villes marchandes et annonça un recul temporaire de la zone Cependant, la création d’un système commercial européen, comprenant le Nord et le Sud de l’Europe, ne s’effondra nullement avec cette crise majeure : nous retrouverons un système semblable avec Anvers, puis surtout Amsterdam au 17e siècle…
Une première version de ce texte est parue initialement dans NOREL P., 2004, L’invention du Marché, Paris, Seuil.
BRAUDEL F., 1979, Civilisation matérielle, Economie Capitalisme, 15ème-18ème siècle, 3 tomes, Paris, Armand Colin.
CURTIN P-D., 1998, Cross-cultural Trade in Wordl History, Cambridge, Cambridge University Press.
DOLLINGER P., 1964, La Hanse (12ème-17ème siècle), Paris, Aubier (rééd. 1988).
LOPEZ R., 1974, La révolution commerciale dans l’Europe médiévale, Paris, Aubier-Montaigne.