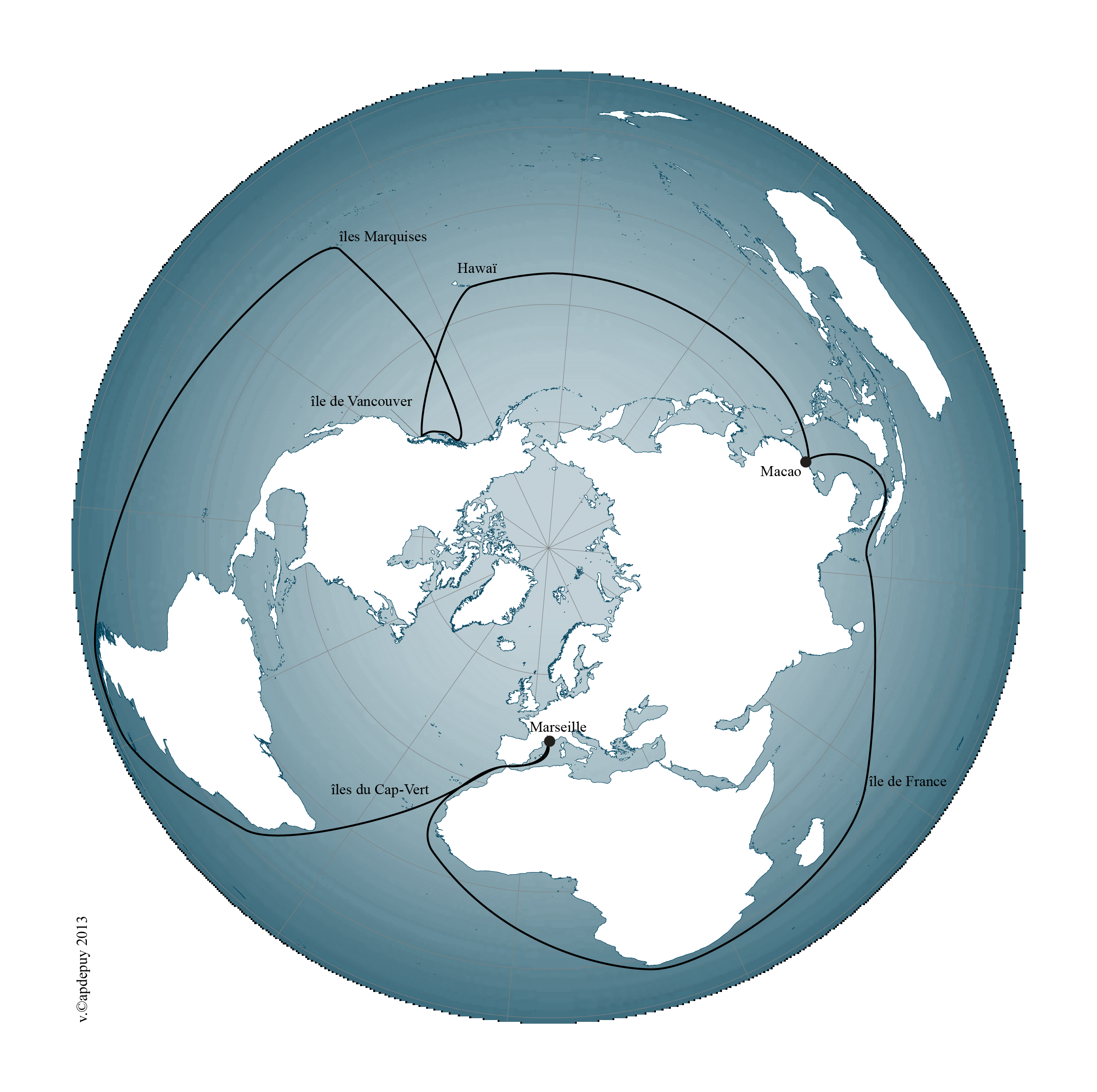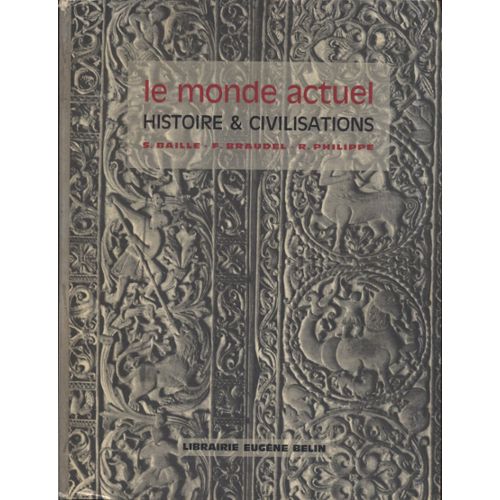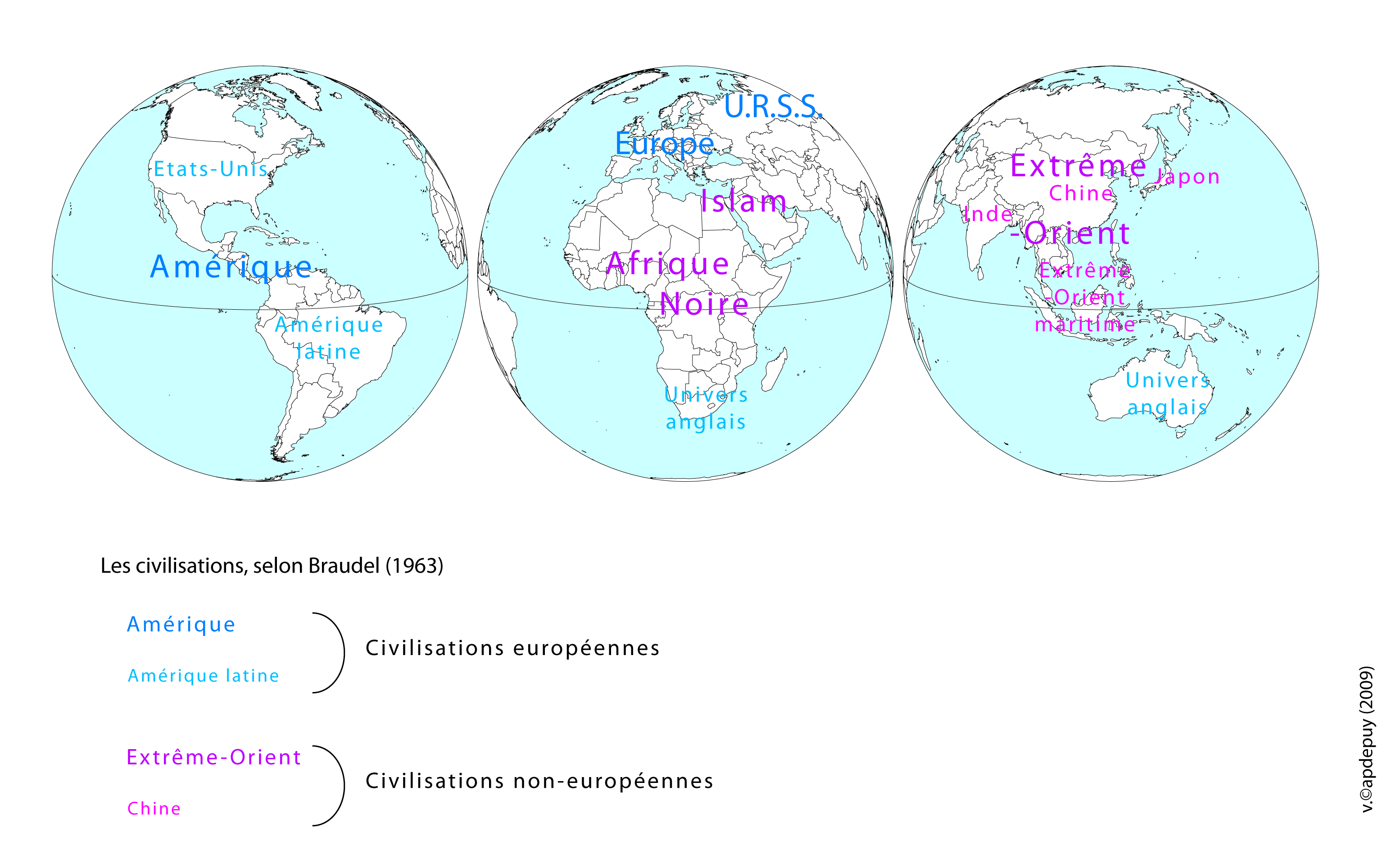En avril dernier, l’ouverture des archives du journal Le Monde depuis 1944 a constitué un micro-événement de la recherche contemporaine. Il était enfin possible d’explorer en plein texte les occurrences de certaines notions, de certains mots. Une analyse rapide m’a ainsi permis de rédiger un texte sur le terme de « mondialisation » et de prolonger un travail de recherche antérieur. Longue anthologie raisonnée plus que véritable article scientifique, ce texte sera publié en plusieurs billets. Voici le premier.
Introduction
Le mot « mondialisation », en français, est moins récent qu’on le croit, puisque la première occurrence attestée remonte à 1916 (Capdepuy, 2011). En pleine guerre mondiale, Paul Otlet constatait déjà une interconnexion de l’humanité, sa mobilité et son interpénétration :
« Aujourd’hui la terre entière est devenue le territoire où s’exerce l’activité humaine et celle-ci ne se laisse plus enserrer ni comprimer dans les limites arbitraires des frontières de chaque pays. Ce n’est plus seulement un échange de produits ou une circulation d’idées ; c’est une colonisation des uns chez les autres, des uns par les autres. » [1]
Et il évoquait la nécessité d’une gestion mondiale des ressources terrestres :
« Un droit nouveau doit remplacer alors le droit ancien pour préparer et organiser une nouvelle répartition. La “question sociale” a posé le problème à l’intérieur ; “la question internationale” pose le même problème à l’extérieur entre peuples. Notre époque a poursuivi une certaine socialisation de biens. […] Il s’agit, si l’on peut employer cette expression, de socialiser le droit international, comme on a socialisé le droit privé, et de prendre à l’égard des richesses naturelles des mesures de “mondialisation”. » [2]
À partir de cette date, l’emploi du mot peut être tracé, en pointillé, jusqu’aux années 1990, moment où la mondialisation véritablement s’impose dans le discours. La récente mise en ligne des archives du journal Le Monde depuis sa création en 1944 offre une ressource nouvelle permettant d’affiner cette recherche et de tester l’hypothèse selon laquelle la mondialisation, du moins en France, a connu une révolution axiologique : l’enthousiasme du milieu du 20e siècle semble céder progressivement le pas à l’inquiétude et la mondialisation, définie initialement comme un progrès de l’humanité en marche vers plus d’unité, devient une processus subi et un sujet d’inquiétude.
Le comptage du nombre d’articles dans lesquels le mot « mondialisation » est employé donne un premier aperçu sur un usage qui apparaît régulier depuis 1949 – ce qui confirme d’emblée le fait que ni le mot français ni son usage ne datent des années 1980. Toutefois, et c’est le second constat, l’emploi de ce terme ne se développe véritablement qu’à partir des années 1990, confortant l’idée communément admise que le discours sur la mondialisation est récent. Ceci pose assez bien le problème de l’écart entre une conscience relativement ancienne de la mondialisation et l’émergence assez récente d’un discours paradigmatique, et appelle une réflexion critique à la croisée de la métagéographie et de la métahistoire dans la mesure où la notion de mondialisation porte un discours à la fois sur la géographie et sur l’histoire du Monde.
La lecture des articles où le mot « mondialisation » est usité amène à élaborer une chronologie au sein de laquelle peuvent être distingués des moments de sens. Le découpage par décennies pourra paraître arbitraire, il a surtout l’avantage d’une certaine neutralité. Les périodes ainsi distinguées ne doivent pas être considérées comme autant de champs-levés, mais bien comme des moments où de nouveaux usages émergent, où des nouveaux brins sont ajoutés à la tresse du sens.
1. L’après-guerre : la mondialisation citoyenne
Les années qui succèdent à la fin de la Seconde Guerre mondiale donnent lieu à un discours pacifiste et internationaliste spécifique : le mondialisme. Ce courant, quelque peu oublié, a duré jusqu’aux années 1970 (Haegler, 1972) et fut néanmoins assez important pour qu’un volume de la collection « Que sais-je ? » lui soit consacré, en 1977, rédigé par Louis Périllier et Jean-Jacques L. Tur.
Plusieurs articles du Monde, entre 1949 et 1952, couvrent quelques événements suscités par ce mondialisme. Ainsi, le premier article où le mot « mondialisation » apparaît date du 17 juin 1949. Il y est question d’un appel lancé par le maire de la commune britannique de Chelmsford, située à 50 km au nord-est de Londres, et adressé aux autres représentants municipaux des soixante-dix villes qui ont déjà proclamé leur « mondialisation ». L’objectif était d’organiser des « élections-pilotes » en vue de préparer la Constituante de 1950.
D’autres articles suivirent. Plusieurs tournent autour de la figure de Garry Garis, ancien pilote de l’US Air Force pendant la guerre, qui s’engagea dans le pacifisme dès la fin de celle-ci. Il fut connu notamment pour avoir campé dans les jardins du Trocadéro à Paris et pour avoir interrompu, le 19 novembre 1948, une séance de l’Assemblée générale des Nations Unies au palais de Chaillot en lisant la « déclaration d’Oran » ‑ un texte coécrit avec Albert Camus :
« Messieurs le président et les délégués,
Je vous interromps au nom des peuples du Monde qui ne sont pas représentés ici. Bien que mes mots pourraient ne pas être entendus, notre besoin commun d’un ordre et d’une loi mondiale ne peut plus être ignoré.
Nous, le peuple, voulons une paix que seul un gouvernement mondial peut donner.
Les États souverains que vous représentez nous divisent et nous conduisent à l’abîme de la guerre totale.
J’en appelle à vous pour ne plus nous tromper par l’illusion de l’autorité politique.
J’en appelle à vous pour convoquer immédiatement une assemblée mondiale constituante afin de dresser le drapeau autour duquel tous les hommes pourront se rassembler, le drapeau d’une véritable paix, d’un gouvernement uni pour un monde uni. […] » [3]
À la fin de l’année, il fonda le mouvement des Citoyens du Monde. En 1949, à l’initiative de Robert Sarrazac, Cahors se proclame ville citoyenne du Monde et en février 1950, Le Monde reprend l’annonce faite par 230 communes du Lot de leur « mondialisation » :
« Le texte de la charte de “mondialisation” comporte essentiellement l’affirmation du principe que la sécurité et le bien-être de chaque ville sont liés à la sécurité et au bien-être de toutes les communes du monde, menacées de destruction par la guerre totale, ainsi que la revendication d’un pouvoir fédéral mondial démocratique, émanant d’une Assemblée constituante de peuples désignée à raison d’un délégué par million d’habitants.
La charte admet enfin que les villes ou territoires mondialisés ne renient en aucune manière leurs droits et leurs devoirs à l’égard de la région et de la nation auxquelles elles appartiennent. » [4]
Ceci amène André Fontaine, au mois d’avril 1950, à proposer une réflexion sur le mondialisme par rapport au contexte de guerre froide : comment mondialiser un Monde coupé en deux ?
« Il n’en reste pas moins qu’en dehors du gouvernement mondial on voit mal quel dénominateur commun pourrait encore réunir l’Est et l’Ouest. Proclamer sa conviction que seule l’unité mondiale peut permettre d’entreprendre une exploitation rationnelle et une distribution équitable des ressources du globe et éviter en fin de compte la guerre, ce n’est pas refuser de défendre les valeurs auxquelles on est attaché. L’idéologie mondialiste est sans doute la forme la plus positive du pacifisme. Il n’est à aucun degré un défaitisme ; le pire défaitisme c’est le désespoir. » [5]
Après 1950, le mot « mondialisation », qui était resté lié au mouvement mondialiste, disparaît des articles du Monde, et il faut attendre 1959 pour qu’il commence de nouveau à être utilisé ; mais le sens n’est plus tout à fait le même.
2. Les années 1960 : une mondialisation banalisée
En novembre 1961, dans le contexte de la crise de Berlin, André Fontaine expose la politique des États-Unis, et notamment la proposition du sénateur Mansfield de faire de Berlin une ville libre, ce qu’il lie implicitement avec le mouvement mondialiste :
« Pour l’ancien repaire de Hitler, ce ne serait pas un mauvais aboutissement que de servir de terrain d’expérience à la première tentative de mondialisation. »[6]
Mais les choses bougent. En juin 1959 déjà, François Hetman pose le problème de la balance commerciale de la France : « La France doit-elle exporter autant que l’Allemagne ? », et parle dans le corps de l’article de « la “mondialisation” des exportations » [7]. La présence de guillemets pourrait être interprétée sinon comme la marque d’un néologisme, du moins comme la trace d’un déplacement de sens. Le mot continue ici à désigner une action, mais il entre dans le vocabulaire économique, notamment par les écrits de François Perroux [8]. Plusieurs articles du Monde s’en font l’écho et reprennent incidemment le mot. Ainsi, en 1960, dans une citation extraite de l’Univers économique et social, tome de l’Encyclopédie française dirigé par Gaston Berger et François Perroux :
« […] la multiplication des monographies qui ne permet pas, à elle seule, de comprendre le monde moderne : les liens étroits – heureux par de nombreux côtés – entre hommes d’affaires et économistes, qui risquent de faire oublier à ces derniers l’ampleur de vues nécessaire à l’élaboration des projets gouvernementaux ; enfin la localisation des phénomènes économiques, alors que partout agissent les forces visant à la mondialisation des problèmes économiques et à l’unité du monde » [9].
Ou encore dans un article de 1962 rendant compte d’un numéro de la revue Comprendre, consacré à « la question internationale », auquel François Perroux a contribué :
« François Perroux surtout a maintes fois établi qu’à travers des régimes divers l’humanité est en marche vers un État post-capitaliste et post-communiste, où la plus grande œuvre de l’homme sera enfin rendue possible. Ici, en des pages précises et passionnantes, il établit le diagnostic de l’économiste : la conquête spatiale exige le contrôle plurinational des investissements et, par conséquent, la coordination plurinationale des plans de développement ; elle entraîne la socialisation et même, à plus ou moins brève échéance, la mondialisation de l’économie. » [10]
Comme dans les cas précédents, la mondialisation désigne une action définie par une intentionnalité et portée par un acteur, le plus souvent collectif, et non l’interrelation croissante des différentes parties du Monde, qui est chaque fois constatée, mais jamais nommée.
Dans cet ordre d’idée, au début des années 1960, on débat d’une possible « mondialisation du Marché commun » [11], qui consisterait à étendre la coopération économique européenne par la signature de traités avec d’autres pays ou d’autres organisations internationales (Commonwealth par exemple). Cependant, le sens peu à peu s’affaiblit, se banalise. La mondialisation n’est plus qu’une extension à l’échelle mondiale. Le géographe Maurice Le Lannou utilise le terme en 1963 à l’occasion de la parution du livre de Pierre George, Précis de géographie rurale ; il y parle de la nécessaire « mondialisation des préoccupations de l’agriculture » [12].
La mondialisation est simplement une généralisation de dimension mondiale. Cela peut s’appliquer aussi bien à la guerre du Viêtnam… :
« Ces deux versions du drame vietnamien, celle de la “localisation” et celle de la “mondialisation” de son enjeu, sont présentées au public au gré des circonstances. Il est clair que beaucoup d’officiels américains flottent entre les deux, la première leur paraissant d’un réalisme trop placide, et la seconde d’un idéalisme conduisant tout droit à la croisade permanente. » [13]
… qu’au gaullisme, comme dans ce billet ironique de Robert Escarpit :
« La stature et l’intelligence du général de Gaulle dépassent manifestement le cadre modeste de nos préoccupations nationales. La mondialisation du gaullisme vaut à notre pays un prestige inégalé. Nous n’avons aucune raison de nous priver de cet avantage. Créons donc un poste de président itinérant et nommons-y notre grand homme. Et puis, entre petites gens, essayons de faire le reste. » [14]
Le mot en rencontre parfois un autre, celui de « planétarisation », forgé par Teilhard de Chardin, mais lui aussi banalisé (et employé jusqu’à aujourd’hui) :
« Ainsi, par un paradoxe à proprement parler tragique, un siècle après les plus grandes espérances, non seulement nous ne connaissons en fait d’universel que la planétarisation des conflits et la mondialisation de la peur, mais aucun pays, aucun système, ne se fait des rapports internationaux une idée à la fois assez claire et assez cohérente pour fonder une action précise à long terme. » [15]
En 1967, Jean Lacroix développait une réflexion sur le sens de l’histoire inspirée précisément par l’œuvre de Teilhard de Chardin (1949, 1955). La mondialisation dessinait l’horizon de l’humanité planétaire :
« La socialisation est toujours dangereuse, inquiétante. La synthèse entre l’unité et la liberté est difficile. Tout le drame de l’histoire est de sauver la personne dans l’avènement de l’humanité totale, de cette mondialisation dont nous vivons le douloureux enfantement. » [16]
Mais en 1968, le terme « mondialisation », employé par François Mitterrand dans le sens banal d’extension à l’échelle mondiale, est associé à une analyse négative :
« L’Europe libérale est une contradiction dans les termes. La mondialisation du capitalisme enlève à l’avance toute consistance à l’expression politique de cette Europe-là. » [17]
À la fin des années 1960, l’inquiétude commence à pointer.
Notes
[1] Paul Otlet, 1916, Les Problèmes internationaux et la Guerre, les conditions et les facteurs de la vie internationale, Genève/Paris, Kundig/Rousseau, p. 76.
[2] Ibid., p. 337.
[3] http://www.worldgovernment.org/gov.html#oran, trad. de l’anglais par l’auteur.
[4] Le Monde, 17 février 1950.
[5] André Fontaine, « Le “mondialisme” », Le Monde, 3 avril 1950.
[6] André Fontaine, « Contre-attaque », Le Monde, 24 novembre 1961.
[7] François Hetman, « La France doit-elle exporter autant que l’Allemagne ? », Le Monde, 22 juin 1959.
[8] J’avais déjà signalé l’usage qu’il faisait du mot « mondialisation » dans L’Europe sans rivages, paru en 1954. Indiquons également que dans le Trésor de la langue française la première occurrence attestée de « mondialisation » est attribuée à François Perroux, Économie du XXe siècle, 1964.
[9] « Le tome de l’Encyclopédie française consacré aux questions économiques et sociales a été remis à M. Joxe par MM. Berger et Perroux », Le Monde, 28 avril 1960.
[10] Jean Lacroix, « La question internationale », Le Monde, 18 juillet 1962.
[11] L’expression, qui apparaît dans un article de Jean-Marie Domenach, « Les choix de l’Europe », Esprit, n° 314, février 1963, est citée dans un compte-rendu d’Yves Florenne, « Choix et chances de l’Europe », Le Monde, 16 mars 1963.
[12] Maurice Le Lannou, « Géorgiques du temps présent », Le Monde, 29 mars 1962.
[13] Alain Clément, « La politique de la Maison Blanche est approuvée par le Congrès et l’opinion publique », Le Monde, 12 février 1965.
[14] Robert Escarpit, « Étoiles filantes », Le Monde, 22 février 1965.
[15] Jean Charbonnel, « La légende et l’héritage », Le Monde, 27 avril 1970.
[16] Jean Lacroix, « Teilhard et le drame humain », Le Monde, 8 mai 1967.
[17] François Mitterrand, « Mobiliser l’économie », Le Monde, 1er mars 1968.