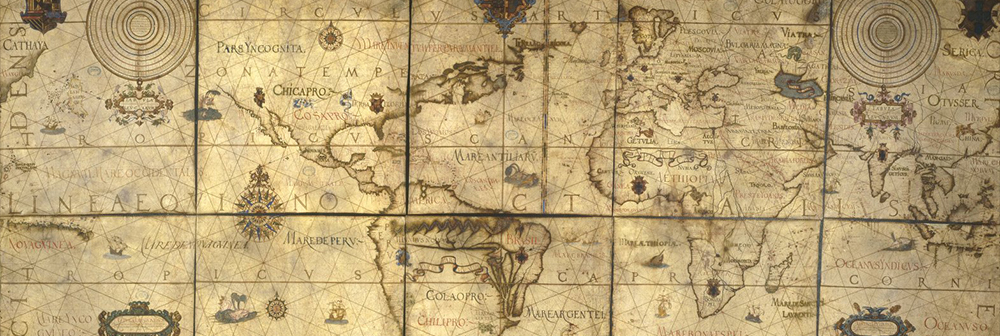Signe encourageant que celui-ci : ces derniers mois ont été féconds en débats et parutions autour de l’histoire globale, voire du concept de global. Après nous être fait ces dernières semaines l’écho du livre Essais d’histoire globale dirigé par Chloé Maurel, comme de l’ouvrage Le Tournant global des sciences sociales dirigé par Stéphane Dufoix et Alain Caillé, s’est fait jour un dilemme : nous nous devions de prendre position dans certains de ces débats, de rendre compte de certains événements, mais nous refusions à monopoliser le fil de ce blog autour de cette seule thématique. Nous avons choisi ici de réagir collectivement à certains des moments forts de cette actualité. Vincent Capdepuy commente certaines opinions répercutées par le dernier numéro de la revue Le Débat titré « Difficile enseignement de l’histoire », reprenant des positions développées plus longuement sur Aggiornamento ; Philippe Norel s’est penché sur l’article de Laurent Berger (Une science sociale pluriséculaire et transdisciplinaire) initialement publié dans le n° 3 de la revue Monde(s) ; et Laurent Testot revient sur le colloque « Penser global » et la revue du même titre. Nous aurions pu évoquer quelques autres événements, telle la parution du petit ouvrage collectif dirigé par Patrick Boucheron et Nicolas Delalande, Pour une histoire-monde (Puf, 2013), mais celui-ci fera l’objet d’une chronique ultérieure.
L’histoire globale est-elle une menace pour l’enseignement de l’histoire en France ?
La question pourrait surprendre, c’est pourtant le constat assené par Pierre Nora dans l’éditorial du dernier numéro du Débat :
« Sur quoi l’émergence d’une approche globale, ou mondiale, est venue servir de prétexte pour les uns et d’impératif majeur pour les autres au dépassement définitif d’une histoire nationale. Cette déconstruction et ce retournement de l’histoire officielle auraient pu être la source d’un enrichissement fécond. Ils l’ont été parfois. Mais le plus souvent, ils n’ont abouti qu’à un militantisme idéologique qui est le pendant du militantisme national(iste). » [1]
On a apporté ailleurs une réponse plus développée [2], mais deux points méritent ici d’être soulignés.
1) Cette mise en avant de l’histoire globale révèle d’une part, un fantasme sur une galaxie historiographique [3] qui n’a eu aucun impact réel sur la réécriture des programmes du primaire et du secondaire opérée ces dernières années, pour la simple et bonne raison que l’histoire globale reste encore très marginale en France ; d’autre part, une vraie crispation nationale face à une mondialisation perçue comme une menace. Sur cet aspect qui combine repli sur soi et déni du Monde, il est intéressant de noter le basculement qui s’est opéré dans l’utilisation du mot « mondialisation » entre son invention en 1916, son utilisation par le mouvement mondialiste après 1945 et sa progressive polémisation à partir des années 1970 jusqu’à devenir un « mot de combat » (Lévy, 2008 ; Capdepuy, 2011). L’archéologie de cet antimondialisme français, qu’il faut sans doute articuler avec une décolonisation difficile, reste à écrire dans le cadre d’une métahistoire de la mondialisation.
2) L’histoire globale est perçue dans la plus grande confusion. Il faut avouer que le nom n’aide pas. Pour faire simple, on pourrait dire que l’histoire globale d’hier n’est pas l’histoire globale d’aujourd’hui. Dans les années 1950, les historiens de l’école des Annales plaidèrent pour une « histoire totale », dite aussi, parfois, « globale », « soucieuse de saisir l’ensemble de la réalité sociale » [4]. L’histoire globale qu’on défend sur ce blog est la traduction littérale de la global history, expression forgée pour la première fois aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. L’adjectif « global » renvoie cette fois-ci au globe terrestre. L’histoire globale s’apparente ainsi à l’histoire mondiale, ou Word History. Quelle différence peut-on faire entre les deux ? L’histoire mondiale a elle-même succédé à « l’histoire universelle », même si cette dernière expression est parfois encore usitée. C’est l’histoire de toutes les histoires du monde. Rien ne la définit vraiment sur le plan méthodologique ou en terme de problématique sinon cette capacité à tout subsumer. L’histoire globale, en revanche, est structurée par un fait majeur qui est la mondialisation globale, c’est-à-dire le processus d’interconnexion croissante des différentes sociétés du monde entier qui a abouti à la constitution du globe terrestre en lieu de l’humanité unifiée. Sur cette base, deux débats s’ouvrent. Le premier porte sur le moment où cette échelle devient pertinente. L’histoire globale doit-elle se cantonner à la seconde moitié du 20e siècle (Mazlich, 2006) ? Ou bien commence-t-elle avec la mort de Tamerlan (Darwin, 2007) ? Le second débat, dans le prolongement du premier, consiste à s’interroger sur les mécanismes mêmes de mondialisation, ce qui amène à intégrer dans l’histoire globale les périodes antérieures au désenclavement du Monde à partir du 15e siècle (Beaujard, 2012), jusqu’à revenir à la dispersion de l’espèce humaine sur la surface du globe (Grataloup, 2007). L’histoire globale ne peut-elle s’écrire qu’à l’échelle du monde entier, sous la forme de grandes fresques, dont le renouvellement est forcément limité sous peine de répétition ? Ou bien peut-on faire de l’histoire globale tesselle par tesselle ? Dans ce cas, il serait sans doute plus juste de parler d’« histoires glocales », qui articulent le micro et le macro, montrant comment, par la mondialisation, chaque lieu du globe est désormais dans le Monde et le Monde en chaque lieu (Retaillé, 2012). Mais le risque n’est-il pas alors de traiter le global uniquement comme une focale, sans voir la spécificité de l’échelle ?
L’histoire globale, une métadiscipline ?
Au-delà du débat sur l’enseignement de l’histoire en France, Laurent Berger procède, pour sa part et dans une tout autre perspective, à une critique véritablement radicale de l’histoire globale. Ou plutôt d’une histoire globale qui se réduirait à une historiographie pratiquée par les seuls professionnels de l’histoire… Pour lui, « l’histoire globale est une question bien trop épineuse pour être laissée entre les seules mains des historiens ». Le propos peut paraître choquant. Berger le justifie en s’attachant à la « généalogie conceptuelle des modèles théoriques » de l’histoire globale et non plus au « contexte institutionnel » relativement récent qui l’a vu émerger. Autrement dit, si l’on quitte la focalisation sur la filiation bien connue, voire ressassée, qui va de l’ancienne histoire universelle à la World History, puis à l’histoire globale (en passant par l’histoire transnationale, impériale, etc.), si on admet que l’histoire globale s’enracine dans des problématiques propres à l’ensemble des sciences sociales, alors la position de Berger devient légitime. Sur cette base, l’histoire globale devient une « méta-discipline et non plus un simple courant historiographique ». Elle devient « le nom contemporain de ce qu’Immanuel Wallerstein appelle la « science sociale historique » dont les fondations remontent bien au-delà des années 1980, contrairement à ce que certains historiens aimeraient faire croire ». L’auteur souligne alors la dimension, non seulement « pluri » mais aussi et surtout trans-disciplinaire de l’histoire globale. Elle serait fondamentalement au carrefour d’un mouvement ancien qui vise à faire dialoguer les différentes disciplines qui s’étaient forgé leur domaine propre à partir de la fin du 18e siècle, mais n’ont jamais pour autant oublié de dialoguer entre elles, comme l’histoire de l’école des Annales, dans l’entre-deux-guerres, le montre abondamment.
Berger propose alors de cerner ce qui constitue l’histoire globale autour d’une double problématique. La première consiste à s’interroger sur le développement géographique des échanges et rencontres, sur ce progrès des « interconnexions entre sphères d’activités sociales », donc à « identifier où, comment et par qui se mettent en mouvements les flux de capitaux, d’idées, d’images, de populations et de biens et services ». Il s’agit donc ici d’analyser un processus géographique de « globalisation », une saturation potentielle de la planète par ces flux. Mais cette analyse ne peut rendre compte d’un fait majeur constitutif de la seconde problématique, à savoir le changement social facilité, permis, voire déterminé par ces différentes formes de globalisation. On peut penser en premier lieu à la formation d’économies de marché qui se généraliserait à la planète. Berger est plus général, évoquant « l’émergence et la disparition de principes de coordination et de régulation des différentes sphères d’activité ainsi connectées ». Autrement dit, l’expansion des échanges est bien un moteur central du changement structurel, de transformations qui conduisent à une certaine forme de lien social mondial, lequel définirait une « mondialisation » au sens donné récemment à ce terme par Grataloup (2011) et qui se distinguerait d’une simple « globalisation ». En définitive, l’histoire globale apparaît alors comme « un programme de recherche transdisciplinaire qui a pour ambition de décrire et d’analyser comparativement les formes de changement social liées aux différents types de globalisation ». On est évidemment bien loin de l’historiographie…
Les sciences sociales converties au global ?
Du 15 au 17 mai 2013 se tenait à Paris un colloque intitulé « Penser global », initié par la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) pour fêter dignement son cinquantenaire. Il a réuni la part francophone du gratin international des chercheurs en sciences humaines et sociales (SHS). Se sont succédé parmi bien d’autres à la tribune, outre Michel Wieviorka, maître de cérémonie en sa qualité de directeur de la FMSH, les sociologues Manuel Castells, Richard Sennett, Saskia Sassen, Elijah Anderson, Craig Calhoun, Edgar Morin, Alain Touraine, Dominique Méda, Jean Baubérot, comme l’historien Immanuel Wallerstein, l’économiste Ignacy Sachs, la philosophe Nancy Fraser…
La majorité de ces ténors ès SHS ont pour point commun de se retrouver au sein d’une institution, nouvelle venue dans le paysage académique : le collège d’études mondiales. Instauré en juin 2011, ce fleuron de la FMSH développe des thématiques peu encouragées en France – tel le global –, attirant des chercheurs de renommée internationale. L’objectif est de faire sortir les SHS des frontières nationales, pour les mettre en mesure d’appréhender les grands changements à l’œuvre. Pour ce faire, des moyens classiques : une quinzaine de chaires dédiées à de grandes thématiques et confiées à de grands noms des SHS, accompagnant des séminaires, conférences, publications, financements de post-doctorants et partenariats avec des institutions équivalentes dans le monde… Dans la foulée, la FMSH a aussi lancé une revue semestrielle, Socio, dont le n° 1, publié en mars 2013, se consacrait lui aussi à « Penser global ».
L’objectif du colloque était de « réfléchir aux SHS de demain ». Désormais multipolaires car produites partout sur la planète et non plus monopolisées par le seul Occident, elles sont sommées de pratiquer la trans- ou interdisciplinarité, ainsi que le partenariat avec le privé. Contraintes aussi de mieux cerner les grands chantiers inscrits à l’agenda des chercheurs : risques globaux, gouvernance mondiale… De nouvelles démarches émergent alors que s’imposent ces thèmes, qui ne vont pas sans influer sur les paradigmes fondateurs des SHS. Et les diagnostics ont, en dépit de l’hétérogénéité des intervenants, convergé autour d’un constat commun, qu’a résumé Wieviorka : « Il s’agit aujourd’hui de renouveler les catégories de la connaissance en SHS, pour répondre aux questions complexes posées par la mondialisation. »
Force est de retenir qu’étaient conviés à ce grand raout beaucoup de sociologues, mais très peu d’historiens, d’économistes ou d’anthropologues du global, ni de spécialistes des relations internationales – le même constat valant pour les intervenants retenus dans le n° 1 de Socio, ou l’ouvrage Le Tournant global des sciences humaines dirigé par Caillé et Dufoix, comme pour le colloque éponyme de 2009 dont ledit ouvrage est issu… Retenons que les grands noms des sciences sociales en général, et de la sociologie en particulier, s’accordent peu ou prou sur la nécessaire transition vers la trans- ou interdiciplinarité, condition nécessaire à l’appréhension d’un monde toujours plus interconnecté, et la mettent en œuvre – il y aura eu ces dernières années en France deux grandes manifestations de dimension internationale autour d’une sociologie globale, aucune en faveur d’une histoire globale.
Bibliographie
Beaujard Philippe, 2012, Les Mondes de l’océan Indien, Paris, Armand Colin, vol. 1 et vol. 2.
Berger Laurent, 2013, « La place de l’ethnologie en histoire globale », Monde(s), n° 3, pp. 193-212, Armand Colin.
Caillé Alain et Dufoix Stéphane (dir.), 2013, Le Tournant global des sciences sociales, Paris, La Découverte.
Calhoun Craig et Wieviorka Michel, 2013, « Manifeste pour les sciences sociales », Socio, n° 1, pp. 5-40.
Capdepuy Vincent, 2011, « Au prisme des mots. La mondialisation et l’argument philologique », Cybergeo, document n° 576.
Darwin John, 2007, After Tamerlane. The Global History of Empire, Londres, Allen Lane.
Grataloup Christian, 2007, Géohistoire de la mondialisation. Le temps long du monde, Paris, Armand Colin.
Grataloup Christian, 2011, Faut-il penser autrement l’histoire du monde ? Paris, Armand Colin.
Lévy Jacques (dir.), 2008, L’Invention du monde. Une géographie de la mondialisation, Paris, Presses de Sciences Po.
Maurel Chloé (dir.), 2013, Essais d’histoire globale, Paris, L’Harmattan.
Mazlich Bruce, 2006, The New Global History, New York, Routledge.
Retaillé Denis, 2012, Les Lieux de la mondialisation, Paris, Le Cavalier Bleu.
Notes
[1] Pierre Nora, 2013, « Difficile enseignement de l’histoire », Le Débat, n° 175, p. 5.
[2] Vincent Capdepuy, « Le déni du Monde », Aggiornamento, 17 juin 2013.
[3] Olivier Grenouilleau, 2009, « La galaxie histoire-monde », Le Débat, n° 154, pp. 41-52.
[4] Fernand Braudel, « Au parlement des historiens : retour sur le Congrès international de Paris, 1950 », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, Vol. 8, n° 3, p. 369.