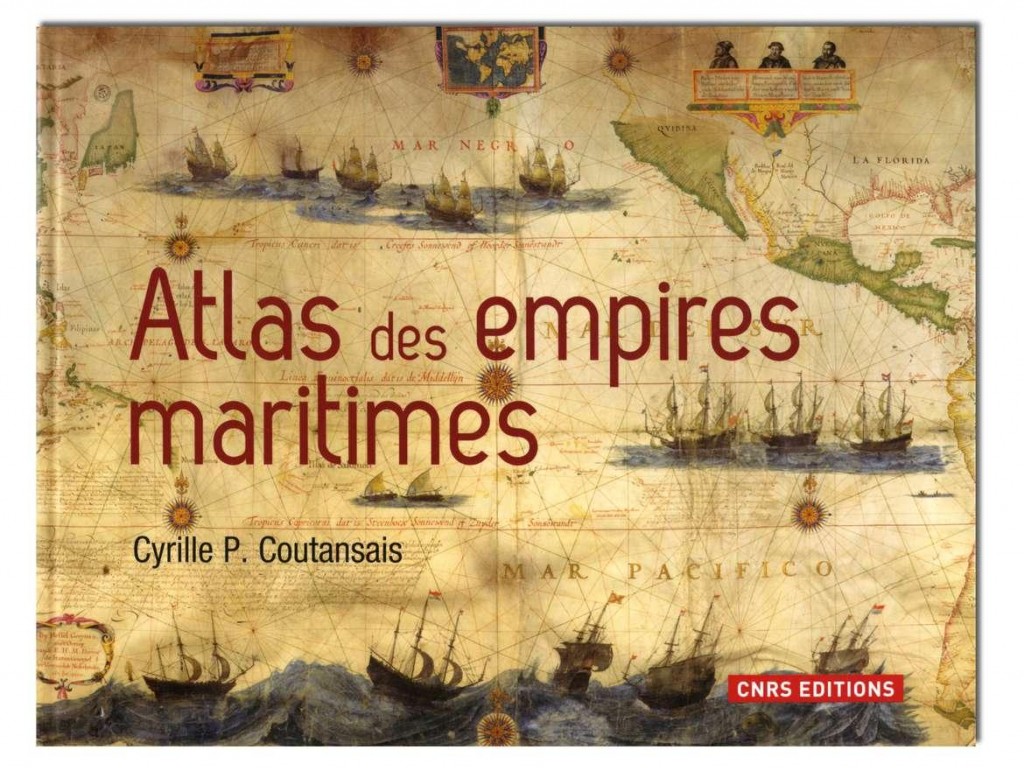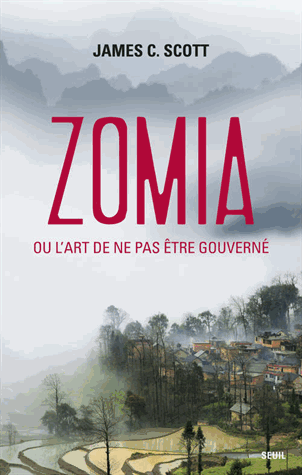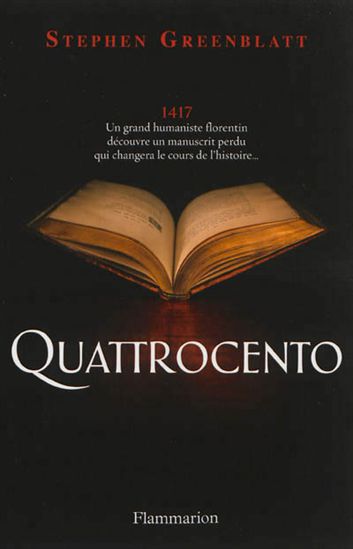L’histoire globale est une question bien trop épineuse pour être laissée entre les seules mains des historiens. C’est peut-être la raison pour laquelle les contributions des autres sciences sociales à l’histoire globale ont déjà plus d’un siècle, si l’on se rappelle par exemple l’influence déterminante que la lecture d’Ancient Society a pu exercer sur Karl Marx pour réviser son concept de mode de production asiatique à l’aune des régimes fonciers russes et allemands . Une telle entrée en matière pose d’emblée, à rebours de la doxa encore parfois tenace selon laquelle l’histoire globale n’est qu’un courant historiographique récemment importé des États-Unis dans le sillage de la World History à la faveur de la « mondialisation » et du triomphe concomitant de l’idéologie néolibérale , le problème de savoir si l’on peut d’un même tenant définir et identifier ce qu’est l’histoire globale, et quelle est la nature des contributions des différences sciences sociales à son projet.
Un tel questionnement suppose de distinguer, comme l’a proposé Olivier Pétré-Grenouilleau dans sa généalogie de la « galaxie histoire-monde » , ce qui relève de l’usage institutionnel du terme histoire globale/mondiale (dans les maisons d’éditions, les colloques, les départements universitaires, les associations et les revues), et ce qui relève d’une pratique savante d’investigation et de théorisation existant bien avant l’apparition de ce terme et de ce contexte institutionnel. Hérodote ne proposait-il pas déjà dans ses Histoires une synchronisation des événements sur le long terme, à l’échelle de trois continents, reconstituée à partir des vestiges archéologiques et des sources ethnographiques et historiques disponibles sur le monde gréco-romain, l’Égypte, l’Inde, la Babylonie, l’Arabie et la Perse ?
Un tel questionnement implique surtout de concevoir l’histoire globale autrement que ne l’ont fait jusqu’à présent certains historiens. Il est en effet significatif que lors du 3e congrès européen d’histoire globale tenu à la London School of Economics en avril 2011, la table ronde consacrée aux types de comparaison, de causalité et d’échelle ait été monopolisée par des historiens, à la pointe de ces débats dans leur propre discipline, mais à l’exclusion de tout autre représentant des sciences sociales .
Un article récemment publié en France expose clairement les deux présupposés inhérents à une telle surreprésentation des historiens : l’histoire globale serait un jeune mouvement historiographique relativement « flou » et « fourre-tout », au sein duquel se rencontrent et se confrontent la microstoria, l’histoire « transnationale », « impériale », « mondiale », « connectée », « comparée » ou « universelle » ; ce mouvement se constituerait à la confluence de traditions académiques et nationales aiguillées par des contextes géopolitiques spécifiques (Guerre froide, montée des nationalismes coréen, russe et japonais, consensus de Washington, choc du 11 septembre, etc.), sans que l’on puisse discerner encore avec certitude si la « globalisation » est et restera son objet d’étude, la coopération universitaire internationale son horizon pratique, et la collaboration avec d’autres disciplines inhérente à son projet.
Ce qui sous-tend cet angle d’approche semble aller de soi : l’histoire globale est d’abord le fait des historiens, et son histoire institutionnelle contemporaine est à même de nous éclairer sur ce que ce nouveau label recouvre. Qu’en est-il cependant si l’on choisit un angle d’approche quelque peu différent et point par point opposé aux deux présupposés précédents ? Autrement dit, si le débat est réorienté sur l’importance de la transdisciplinarité en histoire globale et la généalogie conceptuelle de ses modèles théoriques ? Cette perspective revient de fait à envisager celle-ci comme une méta-discipline, et non plus comme un simple courant historiographique ; elle revient aussi à la saisir par son « histoire interne » et non plus seulement « externe » . C’est ce qu’avec Philippe Beaujard et Philippe Norel nous avons récemment tenté de faire , et cela nous a conduits à considérer l’histoire globale comme le nom contemporain de ce qu’Immanuel Wallerstein appelle « la science sociale historique » , dont les fondations remontent bien au-delà des années 1980, contrairement à ce que certains historiens à l’image de Bruce Mazlish aimeraient faire croire.
Depuis la parution des Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, le développement des sciences sociales s’est en effet caractérisé par un mouvement de balancier entre deux orientations opposées et complémentaires. D’un côté, la spécialisation disciplinaire des corpus académiques a été assurée par des techniques d’enquête singulières produisant et mobilisant un certain type de données empiriques à l’appui des démonstrations inférées (traitement d’archives, observation participante, cartographie, fouilles, entretiens directifs et semi-directifs, bases de données économétriques…). Cette clôture disciplinaire s’est ancrée dans l’histoire des traditions nationales et universitaires. D’un autre côté, cependant, le décloisonnement et le dialogue entre disciplines ont été encouragés par une triple réalité épistémologique incontournable.
Tout d’abord, les sciences sociales partagent le même objet d’étude empirique. Elles ambitionnent toutes en effet de décrire, comprendre et expliquer les « activités sociales », c’est-à-dire les actions humaines coordonnées ; elles s’intéressent ainsi à leurs conditions pratiques et matérielles, aux agents qui les mènent, aux relations qui s’y nouent, aux raisons et motivations qui les guident, aux lieux et temporalités dans lesquels elles se déploient, aux effets et conséquences qu’elles induisent, aux facteurs qui conditionnent leur existence ici et là, à telle et telle époque. Les sciences sociales disposent, en outre, pour analyser ces pratiques des mêmes options épistémiques : l’opposition entre atomisme, constructivisme et holisme méthodologique bien sûr, mais aussi le choix entre une explication en termes de mécanismes causaux ou fonctionnels, une compréhension en termes de représentations intentionnelles, ou une intelligibilité en termes de processus séquentiels. Enfin, les sciences sociales entretiennent les unes avec les autres, mais aussi avec les autres savoirs modernes, tels que les sciences mathématiques et physiques, les sciences biologiques, les sciences économiques, les sciences cognitives, et les sciences de la littérature et du langage, des rapports institutionnels et didactiques favorisant régulièrement les emprunts méthodologiques, les transferts conceptuels et la diffusion de données empiriques et d’hypothèses théoriques, qui promeuvent de fait la transdisciplinarité .
L’exemple le plus célèbre, associé à la naissance institutionnelle de l’histoire globale, est l’essor en France de l’École des Annales durant l’entre-deux-guerres, pour une large part indissociable des échanges intellectuels tissés entre les historiens Lucien Febvre et Marc Bloch, les psychologues Pierre Janet, Henri Wallon et Jean Piaget, le sociologue François Simiand, le philosophe Lucien Lévy-Bruhl, l’écrivain Paul Valéry et l’ethnologue Marcel Mauss, lors des semaines du Centre international de synthèse créé par Henri Berr . C’est par ailleurs dans un tel cadre transdisciplinaire que le projet de publication d’une histoire globale universelle se met en place après la Seconde Guerre mondiale au sein de l’Unesco, pour appréhender le développement scientifique et culturel de l’humanité au travers des migrations, des échanges de connaissances et des transferts technologiques transcontinentaux. Parmi les nombreux savants qui collaborent à ce projet dans les années 1950, se trouvent ainsi le biologiste Julian Huxley, le biochimiste Joseph Needham, l’archéologue Vere Gordon Childe, les ethnologues Paul Rivet et Claude Lévi-Strauss, ainsi que les historiens Arnold Toynbee et Lucien Febvre . Si cette transdisciplinarité est alors organisée et facilitée sur le plan institutionnel, elle n’en est pas moins perceptible dans la façon même de poser les problèmes et de chercher à les résoudre. Il existe de fait une problématique transversale aux Annales et à l’Unesco, mais aussi aux travaux précurseurs d’Adam Smith, de Karl Marx et de Max Weber, que l’on retrouve tout autant dans les débats au 20e siècle entre les ethnologues évolutionnistes et diffusionnistes, que parmi les historiens modernistes (Eduard Meyer et Mikhaïl Rostovtseff) et primitivistes (Karl Bücher et Moses Finley). Cette problématique touche aux rythmes et aux modalités des changements sociaux propres à la croissance et aux transferts à grande échelle des richesses, des savoirs, et des populations humaines, animales et végétales. Cette problématique parcourt d’ailleurs un grand nombre de textes en sciences sociales, même si leurs auteurs ne peuvent être soupçonnés d’avoir voulu développer expressément l’histoire globale. Émile Durkheim est à cet égard emblématique : ce qu’il nomme la « loi de gravitation du monde social » n’est autre que le lien de causalité directe existant selon lui entre l’augmentation du « volume et de la densité matérielle et morale des sociétés » et le passage structurel d’une forme de solidarité mécanique à une solidarité organique dans la division sociale du travail. Autrement dit, la spécialisation des groupes humains dans des activités productives complémentaires, et l’autonomisation, l’interdépendance et l’individualisation de leurs membres qui en résultent, sont pour lui le résultat conjugué d’une croissance et d’une densité démographique accrue, du développement des infrastructures de transport et de communication, et d’une intensification des échanges et des rencontres entre ces individus et ces groupes.
Ce qui peut alors paraître constitutif de l’histoire globale, c’est bien ce fait de s’interroger sur l’expansion géographique de ces interconnexions entre sphères d’activités sociales, et sur l’accroissement en vitesse et en volume de ces flux de capitaux, d’idées, d’images, de populations et de biens et services véhiculés par les technologies de transport et de communication entre localités, provinces, régions et continents. Le premier problème auquel s’attelle l’histoire globale (quelle est la nature de ces processus de globalisation ?) est donc d’identifier où, comment, et par qui se mettent en mouvement ces flux, s’établissent et s’organisent ces interconnexions, s’aménagent ces échelles spatio-temporelles au sein desquelles cette circulation et cette articulation sont rendues possibles. Seulement, la seule caractérisation, même aussi fine que possible, de ces « projets globalistes » , quels que soient par ailleurs les agents sociaux et les organisations humaines qui les portent (aujourd’hui, les diasporas, les mafias, les travailleurs migrants, les gouvernements d’État, les institutions multilatérales – FMI, Banque mondiale, BIT, Unicef –, les entreprises multinationales, les industries médiatiques et culturelles, les banques d’investissement et les fonds de pension, les mouvements altermondialistes, religieux, terroristes ou indigènes, les organisations non gouvernementales, les autorités de régulation indépendantes – OMC –, etc.) ne peut rendre compte du changement social qu’entraînent ces différentes formes de globalisation, et des transformations structurelles qui modifient les conditions d’exercice des activités sociales reliées par ces flux. Le second problème (quelle est la nature de ces processus de « mondialisation » ?) est donc de repérer et d’analyser ces types de changement social corrélés aux processus de globalisation, à savoir pourquoi, où, et comment émergent et disparaissent des principes de coordination et de régulation des différentes sphères d’activité ainsi interconnectées. Ceci est un problème beaucoup plus analytique que le premier, au sens où l’institutionnalisation de ces principes (par exemple sous forme marchande, redistributive, etc.) est indissociable de l’existence et de la recomposition de formations politiques souveraines, organisées, et territorialisées.
Dans cette optique, l’histoire globale apparaît par conséquent comme un programme de recherche transdisciplinaire qui a pour ambition de décrire et d’analyser comparativement les formes de changement social liées aux différents types de globalisation. Ces dernières concernent tout aussi bien les réseaux matrimoniaux et migratoires, les chaînes de marchandises, les sphères de circulation des capitaux et des objets précieux, les transferts de technologies, les conflits armés, que les aires de diffusion des langues, des connaissances scientifiques, des traditions religieuses, des imaginaires politiques et des styles artistiques. La question porte ainsi sur leur synergie avec la genèse, le développement et le déclin de types de formation politique, d’industrie, d’écriture, de marché, de finance, d’urbanisme, de progrès scientifique et technique, et pour tout dire de culture.
Le « tournant global » en sciences sociales s’avère donc une orientation problématique possible pour chaque discipline ; certes, c’est en histoire que l’on trouve les plus nombreuses références, aussi bien anciennes que contemporaines, à l’image des travaux d’Henri Pirenne (Mahomet et Charlemagne, 1937), de Frederick Teggart (Rome and China, 1939), de Karl Polanyi (La Grande Transformation, 1944), de Marshall Hodgson (The Venture of Islam, 1974), de Fernand Braudel (Civilisation matérielle, économie et capitalisme, 1979), de Kirti Chaudhuri (Trade and Civilization in the Indian Ocean, 1985), de Denys Lombard (Le Carrefour javanais, 1990), ou bien encore de Kenneth Pomeranz (The Great Divergence, 2000). Mais cette importance des travaux historiens ne doit pas masquer le rôle déterminant des contributions propres aux sciences politiques, à la géographie, l’archéologie, la sociologie, l’économie, et l’ethnologie (alias social/cultural anthropology) .
Prise sous cet angle, l’histoire globale s’élabore sur la base et à la croisée des différentes sciences sociales, dont les apports spécifiques se retrouvent intégrés à partir d’une littérature secondaire commune . Toutes ces disciplines sont ainsi susceptibles d’alimenter au confluent de leurs recherches le grand fleuve de l’histoire globale. Pour filer la métaphore fluviale, les différentes sciences sociales, en amont, nourrissent en données et en concepts les problématiques propres à l’histoire globale, tandis qu’en aval, les ouvrages de seconde main induisent un espace de confrontation des faits et des théories constitutif de ses analyses et de son dépassement du compartimentage des sciences sociales en domaines thématiques, en aires culturelles, en corpus académiques et en méthodologies d’enquête étrangers les uns aux autres. Cette transdisciplinarité s’incarne donc en priorité dans une problématique transversale et des transferts de données et de concepts. Ce n’est ainsi pas un hasard si l’espace des controverses théoriques et des options méthodologiques disponible est homologue dans toutes les sciences sociales concourant à l’histoire globale : pour ne prendre qu’un seul exemple, l’opposition des démarches et des analyses propres à l’histoire comparée de Victor Lieberman, basée sur des études de cas disjointes les unes des autres, et l’histoire connectée de Sanjay Subrahmanyam centrée sur la mise en abîme d’archives référencées à des langues et des univers différents, se retrouve en ethnologie dans le clivage entre la multi-case ethnography défendue par Michael Burawoy, et la multi-sited ethnography revendiquée par George Marcus.
Ce que l’on peut donc retenir d’un tel survol rapide des fondements problématiques et pluri-/trans-disciplinaires de l’histoire globale, c’est au fond trois idées simples. La première est le contresens total que signifie du point de vue de l’histoire et de l’épistémologie des sciences sociales l’idée de restreindre l’histoire globale à un courant disciplinaire ou à un cadre théorique exclusifs, voire de considérer ses représentants contemporains comme la réincarnation succédanée des Armchair Scholars du 19e siècle au service du néolibéralisme triomphant. La deuxième est le rôle fondamental et complémentaire endossé par chaque discipline, et plus particulièrement les différents types d’enquêtes empiriques existant en sciences sociales, dans la reconstitution des chaînes de médiations pratiques entre les différentes échelles des macro-ensembles pris à chaque fois en considération. Comme le souligne Marshall Sahlins dans son analyse de l’incorporation au 19e siècle de la vallée d’Anahulu au capitalisme mondial, si mécanismes de nature systémique il y a, ces derniers ne peuvent s’appliquer et se reconfigurer localement qu’au travers de stratégies multiples d’acteurs sociaux de taille et de puissance variable, qui s’adossent de leur côté à des catégories culturelles conditionnant leur propre représentation du champ des possibles. Il ne suffit pas, en effet, de repérer une corrélation entre des changements sociaux majeurs et une phase historique de globalisation (dans le cas d’Hawaï, l’étatisation, l’unification et la centralisation de ces îles à la suite de l’introduction des armes à feu occidentales ; l’avènement d’une oligarchie des grands chefs grâce à la monopolisation du commerce de bois de santal exporté en Chine ; leur colonisation politique et religieuse à l’arrivée des grandes flottes de baleiniers américaines, etc.). Il faut pouvoir en expliquer à chaque fois l’articulation située et les synergies précisément en jeu, sous des formes processuelles à découvrir et théoriser. La troisième idée renvoie à cette nécessaire intégration à un niveau logique supérieur des études empiriques spécifiques ainsi conduites avec les outils techniques de chaque discipline. L’existence d’ouvrages de synthèse de seconde main s’avère en effet déterminante pour confronter les faits et les modèles théoriques. Il faut ici remarquer que c’est l’ethnologie, et non l’histoire, qui se trouve là bien positionnée, de par son passé colonial, pour fournir à l’histoire globale une exigence de comparatisme et de montée en généralisation sachant conjurer les spectres de l’eurocentrisme et de l’ethnocentrisme. À ce titre, l’œuvre de l’ethnologue africaniste Jack Goody en est la meilleure illustration, par l’analyse des trajectoires historiques singulières des différentes sociétés afro-eurasiennes qu’elle autorise, sur la base des multiples échanges ayant orienté leur développement parallèle pluriséculaire depuis la révolution urbaine de l’âge du bronze. Si les travaux de celui-ci ont été depuis bien longtemps considérés en ethnologie comme inclassables, c’est peut-être justement parce que Goody est l’un des principaux fondateurs de, et contributeurs à, l’histoire globale contemporaine.
Ce texte est paru initialement, sous une forme légèrement différente et en tant que partie d’un article plus vaste : BERGER L., « La place de l’ethnologie en histoire globale », Monde(s), 2013, n° 3, p.193-212, reproduit avec l’autorisation des éditions Armand Colin.
La dernière esquisse de ce concept sera formulée en 1881 dans ses trois lettres à Vera Zassoulitch. Voir Maurice Godelier, « Le mode de production asiatique : un concept stimulant, mais qui reste d’une portée analytique limitée », Actuel Marx, n° 10, 1991.
Cf. Chloé Maurel, « La World/Global History. Questions et débats », Vingtième siècle. Revue d’histoire, n° 104, 2009, p. 153-166.
Cf. Olivier Pétré-Grenouilleau, « La galaxie histoire-monde », Le Débat, n° 154, 2009, p. 41-52.
Cf. Patrick O’Brien, “Historiographical Traditions and Modern Imperatives for the Restoration of Global History”, Journal of Global History, vol. 1 (2006/1), p. 3-39.
“Reciprocal Comparison: Roundtable”, Venue: NAB 204, LSEBuilding, Saturday, April 16. Convenor: Alessandro Stanziani (Paris); Panelists: Gareth Austin (Geneva), William Clarence-Smith (London), Frederick Cooper (New York/Berlin), Matthias Middell (Leipzig), Patrick O’Brien (London), Kapil Raj (Paris), Peer Vries (Amsterdam).
Cf. Pierre Grosser, « L’histoire mondiale/globale, une jeunesse exubérante mais difficile », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 110, 2011, p. 3-18.
Sur la hiérarchie complémentaire entre la reconstruction rationnelle des arguments et des problèmes scientifiques (l’histoire normative-interne) et la reconstitution historique des contextes institutionnels de la pratique scientifique (l’histoire empirique-externe), voir Imre Lakatos, “History of Science and its Rational Reconstructions”, Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, vol. 1970 (1970), p. 91-136.
Cf. Philippe Beaujard, Laurent Berger, Philippe Norel (dir.), Histoire globale, mondialisations et capitalisme, Paris, La Découverte, 2009.
Cf. Immanuel Wallerstein, Impenser la science sociale. Pour sortir du XIXe siècle, Paris, PUF, 1991.
Cf. Jean-Michel Berthelot (dir.), Épistémologie des sciences sociales, Paris, PUF, 2001 ; Michel Foucault, Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1966.
Cf. André Burguière, L’école des Annales. Une histoire intellectuelle, Paris, Odile Jacob, 2006.
Ce dernier sera mandaté pour éditer dès 1953 les Cahiers d’histoire mondiale, où publieront notamment l’ethnologue américain Clyde Kluckhohn et le sociologue polonais Florian Znaniecki. La publication de cette histoire globale universelle sera maintes fois repoussée jusqu’aux années 1970, en raison de la participation des Soviétiques et des enjeux idéologiques de la Guerre froide. Voir Poul Duedahl, “Selling Mankind: Unesco and the Invention of Global History, 1945–1976”, Journal of World History, vol. 22 (2011/1), p. 101-133.
Pour reprendre l’expression d’Anna Tsing (“The Global Situation”, Cultural Anthropology, vol. 15 (2000/3), p. 327-360).
Une expression des sociologues Roland Robertson et Michael Burawoy, qui a été utilisée en France dans un sens proche du caractère transdisciplinaire attribué ici à l’histoire globale, par Alain Caillé et Stéphane Dufoix (dir.), Le Tournant global des sciences sociales, Paris, La Découverte, 2013.
On peut citer à l’appui, parmi d’autres, les publications contemporaines de Jean-François Bayart, Romain Bertrand et Jack Goldstone pour les sciences politiques, celles de Christian Grataloup, David Harvey et Laurent Carroué pour la géographie, celles de Guillermo Algaze, Andrew Sherratt et Patrick Kirch pour l’archéologie, celles de Saskia Sassen, Giovanni Arrighi et Michael Mann pour la sociologie, celles de Ronald Findlay, Kevin O’Rourke et Philippe Norel pour l’économie, et enfin celles de Jonathan Friedman, Arjun Appadurai ou Jean et John Comaroff pour l’ethnologie.
Pour une très belle illustration, adossée conjointement à l’économie, à la géographie et aux sciences politiques, voir François Gipouloux, La Méditerranée asiatique. Villes portuaires et réseaux marchands en Chine, Japon et en Asie du Sud-Est, XVIe-XXIe siècle, Paris, CNRS Éditions, 2009.