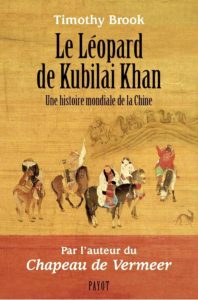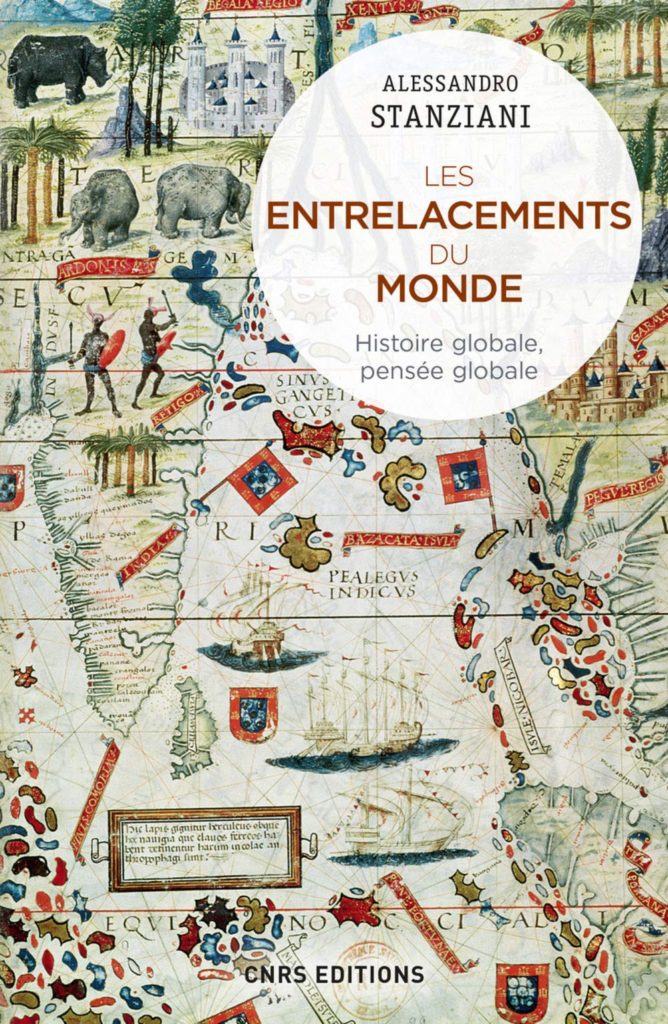Voici le texte d’introduction de Cataclysmes. Une histoire environnementale de l’humanité, publié chez Payot en 2017, réédité et actualisé en poche en 2018.

C’est à proximité du village de Yudanaka, au tréfonds des Alpes nippones, au bord d’un bassin d’eau chaude volcanique, que l’envie d’écrire ce livre a pris forme.
En apparence, le lieu est idyllique. Abstraction faite de son nom de parc d’attractions, Jigokudani, la vallée des Enfers. Vous connaissez peut-être déjà ce site et ses occupants ? Des macaques japonais, immortalisés dans l’eau chaude par moult reportages et photographies. Ici, les singes se baignent. L’acte aurait été, à ses débuts, spontané. Aujourd’hui, la baignade simienne s’est transformée en manne touristique. Les quadrumanes sont gentiment incités à faire trempette…

Arrivée en début d’après-midi. Quelques jeunes singes s’activent. Ils plongent, nagent sous l’eau, se chamaillent. Les plus gros s’amusent à couler les plus petits, sous la surveillance ponctuelle de quelques adultes. Que le jeu aille trop loin, et une femelle s’interpose d’un grognement, d’une tape. On se croirait dans un jardin d’enfants humains. Les macaques soutiennent le regard des visiteurs avec une intensité lourde de toutes les émotions que l’on réserve d’ordinaire à notre espèce.
Les photographies que nous avons déjà vues de ce site en donnent pourtant une fausse idée. Les images sont généralement prises en hiver, sous la neige. Les primates se serrent alors voluptueusement dans l’eau chaude alors que la tempête fait rage. L’endroit semble hors du temps, inaccessible, au fond d’une vallée perdue. « Naturel. »
Dans la réalité, la neige camoufle le béton. Le bassin a été consolidé artificiellement. Le site est facile d’accès – sous réserve que le gaijin (étranger) ait deviné les rudiments des règles subtiles régissant la danse des voitures japonaises. Il suffit de dix minutes de marche, une fois garé le véhicule dans un parking. Un chemin mène à la maison des gardiens du site. Moyennant un droit d’entrée modique, ceux-ci vous autorisent courtoisement à entrer dans la gorge qui conduit au bassin.
Deux centaines de singes vivent ici. Une tribu paisible. L’après-midi s’étire, rythmé par les pitreries des jeunes primates. En fin de journée, nous comprenons pourquoi les singes se sont fixés ici. Deux employés débarquent, porteurs d’une grosse caisse de pommes. Les macaques convergent vers eux, se répartissant en cercles concentriques. Quelques horions sont échangés. Un gros mâle s’est avancé, insistant, auprès des humains.
Il sera le premier servi, non sans s’être vu signifier qu’il est de rang subalterne à ses nourriciers. Les deux employés renforcent la hiérarchie du groupe. Ils s’y imposent comme les dominants, s’assurent que nul n’est oublié. Les pommes, projetées avec violence telles des balles de base-ball, volent en éclats en s’écrasant sur la roche ou le béton. Les singes courent en tous sens, se jettent parfois à l’eau. Les dominants s’empiffrent de fruits. Les dominés se disputent les trognons.
Le Soleil se couche. Les primates aussi, grimpant aux falaises. C’est la nature à la japonaise. Sans trace visible d’intervention humaine. Mais totalement artificielle, anthropisée, façonnée de la main de l’homme. Un raccourci saisissant de ce qu’est notre planète aujourd’hui.
La saga de Singe
Ce livre est construit à la façon d’un film. Il raconte comment les humains ont progressivement transformé la planète, créant des lieux paisibles et des enfers urbains. Il narre aussi comment la nature, altérée, a riposté. Comment, en retour des métamorphoses qu’elle subissait, elle a remodelé le corps et l’esprit des humains.
L’ouvrage tient de la superproduction. Le récit couvre trois millions d’années au bas mot. Évidemment, il n’est pas question de tout raconter en quelques centaines de pages. Nous allons mettre en scène des moments clés, revenir sur des histoires pivots. Et nous avons embauché quelques acteurs pour mieux incarner ce drame planétaire.
Le principal acteur s’appelle Singe. Parce que de tous les animaux, c’est le plus proche de nous. En fait, nous sommes un « singe nu (1) ». La figure de Singe offre donc un merveilleux condensé de l’humanité prise dans son ensemble. Mieux, elle s’est imposée dans deux des cultures historiquement les plus importantes de la planète, en Chine et en Inde, comme un personnage mythologique de premier plan.
En Chine, Singe, sous le nom de Sun Wukong, est le principal protagoniste du Voyage vers l’Ouest (2). Ce roman picaresque a été écrit au 16e siècle. Il est plus populaire en Chine que le sont ses équivalents occidentaux, Pantagruel, Gargantua, Les Voyages de Gulliver…, en Europe.

©Suzanne Held_Musée Guimet
Le Voyage… se scinde en deux parties. La première met Singe sur le devant de la scène. Il est le paysan parmi les êtres surnaturels, prédestiné à incarner la figure du perdant. Un avorton qui se devrait de vivre dans la fange, palefrenier des autres divinités. Mais Singe est un esprit rusé. Intronisé roi des singes, il s’initie par tromperie aux arts de la sorcellerie, dérobe aux Rois-Dragons une arme magique évoquant les sabres laser de La Guerre des étoiles : un bâton de fer de vingt pieds pouvant être discrètement rétréci aux dimensions d’une aiguille à broder. Et surtout, notre ami pénètre dans le Jardin des Immortels. Un verger de pêches juteuses. Il s’en goinfre, ne laisse pas une trace de pulpe sur les noyaux. L’alarme est donnée. Les Immortels ont perdu leur secret. Ces pêches conféraient l’immortalité à qui en mangeait. Les dieux se mettent en tête de châtier le coupable. Ils envoient leurs plus puissants généraux, le ban et l’arrière-ban des armées célestes. Impossible d’arrêter ce gueux, qui rosse d’importance tous les Immortels qui se présentent. L’ingestion de toutes les pêches d’éternité fournit au chenapan l’énergie d’un réacteur nucléaire.

Seule l’intervention du Bouddha met un terme aux fourberies de Singe. Assailli par les remords de sa vie de paillardise, le héros se voit confier une mission : servir de garde du corps à un moine qui doit voyager vers l’ouest, comprendre de Chine en Inde, afin de régénérer la parole sacrée du bouddhisme à la source des origines. Ce pèlerinage constitue la seconde partie du livre, tout aussi riche en satire sociale et en combats fantastiques que la première. Au service de l’humanité dévote, Singe et ses alliés terrassent toutes les forces chimériques que la nature leur oppose.

En Inde, Singe s’appelle Hanumân. Roi des singes, c’est un animal à la force titanesque, capable de soulever des montagnes, de sauter en un bond de la terre de l’Inde à l’île du Sri Lanka. Dans la grande épopée du Râmayâna, il aide le dieu Râma à voler au secours de sa femme Sîtâ, enlevée par le dieu-démon Râvana. Ce dieu-singe est immensément populaire. Il symbolise la sagesse du peuple, prend la défense des paysans, incarne la générosité de ceux qui n’ont rien d’autre que leur parole. Singe pleure sur les autres, pas sur lui-même, rapporte un proverbe indien.
Ces deux figures offrent une parfaite métaphore de l’humain. Nous allons voir que ce dernier est un hyperprédateur devenu par effraction roi de la Terre. Et, en même temps, qu’il doit son statut si particulier à un sens exacerbé de l’empathie, optimisant la coopération entre humains. Singe est un animal à la vitalité dopée par la culture. C’est en collaborant que l’humanité déplace les montagnes, change le couvert végétal des continents, bondit en un instant de Londres au Japon par voie aérienne.
En utilisant la métaphore de Singe, nous pouvons garder à l’esprit un postulat fondamental : l’humain est un animal. Un animal qui se voit comme exceptionnel. Pourtant, nous peinons aujourd’hui à dire en quoi il se distingue. Il a une culture. D’autres animaux ont fait preuve de culture. Des outils ? Une cognition ? Il n’est pas le seul. Ce qui caractérise l’humain, c’est la dimension qu’il atteint dans la mise en œuvre de ces traits : aucune autre espèce ne peut altérer à ce point la nature.
C’est donc la saga de Singe, concentré de l’humanité entière, que nous allons entendre. Gardons à l’esprit que l’animal est toujours un trickster, un tricheur. À l’image de Loki, fourbe divinité scandinave du feu. Ou de Prométhée, le titan polytechnicien. Celui qui apporta le feu à l’humanité et lui permit, en maquillant les sacrifices, de tromper les dieux, de leur dérober la part de viande la plus juteuse. Pour expier ses crimes, Prométhée fut enchaîné par Zeus, le roi des dieux, au sommet d’une montagne. Chaque jour, un vautour venait lui dévorer le foie. Et chaque nuit, l’organe repoussait.
Prométhée est souvent utilisé comme métaphore d’une divinité tutélaire incarnant notre époque technicienne, marquée par une Révolution industrielle qui a été celle du feu. Nous verrons comment l’humanité a libéré les forces telluriques du charbon et du pétrole. Et comment elle le paye de souffrances qui lui rongent parfois les organes, comme le font les perturbateurs endocriniens.
La saga de Singe se décline en sept Révolutions (voir l’encadré en fin d’article), qui feront l’objet de chapitres dédiés. Ces Révolutions se conçoivent avec des majuscules, car elles sont autant de processus évolutifs majeurs (3). Ces sept Révolutions ont été préparées par de longues périodes d’adaptation. Leur rythme d’enchaînement est devenu progressivement plus rapide, alors que se faisaient de plus en plus sentir les effets cumulatifs de la culture humaine. Il a fallu sept à cinq millions d’années pour capitaliser les effets de la Révolution biologique, qui a transformé un primate quadrumane et frugivore en humain bipède, omnivore et utilisateur d’outils. Plusieurs centaines de milliers d’années ont préparé la Révolution cognitive. Quelques dizaines de milliers d’années ont fourni le préalable nécessaire pour permettre la Révolution agricole, à la faveur d’un coup de chaud planétaire. La Révolution morale s’est amorcée en quelques milliers d’années. La Révolution énergétique a vu le jour en une poignée de siècles. S’en est suivie, en quelques décennies, la Révolution numérique. La prochaine Révolution, évolutive, ne prendra que quelques années – en fait, nous y sommes déjà.
Singe a imprimé au temps une formidable accélération.
Le décor est posé : ce sera la planète entière et ses différents milieux. Singe, le premier rôle, a signé sans regimber. Le scénariste est votre serviteur, journaliste de profession, guide, conférencier et formateur en histoire mondiale, plongé dans la World History depuis une douzaine d’années. Pas de film sans script. Comment embrasser une histoire planétaire sur trois millions d’années ? Il faut une méthode : l’histoire globale. Un champ : l’histoire environnementale mondiale.
Pour une histoire globale
La Global History s’est développée aux États-Unis depuis un demi-siècle. Je m’emploie depuis 2005 à en populariser les acquis en langue française, de concert avec quelques universitaires, dont le regretté économiste Philippe Norel (décédé en 2014) et le géohistorien Vincent Capdepuy. L’histoire globale peut être définie comme une méthode permettant d’explorer le champ de l’histoire mondiale, soit l’ensemble des passés de l’humanité, de ses débuts balbutiants en Afrique voici trois millions d’années à la globalisation contemporaine (4). C’est l’outil vivant qui permet de produire cette histoire mondiale, animé par quatre brins d’ADN : 1) L’histoire globale est transdisciplinaire. Elle associe à parts égales les autres disciplines des sciences humaines, telles l’économie, la démographie, l’archéologie, la géographie, l’anthropologie, la philosophie, les sciences de la société, la biologie évolutionniste… 2) Elle analyse le passé sur la longue durée. 3) Elle porte ses regards sur un espace élargi. 4) Elle joue sur les échelles, temporelles comme spatiales. Elle restitue un récit qui ouvre grand des fenêtres sur les passés du genre humain, mettant par exemple la focale sur une anecdote biographique, avant de s’ouvrir aux implications globales de cet événement : un paysan perd sa récolte en 1307 ? Serait-ce parce que la planète subit un coup de froid ? Et que nous dit ce coup de froid du présent réchauffement climatique ?
En 2014, j’ai produit un épais hors-série d’histoire mondiale récapitulant les travaux anglo-saxons en World/Global History (5). Cette synthèse, la première du genre en français, a accru ma prise de conscience de l’importance jouée par le milieu naturel dans l’histoire humaine. Si Singe est acteur de son histoire, le théâtre en reste l’environnement. Le milieu dicte les possibles.
Cette évidence est tue en France parce que l’histoire s’y fait quasi exclusivement par l’étude directe des sources, des archives. Un prérequis qui n’autorise guère les histo- riens à s’éloigner de leur champ de compétence, borné par des limites linguistiques, géographiques, culturelles et temporelles. Certains arrivent toutefois à participer à la production d’une histoire globale. S’ils maîtrisent de nombreuses langues, ils pourront par exemple concevoir une histoire dite connectée, qui envisagera les contacts entre zones civilisationnelles à un moment donné (6). Mais l’histoire globale sur la longue durée, déjà préconisée par Fernand Braudel, leur reste inaccessible tant qu’ils restent enchaînés aux archives. Ce qui aboutit au paradoxe suivant : ceux qui font aujourd’hui de l’histoire globale en France sont géographes, économistes, philosophes, anthropologues… Mais très rare- ment historiens.
Pour un récit environnemental
L’histoire environnementale est officiellement née aux États-Unis dans les années 1970, même s’il est possible d’en retracer d’anciennes généalogies, remontant jusqu’à Aristote et ses contemporains chinois, pour s’attarder sur Montesquieu… Les auteurs états-uniens soulignent évidemment le rôle fondateur de pionniers anglo-saxons, tel George Perkins Marsh. Dans Man and Nature (1864), ce linguiste documente les effets de l’action humaine sur les terres des civilisations de l’Antiquité méditerranéenne, et il en déduit que la déforestation est systématiquement le prélude à la désertification. Il appelle en conclusion, déjà, à restaurer les écosystèmes, forêts, sols et rivières. Et il prie pour qu’advienne une humanité qui collaborerait avec la nature au lieu de la détruire. Le géographe Ellsworth Huntington, dans Civilization and Climate (1915), diagnostique que l’Asie s’aridifie, et que des variations climatiques ont, par le passé, entraîné la destruction de civilisations.
Dans l’après-Seconde Guerre mondiale, le géographe William M. Thomas dirige un Man’s Role in Changing the Face of the Earth (1956). Il y mesure l’ampleur des changements environnementaux d’origine humaine, de la Préhistoire à nos jours. L’historien Roderick F. Nash s’attache un peu plus tard à montrer l’évolution sociale des perceptions de la nature aux États-Unis, dans Wilderness and the American Mind (1967). La même année, le géographe Clarence J. Glacken publie son ouvrage-phare, Traces on the Rhodean Shore (7), une monumentale histoire des attitudes humaines vis-à-vis de la nature en Occident, de l’Antiquité au xviiie siècle. C’est en 1972 que l’historien Alfred W. Crosby Jr porte l’histoire environnementale sur les fonts baptismaux, avec The Columbian Exchange (chapitre 9). Heureux hasard, c’est aussi en 1972 que Roderick F. Nash fonde la première chaire d’histoire environnementale à l’université de Californie-Santa Barbara. L’intérêt de per- sévérer dans cette direction est confirmé en 1976 par l’historien William H. McNeill avec Plagues and Peoples, une analyse magistrale du rôle moteur des microbes dans l’histoire (chapitre 8).
La production éditoriale anglo-saxonne en ce domaine a depuis été colossale. Quelques historiens européens, surtout britanniques, parfois suisses, allemands, néerlandais, et depuis peu français (8), participent à ce mouvement. Si l’Afrique du Sud, l’Inde et l’Australie ont établi une solide tradition d’expertise dans ce champ, les histoires environnementales de la Chine, du Japon, de la Russie ou du Monde musulman restent aujourd’hui encore surtout le fait d’historiens américains.
L’histoire environnementale peut schématiquement se décliner en trois volets : un qui vise à réintroduire la nature dans l’histoire, à l’historiciser ; un qui va étudier l’impact de l’homme sur l’environnement, volet particulièrement sollicité aujourd’hui dans le cadre de la lutte des sociétés contre les atteintes environnementales ; un dernier volet qui va se pencher sur l’impact de l’environnement sur l’homme – par exemple en termes de santé, de trajectoires des sociétés.
La discipline est éclectique par nature. Elle intègre les sciences sociales, la géographie, les sciences physiques et biologiques. Mais elle peine parfois à assembler ses différents volets ; elle est vite accusée de brasser trop large.
Dans ce livre, il sera par exemple question de guerres, de religions, d’idéologies politiques ou d’économie. Parce que ces secrétions des sociétés humaines ne sont pas que sciences sociales. Elles sont aussi autant de modalités d’interaction avec le milieu. Les religions et les idéologies politiques dictent des façons d’interagir avec l’environnement ; l’économie exploite les ressources naturelles ; et la guerre impacte les milieux.
Le film des relations humain-nature
Trois millions d’années, sur la Terre entière, ne tiennent évidemment pas exhaustivement dans un livre de 500 p. tel que celui que Cataclymes. Il a fallu procéder à des choix. Des scènes révélatrices de processus globaux. Il sera par exemple beaucoup question des forêts à l’époque moderne (chapitre 12). Elles seront superficiellement mentionnées à d’autres moments, alors que leurs évolutions ont toujours été cruciales pour les humains. L’éléphant fera souvent irruption sur la scène, quand le saumon sera relégué en coulisses. Pourtant, les deux animaux ont autant de choses à nous apprendre sur les relations de l’humain à la nature. L’Afrique sera moins évoquée que d’autres lieux, car l’historiographie est plutôt avare de sources la concernant. La Chine, l’Inde et l’Europe, les endroits déterminants de l’histoire mondiale telle qu’elle s’écrit aujourd’hui, fourniront des décors récurrents à ce récit.
Avant d’aller plus loin, soulignons une évidence. Comme tout individu du règne animal, un organisme humain a trois obsessions : se nourrir, obsession n° 1. Elle conditionne la survie à court terme ; dormir, obsession n° 2. Elle conditionne la survie à moyen terme ; se reproduire, obsession n° 3. Elle conditionne la survie à long terme.
Je vais vendre la mèche tout de suite et exposer la thèse qui sous-tend cet ouvrage. Comme pour toute espèce animale, notre évolution vise à nous pousser à avoir le plus de descendants possible. Peu importe le confort dont ils disposeront. Nous ne sommes pas programmés pour faire des choix rationnels en matière de nourriture, ni pour nous obliger à faire de l’exercice physique alors que nous vivons dans une société à l’abondance et au confort inégalés. Si tel était le cas, l’obésité progresserait moins vite. La nature, examinée sous la loupe de l’évolutionnisme, se moque de l’individu. Ce qui lui importe, c’est la perpétuation de l’espèce, son expansion. Les individus ne valent que par leur multiplication, pas par leurs qualités. Avec en tête cette obsession n° 3, l’histoire humaine apparaît comme la success-story de Singe, qui a réussi à multiplier sa population à une échelle proprement hallucinante. Mais le trickster ne nous a-t-il pas induit en erreur ? N’avons-nous pas signé un pacte faustien ? Y aura-t-il un prix à payer à la fin de l’histoire ?
Singe a réussi un exploit sans précédent : il a altéré son milieu au-delà de ce qui était concevable. Mais si nous métamorphosons notre environnement, jamais nous ne nous affranchissons de son influence. Tel Prométhée, nous avons dompté le feu… Pour découvrir qu’il nous dévore de l’intérieur. Singe a terrassé les épidémies, il vit mieux et plus longtemps. Mais il le paye de cancers, de diabètes et de maladies cardio-vasculaires, dont une bonne part est causée par les invisibles altérations qu’il a infligées à l’environnement.
Tout livre se doit d’être sélectif, et je ne pense pas qu’il existe une bonne méthode pour explorer l’histoire, spécifiquement quand il faut travailler à de très larges échelles temporelles, spatiales et disciplinaires. De même qu’il n’existe pas de journalisme neutre, il n’existe pas d’historien exposant une « histoire réelle ». Toute histoire s’écrit à partir du vécu subjectif de son auteur. J’ai essayé d’éviter les pièges d’une « histoire-tunnel », dénoncée par le géographe James M. Blaunt, qui voudrait que l’on parte du présent pour expliquer, à la lumière du passé, pourquoi on ne pouvait évidemment que se retrouver là où on est. Si l’histoire était aussi téléologique, cela fait belle lurette que les mathématiciens exerceraient un monopole absolu sur la production du savoir historique.
L’histoire est une matière malléable. À tout moment, elle aurait pu déboucher sur d’autres trajectoires. Il importe de bien le comprendre. Parce que le champ des possibles reste ouvert en matière environnementale. En 1048, si les digues du fleuve Jaune avaient été suffisamment consolidées pour résister à la crue dévastatrice qui allait emporter l’empire des Song (chapitre 7), le destin du Monde aurait peut-être été différent. En 2009, si le nouveau président des États-Unis Barack Obama avait choisi, comme l’a fait l’Islande, de faire porter la responsabilité et le dédommagement de la crise des subprimes sur les banques, nous vivrions peut-être un autre présent (9). Il ne s’agit pas de produire ici une histoire contrefactuelle (10), mais de rappeler que nous pouvons toujours influer sur notre futur. J’espère juste qu’exposer certains des éléments clés de notre longue vie commune avec Dame Nature nous permettra de réfléchir plus clairement à l’avenir que nous souhaitons. Puissions-nous faire les choix vitaux qui s’imposent.
La bande-annonce s’achève, les lumières se sont éteintes dans la salle. Le rideau se lève sur la savane africaine, là où commence notre histoire…
Laurent Testot
Les sept Révolutions

1) Révolution biologique (dite aussi corporelle, il y a environ trois millions d’années) : apparition d’Homo et des outils, de la bipédie, de la course, du jet de projectile et de l’alimentation omnivore, expansion planétaire ; Singe devient humain (chapitre 1).
2) Révolution cognitive (dite aussi symbolique, entre -500 000 et -40 000) : feu, art et langage, domination du milieu et disparition de tous les Homo, à l’exception de sapiens ; Singe devient chasseur (chapitre 2).
3) Révolution agricole (dite aussi néolithique, s’amorce voici près de douze millénaires) : entraîne la domestication de la nature et un premier boom démographique ; Singe devient paysan (chapitre 3).
4) Révolution morale (dite aussi axiale, prend place il y a 2500 ans) : des sociétés entrant en connexion sur de longues distances génèrent des collectivités – empires et religions – à vocation universelle, collaborant plus efficacement à l’exploitation des milieux ; Singe devient religieux (chapitre 5).
5) Révolution énergétique (dite aussi industrielle, v. 1800) : le choix de brûler des carburants fossiles à des fins énergétiques fait basculer l’humanité sur une nouvelle trajectoire. Comme les précédentes, cette révolution est multifacette : chacun peut, suivant sa discipline de prédilection, la dire scientifique, militaire, économique, démographique, en choisissant de mettre l’accent sur un des processus qui la composent… L’essentiel réside dans son effet : une unification du Monde sous hégémonie européenne, suivie d’une modification globale de l’environnement planétaire et d’une entrée dans l’Anthropocène ; Singe devient ouvrier (chapitre 13).
6) Révolution numérique (dite aussi médiatique, v. 2000) : les technologies de communication connectent densément la planète entière en temps réel ; Singe devient communicant (chapitre 16).
7) Révolution évolutive ? (dite aussi démiurgique, dans le courant du 21e siècle). Deux grandes tendances coexistent : 1) la « Grande Convergence » des technologies NBIC – nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences de la cognition – entraîne l’apparition de nouvelles entités (humains augmentés, cyborgs, intelligences artificielles…), qui remplaceront ou coexisteront avec l’humanité ; 2) l’incapacité de l’humanité à changer de comportement altère l’environnement planétaire à tel point que les humains se transforment involontairement en « mutants » adaptés à la nouvelle donne écologique de l’Anthropocène. Singe deviendra dieu, ou à défaut mutant (chapitre 17).
L’avenir, imprévisible par essence, devrait se situer entre ces deux polarités. Peut-être les mêlera- t-il ? Il est facile d’imaginer une élite de super-riches prolongeant indéfiniment leurs précieuses existences par de coûteuses techniques, alors que le commun des mortels souffrira d’atteintes environnementales croissantes. L.T.
Sommaire de Cataclysmes. Une histoire environnementale de l’humanité
9 Introduction
10 La saga de Singe
14 Pour une histoire globale
15 Pour un récit environnemental
17 Le film des relations humain-nature
20 Encadré : Les sept Révolutions
Première partie : Et Singe conquit le monde
15 Chap. 1 – Nous sommes les enfants du climat
25 La course à mort
27 D’où venons-nous ?
32 L’exception humaine
34 Au commencement était le Grand Échange
39 Puis surgit un Singe nu
44 Un primate bricoleur, nouveau seigneur de la Création ?
46 Du besoin d’être gras pour nourrir sa grosse tête.
46 Chap. 2 – La fin des éléphants
51 Un mastodonte, c’est révolutionnaire…
54 Le tueur empathique
58 Après l’avoir haché menu, cuire le monde
60 Il y a 100 000 ans régnaient les géants
65 La carrière fratricide du Singe savant
68 Nous sommes tous des métis
71 L’Australie, ou comment flamber un continent
75 Certains primates seront plus égaux que d’autres
79 Chap. 3 – Le pacte du blé
79 Modeler les gènes
81 Un coup de chaud décisif
85 Trois céréales, une seule révolution ?
88 L’agriculture, une invention globale
92 Le contre-exemple des Amériques
96 Aux racines de tous les maux ?
100 La soumission des animaux
106 Le prix du confort
111 Chap. 4 – Effondrements
111 Un trésor de cuivre et d’étain
113 Ötzi, témoin d’un temps intermédiaire
117 Âge de Bronze, âge d’Or ou âge d’Argent ?
120 Une parfaite tempête
123 Une invention décisive : l’écriture
Deuxième partie : Et Singe domina la nature
129 Chap. 5 – Quand les dieux montrent la voie
129 Le devoir des guerriers
133 La règle d’or
135 Quatre idéologues chinois
138 Trois voies indiennes vers le salut
142 Pour un Dieu unique
146 Au miroir de la philosophie
150 Le temps des échanges
153 Chap. 6 – Tout empire périra
153 L’éléphant, une arme à double tranchant
156 La retraite des pachydermes
160 Les trois dimensions de la monnaie
164 Rome, empire de citoyens
167 Chine, empire de fonctionnaires
171 Inde et Asie centrale, empires de délégués
173 Une succession de crises avant l’Apocalypse
179 Chap. 7 – Après l’été vient l’hiver
179 Le destin des empires
181 Et l’Europe devint Chrétienté
185 L’année de l’éléphant
189 La Révolution verte islamique
193 Le mystérieux rhinocéros d’or
195 Une crue et le Monde bascule
200 Gengis Khan ou la colère d’Allah
203 De l’influence du chaud et du froid sur l’histoire
207 Chap. 8 – Hasards biologiques
208 La jungle des mythes
210 La guerre des invisibles
214 Un certain sentiment d’apocalypse
218 Microbes : la leçon du lapin
222 Le grand corps malade de l’humanité
225 Poux et moustiques, briseurs d’empires
227 Est-il possible d’arrêter les tueurs ?
231 Chap. 9 – Aléas démographiques
232 Des vers et du tabac
235 L’Échange colombien
236 Les empires biologique
239 Le cheval, conquête comanche
242 Indigestions chinoises
244 Du sucre et des souffrances
250 Pourquoi nous avons mangé les momies
Troisième partie : Et Singe transforma la Terre
255 Chap. 10 – Les promesses du vif-argent
256 La malédiction d’Oncle Tío
260 Tout l’argent du Monde
263 Moutons, harengs, castors : quand le capitalisme balbutie
266 Chine et Inde, les bénéficiaires de l’échange inégal
269 Sur les mers tonne le canon
275 Chap. 11 – Quand la Terre s’enrhuma
276 L’histoire peut-elle geler à mort ?
278 Le Groenland, Verte-Terre ?
281 Le dernier bourbier des Ming
283 Trois hivers ottomans
286 La gâchette révolutionnaire
289 Dans l’œil du cyclone
291 Chap. 12 – Mourir pour la forêt
292 La sève et le sang
294 Le nom du Monde n’est plus forêt
298 Le capitalisme contre l’empire
302 L’opium, une monnaie comme les autres
304 La Grande Divergence
307 L’écorce des jésuites
311 Chap. 13 – L’énergie sans limites
311 Pas de combustion sans fumée
315 Le choix du feu
317 Un grand bond vers le haut.
320 Maîtriser le temps et les distances
324 La peur du nombre
326 Le contre-sens de l’État effacé
328 L’humain au centre
331 La démocratie, une question d’énergie ?
334 L’or noir, aubaine pour régimes autoritaires
337 L’abolition morale, du bon usage de l’esclavage
341 Chap. 14 – Le frisson de la catastrophe
342 L’année où le Monde gela à mort
346 Le cas de conscience du docteur Frankenstein
348 La menace solaire
350 De quoi l’île de Pâques est-elle la métaphore ?
355 La dernière rhytine
360 Les augures du réchauffement
367 Chap. 15 – Le temps de la démesure
368 La guerre au vivant
371 Les deux visages de Fritz Haber
374 Terres de mort
381 Poussière et misère
383 Le silence des bisons
389 Résoudre une crise écologique, mode d’emploi.
395 Chap. 16 – Le troupeau aveugle
396 Le triomphe des médias
401 La Grande Accélération
406 La rançon du gratuit
408 Les trois thèses de la multitude
410 Le pouvoir disruptif des réseaux
413 Chap. 17. Quelle humanité demain ?
413 Le quatrième pouvoir de Jack
415 La tentation de l’amortalité
419 L’inconnue de la singularité
426 Tous mutants qui s’ignorent
435 Chine, métaphore d’un futur accéléré
441 Le climat, point aveugle du capital
447 Conclusion
455 Notes
477 Glossaire
483 Chronologie
487 Tableau : Évolution de la population mondiale de -10 000 à 2050
491 Bibliographie
509 Index nominum
513 Index rerum
(1) Selon la belle expression du zoologiste Desmond Morris, Le Singe nu, traduit de l’anglais par Jean Rosenthal, Paris, Le Livre de Poche, 1971, rééd. 2002.
(2) Wou Tch’eng-En, Le Singe Pèlerin ou le Pèlerinage d’Occident, traduit de l’anglais par George Deniker, Paris, Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 1992.
(3) Ces Révolutions sont aussi des chrononymes, des époques définies qui, à l’instar des lieux géographiques (dont le nom fait toponyme et induit l’usage d’une majuscule), ont une localisation précise, temporelle au lieu d’être spatiale.
(4) Pour l’exposé des approches méthodologiques, je renvoie le lecteur intéressé à Laurent Testot (dir.), L’Histoire globale. Un nouveau regard sur le Monde, Auxerre, Sciences Humaines Éditions, 2008, rééd. 2015.
(5) Laurent Testot, « La nouvelle histoire du Monde », Sciences Humaines Histoire, n° 3, décembre 2014-janvier 2015. Se sont particulièrement distingués dans ce domaine, au point d’être traduits en de multiples langues dont le français : Yuval Noah Harari, Sapiens. Une brève histoire de l’humanité, traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Albin Michel, 2015 ; Jared Diamond, De l’inégalité parmi les sociétés. Essai sur l’homme et l’environnement dans l’histoire, traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Galli- mard, 2000, rééd. 2007 ; Ian Morris, Pourquoi l’Occident domine le monde… pour l’instant. Les modèles du passé et ce qu’ils révèlent sur l’avenir, traduit de l’anglais par Jean Pouvelle, Paris, L’Arche, 2011.
(6) On songe ici à Serge Gruzinski, L’Aigle et le Dragon. Démesure européenne et mondialisation au 16e siècle, Paris, Fayard, 2012 ; Romain Bertrand, L’Histoire à parts égales. Récits d’une rencontre Orient-Occident, Paris, Seuil, 2011; Sanjay Subrahmanyam, L’Éléphant, le Canon et le Pinceau. Histoires connectées des cours d’Europe et d’Asie, 1500-1750, traduit de l’anglais par Béatrice Commengé, Paris, Alma, 2016. Tous historiens étudiant les débuts de l’époque moderne.
(7) Traduit en français sous le titre Histoire de la pensée géographique, 4 tomes, Paris, Éditions du CTHS, 2000.
(8) À la suite des travaux pionniers sur le climat d’Emmanuel Le Roy Ladurie a émergé une nouvelle génération : Grégory Quenet, Christophe Bonneuil, Jean-François Mouhot…
(9) Scénario évoqué dans Naomi Klein, Tout peut changer. Capitalisme et changement climatique, 2014, traduit de l’anglais (Canada) par Geneviève Boulanger et Nicolas Calvé, Arles et Montréal, Actes Sud/Lux, 2015, p. 152.
(10) Pour des réflexions en français sur l’histoire contrefactuelle, voir Quentin Deluermoz, Pierre Singaravelou, Pour une histoire des possibles. Analyses contrefactuelles et futurs non advenus, Paris, Seuil, 2016 ; et Florian Besson, Jan Synowiecki (dir.), Écrire l’histoire avec des si, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2015.