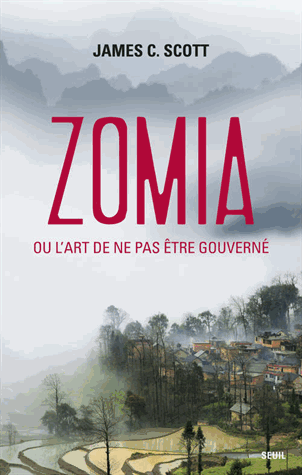À propos de :
Zomia, ou L’Art de ne pas être gouverné
James C. Scott [2009], The Art of Not Being Governed. An anarchist history of Upland Southeast Asia, Yale University Press, 2009, trad. fr. Nicolas Guilhot, Frédéric Joly et Olivier Ruchet, Paris, Seuil, 2013.
Anthropologue, James C. Scott se revendique de l’anarchisme. S’appuyant sur les thèses que Pierre Clastres avait posées en observant les sociétés indiennes d’Amérique du Sud [La Société contre l’État, Minuit, 1974], il livre ici une très dense histoire des zones montagneuses d’Asie du Sud-Est, défendant l’idée que ce massif montagneux d’Asie du Sud-Est aurait vu se maintenir un état particulier, et autrefois planétairement partagé, des communautés humaines : le refus de la soumission à l’État.
La Zomia, tel est le nom consacré donné à cette région depuis une décennie. Elle s’étend, selon les auteurs, de la Chine du Sud à la Birmanie (soit 2,5 millions de km2, abritant 100 millions de personnes), ou se prolonge jusqu’à l’Afghanistan (Zomia 2). Peu importe les limites, puisque le propre des communautés qui l’habitaient était de les refuser. Scott tranche d’emblée : est Zomia toute étendue qui, en Asie continentale, orientale et australe, occupe un relief d’une altitude supérieure à 300 m. La conséquence : en plaine, des zones propices à la production céréalière et au contrôle étatique des populations. En hauteur, des terres livrées à l’agriculture vivrière et/ou au semi-nomadisme, d’une grande diversité écologique, caractérisées par la présence de populations fuyant l’État. La Zomia, précise l’auteur, se trouve à la périphérie de neuf États et au centre d’aucun.
La 24e édition du Festival international de géographie de Saint-Dié des Vosges, du 3 au 6 octobre 2013, étant consacrée à la Chine, nous allons donc explorer ses marges australes. Scott se concentre sur les tribus habitant la Chine du Sud et de l’Est, ainsi que les hautes-terres du Viêtnam, de Thaïlande, de Birmanie, du Laos… Hmong, Akha, Liao, Karens, Lahu, Wa… Leurs noms sont aussi nombreux que leurs spécificités sociales, vestimentaires, etc. Cette hétérogénéité, pour autant, n’est pas exclusive : on y passe facilement d’une identité à une autre.
La Zomia serait « la dernière zone du monde dont les peuples n’ont pas été intégrés à des États-nations », du moins, nuance-t-il, avant que les années 1950 ne voient les stratégies d’« engloutissement » étatiques, les « technologies destructrices de distance » (voies ferrées, aviation, téléphone, technologies de l’information…) atteindre un niveau de performance tel que les reliefs labyrinthiques des monts d’Asie, qui jusqu’ici avaient épargné à leurs habitants la souveraineté des États voisins, n’ont plus été en mesure de jouer leur rôle protecteur. La démonstration est érudite. L’ensemble des données brassées a permis à plusieurs spécialistes une chasse à l’erreur plus ou moins fructueuse. Mais ce type de thèse généraliste se prêtant facilement à l’exercice, mieux vaut examiner la thèse de fond.
Scott fait de cet état de « peuples se gouvernant eux-mêmes » le propre de l’humanité depuis la monté en puissance des États, qu’il voit comme débutant au début de l’ère chrétienne. À ce stade, une objection vient déjà à l’esprit : les États ont existé bien avant, comme il le reconnaît, en Égypte, en Mésopotamie, en Chine, etc. Mais ils ne contrôlaient, selon lui, qu’une part négligeable de la population mondiale – affirmation discutable, si on admet que l’État ne peut émerger que dans des endroits densément peuplés, propices à une segmentation de la population en classes de spécialistes se consacrant à des tâches définies : l’agriculture, la guerre, le gouvernement, la religion… La caractéristique des peuples sans État est que ceux qui y vivent peuvent se livrer à tout ou partie de ces tâches, d’accord. Mais comment expliquer que ces sociétés sans État, qui auraient joui d’une démographie supérieure à celle des États, se soient contenté de refluer progressivement devant l’avancée, pour la moitié nord de la Zomia par exemple, de l’État chinois de l’ethnie Han ?
La principale faiblesse de la thèse de Scott est qu’elle repose sur un leitmotiv : vouloir « déconstruire les discours de civilisation », la frontière séparant le barbare du civilisé, le cru du cuit, le primitif du moderne est bien sûr louable. Ne présenter ces sociétés que par le biais de « l’histoire de l’absence d’État, délibérée et réactive », revient pourtant à leur prêter comme moteur un refus conscient et constant de la coercition étatique. C’est un exercice d’équilibrisme, dont Scott se tire avec maestria. Tout son art consiste à souligner que certes, sur la longue durée, l’histoire nous montre que les États sont des prédateurs pour leurs marges : ils en extraient des matières premières, des travailleurs forcés, n’ont de cesse de s’approprier ces espaces pour les recenser, leur extorquer des ressources et en assimiler les populations. Et oui, partout où l’on trouve des montagnes, on y voit de la diversité ethnique, car toute minorité a historiquement tendance à y trouver refuge. Le patchwork ethnique afghan comme la carte des minorités confessionnelles de Syrie en atteste. Mais ces communautés ont plus probablement exploité un état de fait (on se préserve mieux de la violence de la majorité en occupant des endroits faciles à défendre ou propices à l’esquive) que cherché consciemment et méthodiquement à passer entre les mailles du filet étatique.
En paraphrasant une formule célèbre, il est facile de défendre que « l’air de la montagne rend libre. » Scandant ce refrain, l’ouvrage campe une histoire formidable, rendant aux sans-voix (les habitants de la Zomia ont souvent refusé l’écrit) et aux minorités opprimées leur place. On saura aussi gré à l’auteur d’entreprendre une histoire de la construction étatique refusant tout évolutionisme et tout téléologisme. Mais Scott souligne à l’envi dans cette longue saga la présence d’une main invisible et omniprésente, celle d’un refus conscient et répété de la domination de l’État. Un historien moins préoccupé de calquer le concept moderne d’anarchisme sur la longue durée y verrait plutôt une influence du milieu favorisant certains développements : les zones montagneuses étant propices à la survie des minorités, celles-ci s’y sont concentrées. Soumises à la pression des voisins, elles y ont développé des techniques d’esquive – comme une agriculture souple, générant des surplus récoltables à dates diverses et facilement dissimulables. Par leurs reliefs accidentés, leurs populations clairsemées, ces régions obéraient l’extension des États, jusqu’à l’avènement des technologies du 20e siècle – et en cela, Scott voit juste. La Zomia n’est désormais qu’un musée exotique, les costumes traditionnels ne se portent plus guère que pour les fêtes ou les touristes, et tout un chacun y abolit désormais quotidiennement la distance à grand renfort de téléphone portable.