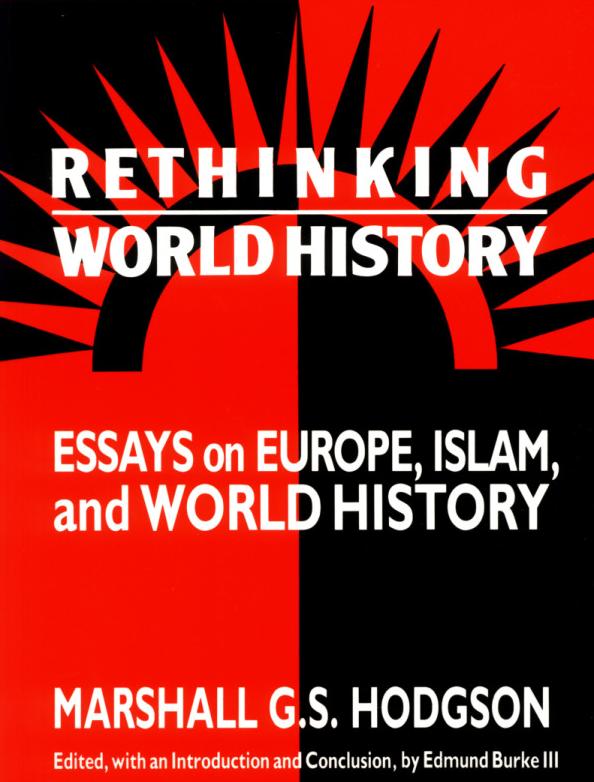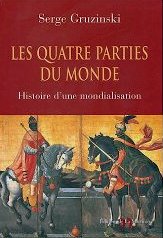Marshall Hodgson est certainement, avec William McNeill, l’un des deux piliers de la “world history”, donc aussi par extension de l’histoire globale. Nous proposons ici de relire (ou lire) l’ouvrage principal qu’il nous a légué, malheureusement incomplètement traduit en français et intitulé Rethinking World History – Essays on Europe, Islam and World History.
Cet ouvrage, publié en 1993 aux Cambridge University Press, est en fait un recueil de quelques-uns des principaux textes de l’auteur prématurément disparu en 1968, à l’âge de 46 ans. Il s’agit d’un texte fort, parfois difficile, qui marie remarquablement la compétence de l’auteur en tant qu’historien de l’Islam et un vrai souci méthodologique. À ce titre, et plus encore que dans les ouvrages de McNeill (auquel Hodgson s’est souvent opposé), on trouvera ici les réflexions les plus fondatrices sur le projet d’une histoire « interrégionale », ou « à grande échelle » comme l’auteur la qualifiait le plus souvent. Si le texte du livre est parfois répétitif dans la mesure où les écrits d’origine n’ont pas été retouchés dans la perspective de former un ouvrage finalisé, il reste une source incontournable pour tout « historien global » aujourd’hui. Nous ne pourrons en traiter que partiellement ici, en choisissant quelques chapitres seulement, éventuellement les plus significatifs.
La première partie du livre s’intitule « L’Europe dans un contexte global » et constitue, sans doute encore aujourd’hui, une des plus brillantes analyses de l’eurocentrisme.
Hodgson entame le débat dès son chapitre 1, avec cette constatation géographique que l’Inde, pourtant plus peuplée et aussi diverse que l’Europe, à peu près d’égale étendue, est une (petite) partie du continent asiatique quand l’Europe est un continent à elle seule… S’il en est ainsi, c’est d’abord parce que nos ancêtres l’ont voulu. En instituant l’Europe comme un « continent » à part entière, ils l’ont séparée du reste du Monde, créant l’illusion du « nous » et du « eux » et justifiant au passage de l’étudier de façon plus détaillée que les autres régions comparables. C’est aussi parce qu’ils ont privilégié la projection Mercator (dont on sait qu’elle surestime les proportions des terres de l’hémisphère Nord) pour dessiner le planisphère, au prétexte qu’elle respecte les contours maritimes et les angles des terres immergées. Pourtant, ajoute Hodgson, « si on n’utilise pas la carte pour naviguer mais pour situer et comparer d’un coup d’œil les différentes parties du monde, alors les formes et les surfaces sont plus importantes que les angles ». Ceci n’est pas neutre et induit une conséquence délétère cruciale : en dilatant la surface relative de l’Europe, la projection de Mercator nous permet de situer beaucoup plus de détails, villes, rivières et montages, en Europe, que partout ailleurs.
A côté du tableau tiré de la géographie, l’image historique n’est pas en reste. Ainsi le cours de l’histoire s’intéresse au Proche-Orient jusqu’aux Grecs (mais plus après), aux Grecs jusqu’à la chute de l’Empire romain (mais plus après – les Byzantins ne font pas partie du « flux » principal), ensuite à l’Europe occidentale de l’âge des ténèbres (alors que monde musulman, Chine et Inde étaient plus « civilisés » à l’époque). Le mainstream historique ainsi établi identifie l’Occident. Et définit le reste par opposition. Avec au passage quelques curiosités : la Grèce classique fait partie de l’Ouest alors que le monde byzantin est clairement situé dans l’Orient…Dans l’opération, nous établissons notre Occident comme équivalent conceptuel de toutes les autres régions civilisées prises ensemble. Et comme nous avons moins d’informations sur « elles », que leur dynamique historique ne s’impose pas à nous, que le mainstream de l’histoire est censé passer à travers l’Europe, leur histoire est donc statique. Dès lors l’Occident, qui était déjà une moitié de l’humanité, devient spontanément la plus significative…
Si on rentre dans le détail, une tendance assez générale chez les historiens a distingué quatre grandes régions, l’Occident, le Proche-Orient (Turco-Arabo-Persan), l’Inde et la Chine, en les supposant compréhensibles en elles-mêmes, sans prendre en compte leurs relations mutuelles. Ces dernières sont cependant tout sauf anecdotiques, « reflètent des séquences d’événements et des modèles culturels qui s’imbriquent les uns dans les autres à tous les niveaux ». Si bien que ces quatre grandes régions (et d’autres avec elles) constituent toutes ensemble un grand complexe historique de développements culturels. Et qu’il n’est pas plus facile de les distinguer que de séparer des nations à l’intérieur d’un même bloc régional. Et ce d’autant moins qu’elles sont issues d’un même substrat, à savoir la révolution néolithique débouchant sur un processus conjoint d’urbanisation. Si l’on cherche à dépasser ces identités régionales pour repérer des « sociétés supranationales », à la Toynbee, on est vite confrontés à l’impossibilité de fixer ce qui caractérise les « champs intelligibles » recherchés. Même les religions qui semblent fournir les marqueurs les plus pertinents apparaissent vite comme transcendant les lignes de frontière (y compris l’islam). Il en va de même des langues ou des littératures que beaucoup d’historiens ont absolutisées à l’excès comme marqueurs de « mondes historiques ». Au total, c’est bien une histoire commune à l’espace de civilisation afro-eurasiatique qui s’impose, rendant illusoire toute division stable de cette zone. Les pages consacrées par Hodgson à structurer cette histoire commune (pp. 17-28) sont peut-être ses plus percutantes. Sans les reprendre ici dans toute leur précision, disons qu’elles marquent déjà une certaine pensée systémique, l’auteur montrant abondamment comment un changement au sein de la configuration interrégionale en entraînait d’autres. À commencer par la métallurgie qui, imposant la recherche de minerais, déterminera une expansion progressive des modèles de civilisation à tout l’hémisphère oriental du monde, pour donner une configuration globale au premier millénaire avant notre ère. C’est cette configuration qu’exprimera la tentative d’Alexandre, cet homme « pressé de descendre le Gange et préoccupé de saisir par l’esprit ce monde afro-eurasiatique comme un tout géographiquement réalisable ». C’est elle aussi que caractérisera la période axiale, chère à Jaspers, laquelle différenciera les cultures mais déterminera parallèlement un progrès irréversible des échanges entre régions et débouchera sur « des standards intellectuels permettant les influences réciproques entre cultures au niveau de la pensée abstraite ». Et dans cette configuration, Hodgson montre clairement que l’Europe ne fut d’abord qu’une périphérie, à peu près jusqu’aux croisades, une zone de développement frontalier, peut-être comme le Soudan ou la Malaisie à la même époque… En témoignerait notamment le faible intérêt des lettrés, dans l’Islam des trois premiers siècles, pour l’Occident, comparé à leur connaissance de l’Inde, de la Chine et de Byzance, voire même de l’Afrique de l’est ou du Tibet.
Nous laisserons de côté ici les chapitres 2 et 3 de cette première partie, tout comme les chapitres 5 et 6, assez courts et partiellement redondants avec le premier, pour nous consacrer au chapitre 4, le plus fondamental, consacré à la « grande transmutation occidentale ». Dans ce texte, Hodgson considère cette transmutation comme ayant eu deux conséquences majeures, la révolution industrielle britannique et la Révolution française, elles-mêmes liées à l’hégémonie nouvelle de l’Europe sur le monde depuis environ 1600. C’est donc dire que cette transformation ne se réduit pas à ces deux ou trois événements, qui lui sont postérieurs. Elle serait comparable à la mutation qui est survenue après le Néolithique quand l’urbanisation, l’usage de l’écriture et l’apparition d’organisations politiques complexes ont, suivant la tradition, fait passer de la préhistoire à l’histoire, créant ainsi une situation irréversible. La mutation de la modernité, pour sa part, survient d’abord en Occident mais n’aurait pas pu avoir lieu sans l’accumulation d’inventions et de découvertes bien antérieures au sein de l’espace afro-eurasiatique. Par ailleurs, elle n’aurait pas été possible sans l’existence de « vastes aires de populations urbaines relativement denses et reliées entre elles par un grand réseau commercial interrégional, formant ce vaste marché propre à l’hémisphère oriental du monde et sur lequel les Européens allaient pouvoir faire leur fortune et exercer leur imagination ». Cette mutation moderne, qui apparaît en Europe, n’en est donc pas moins un phénomène d’essence globale, préparé progressivement au sein de l’hémisphère oriental du monde.
En Europe même, cette mutation intervient précisément aux 17e et 18e siècles. En ce sens, la Renaissance n’en constitue qu’une phase préparatoire, les Occidentaux restant alors au mieux à parité avec le monde musulman et du reste toujours sous la menace des Ottomans. Durant la période entre 1600 et 1800, c’est sans doute une forme de rationalisation des décisions qui vient se substituer à la tradition, rationalité désormais fondée sur le « calcul pratique de l’avantage immédiat ». Mais Hodgson nous précise d’emblée que des dynamiques de rationalisation similaires sont apparues de façon récurrente dans l’histoire afro-eurasiatique, notamment chaque fois qu’une nouvelle religion s’implantait (on le reverra dans la deuxième partie du livre dans le cas de l’islam). Ce qui caractérise spécifiquement la transmutation moderne, c’est l’apparition d’une « rationalité techniciste » qui permet de « changer les modèles d’investissement du temps et de l’argent ». Et cette forme de rationalisation, loin de s’éteindre après quelques années sous l’effet de la tradition, va progressivement s’institutionnaliser et, ce faisant, devenir irréversible. Elle va en conséquence permettre l’exploitation d’opportunités crédibles et durables, pour des individus investissant de façon innovante ou simplement exerçant leur créativité culturelle, de quelque ordre qu’elle soit. Dans ces conditions nouvelles, « le capital allait être systématiquement réinvesti et multiplié sur la base d’une innovation technique continue et d’une expansion anticipée des marchés ». Au cœur de ce processus se trouve donc une technicisation, définie comme une « possibilité de spécialisation technique liée à un calcul rationnel, au sein de laquelle les différentes spécialisations sont interdépendantes sur une échelle assez grande pour déterminer des modèles d’anticipation dans les secteurs clés de la société ». Autrement dit, la technicisation ne se réduit pas à la possibilité d’utiliser des techniques nouvelles ; elle signifie plutôt une condition pour que les anticipations des acteurs convergent, se confirment mutuellement, déterminant ainsi la poursuite d’un processus dynamique. Dans le champ économique, on pourrait interpréter le phénomène ainsi : la spécialisation technique assurant l’efficacité, donc la baisse des coûts et sans doute des prix de vente, déterminera un élargissement du marché, donc une possibilité de débouché qui justifie en retour l’investissement technique initial. Mais le même processus concernerait l’administration et, à la fin du 18e siècle, l’efficacité bureaucratique européenne aurait déjà dépassé le niveau atteint dans la Chine des 11e-13e siècles. Du reste, Hodgson n’hésite pas à suggérer qu’au final « l’Occident semble avoir été l’héritier inconscient de la révolution industrielle avortée de la Chine des Song » tant par les nombreux emprunts technologiques qui seront déterminants dans notre révolution industrielle que par l’imitation du système chinois de recrutement des fonctionnaires…
La deuxième partie de l’ouvrage traite du rôle de l’Islam dans l’histoire globale, notamment de ses relations à la modernité.
Pour Hodgson, non seulement le monde musulman occupait une position centrale sur le continent afro-eurasien mais encore « s’exprimaient en lui certaines pressions culturelles cosmopolites et égalitaristes (en tout cas non traditionnelles) qui avaient pris naissance dans les régions les plus anciennes et centrales de la société musulmane ». Il devait par ailleurs déployer, jusqu’au 18e siècle, une puissance politique et militaire, liée à une culture vivante et sophistiquée (notamment dans les arts et les sciences), qui interdit de parler de décadence (sauf peut-être dans le domaine économique), à partir du 11e siècle, comme on le fait encore trop souvent. Et si l’Islam a connu une telle influence durant plus d’un millénaire, il le doit aussi et surtout au succès de la religion musulmane.
Les raisons de la réussite de la conquête islamique et de la solidité des institutions qui l’ont suivie sont évidemment multiples et font l’objet du chapitre 7. Et ces raisons ne seraient pas d’abord à trouver dans les logiques des sociétés arabes. Hodgson développe l’idée que l’islam est venu renforcer les bases d’une influence, alors déjà grandissante entre 5e et 7e siècles, de la classe mercantile sur les sociétés irano-sémitiques (surtout donc en Perse, en Syrie et en Asie centrale, le long de la route de la Soie). Ce renforcement a pris plusieurs visages. Il invoque d’abord le rôle de la charia : en tant qu’elle supposait l’égalité et la mobilité sociale, refusait les statuts inégaux acquis, cette dernière se révélait largement « contractualiste » et donc venait en quelque sorte légitimer le droit mercantile. Dans le même esprit, la charia excluait toute autre légitimité qu’elle-même, ruinant ainsi les prétentions à dominer de l’aristocratie agraire traditionnelle. Enfin l’islam, en tant que religion monothéiste potentiellement universelle, convenait très bien aux marchands dont elle pouvait servir les intérêts : elle permettait aux communautés monothéistes antéislamiques séparées de se retrouver sur un socle commun, donc de communiquer et de partager des références morales qui seraient par ailleurs nécessairement utiles aux marchands. Au total donc l’islam est venu renforcer la classe mercantile, urbaine et cosmopolite, dans des régions de vieille civilisation où l’influence grecque avait d’ailleurs été profonde. La religion musulmane a ainsi permis une synergie entre le monde arabe et ses voisins, notamment autour de la valeur accordée aux activités marchandes, elle-même plus forte dans le monde iranien élargi à l’Asie centrale, mais on le sait très présente aussi chez Mahomet et ses compagnons. Au total « l’islam, dans ses idéaux religieux puis dans son influence sur les modèles sociaux, a précisément renforcé les traits de l’héritage irano-sémitique qui encourageaient le contrat entre égaux et la mobilité sociale. Et ceci n’a pu avoir lieu qu’en raison de l’autonomie de la communauté religieuse en tant que société morale dépassant les clivages territoriaux. » Revers de la médaille, cette prépondérance des valeurs propres à la communauté religieuse et de la charia a pu limiter la légitimité des gouvernements successifs, rendant ces derniers imprévisibles et par ricochet, pénalisant l’investissement productif qui suppose une certaine stabilité en matière de politique publique.
Mais c’est surtout dans son apport à la modernité que l’islam est particulièrement étudié par Hodgson, dans le chapitre 10 de cette deuxième partie. Définissant cette modernité comme une accélération de l’histoire, l’auteur nous montre d’abord qu’elle ne constitue pas un phénomène purement européen mais résulte d’une configuration beaucoup plus large, propre à l’espace afro-eurasiatique dans son entier. La croissance économique européenne de la fin du Moyen Âge serait d’abord un « effet de frontière », un phénomène de développement rapide imputable au retard préalable de cette région. De même l’essor culturel du continent serait, pour partie le résultat d’une communication accrue avec le monde islamique, pour partie le résultat d’emprunts beaucoup plus lointains (chinois notamment). L’expansion océanique ibérique du 16e siècle elle-même ne serait pas plus étonnante que la stupéfiante conquête musulmane des 7e et 8e siècles. Replacé dans un contexte global, l’avènement de la « grande transformation moderne » ne relèverait plus de qualités propres au seul Occident. Dans son développement ultérieur, cette modernité s’analyse alors dans ses deux dimensions, évolutionniste d’une part, interactive d’autre part. Côté évolutionniste, c’est l’émergence du primat du calcul et de l’institutionnalisation de la technique qui apparaît comme créant de l’irréversibilité et de l’universel, avec l’idée que ces calculs techniques conduiront à un changement continu, en tout cas à des améliorations techniques, comme nous l’avons vu en première partie. Côté « interactions » Hodgson insiste sur le « haut degré de pouvoir social » désormais possédé par les Européens (et qui s’illustre, encore timidement, dans la conquête portugaise de l’océan Indien) corrélé avec « l’exploitation de possibilités techniques toujours renouvelées qui rend les Européens rapidement dépendants de conditions diverses dispersées aux quatre coins de la planète ». Dans ces conditions, la modernité, c’est aussi et surtout le fait que les Européens ont désormais un « intérêt vital dans toutes les affaires de la planète ». S’imposant partout au nom des possibilités offertes par la technique, la modernité obligera désormais les autres sociétés à adopter cette transformation, voire à la réaliser de façon accélérée si le gouffre avec l’Europe doit être comblé. En ce double sens, évolutionniste et interactif, la modernité n’est pas simplement une étape du changement social, mais d’abord un « événement » touchant simultanément toutes les régions du monde. Si elle constitue bien « une rupture avec les modèles du processus historique afro-eurasiatique dont l’Europe médiévale n’était qu’une partie, l’ancienne tradition occidentale ne saurait détenir la totalité, ni même la majorité, des réponses aux problèmes posés ».
La troisième partie de l’ouvrage traite de la « World History » en tant que discipline.
En moins de 60 pages, Hodgson y pose des questions de méthode tout à fait cruciales et n’hésite pas à affirmer d’emblée que « la world history, interprétée comme l’histoire des relations interrégionales, doit constituer le cœur de l’organisation intellectuelle de la profession historienne ». Ce qui pourrait passer pour une provocation est alors très progressivement étayé. Connaissance du singulier en tant que tel (et non en tant qu’exemple d’une généralité plus large), l’histoire doit cependant soulever des problèmes dont la pertinence soit universelle. C’est donc par le type de questions qu’il pose que l’historien sera fidèle à son projet. Ainsi, contrairement à ce que la profession admet souvent, ce n’est pas sa méthode de travail (notamment la recherche et l’interprétation d’archives) qui fait son identité. À la différence du sociologue, l’historien ne s’intéressera pas aux généralités en tant que telles, mais dans la mesure où elles peuvent éclairer tel événement. En conséquence, opposer histoire et sciences sociales serait inopportun car bloquant la compréhension.
L’historien se définit aussi et surtout par les relations entre les différentes questions qu’il aborde. Plus précisément, s’il est vrai que l’histoire humaine est reliée, interconnectée, depuis fort longtemps, au point que l’action humaine prend une grande partie de son sens à travers ses conséquences lointaines (dans le temps comme dans l’espace), alors l’historien « est incapable de répondre de façon adéquate à une question précise sans donner une réponse à toutes les autres ». Au-delà du paradoxe, l’intuition est bien que la compréhension d’un fait localisé requiert une envergure d’analyse peu usuelle, implique de mobiliser la connaissance de « complexes historiques » à dimension interrégionale, voire planétaire. La conceptualisation à grande échelle devient alors cruciale pour toute étude historique.
Sur ces bases, Hodgson pose la difficile question de l’objectivité propre à la définition et à l’utilisation de ces complexes historiques. La recherche rencontre ici deux limites, celle inhérente au fait de ne considérer qu’une petite partie des faits déterminants d’une part, celle d’évacuer toute signification inhérente à l’histoire de communautés particulières d’autre part. Mais ces imperfections étant connues, la démarche de l’historien ainsi conçue n’en reste pas moins indispensable pour discipliner et rectifier les perspectives historiques des « personnes ordinaires ». Et cet objectif suppose de rompre avec la pratique trop souvent répandue chez les historiens de « laisser les perspectives plus larges aux philosophes de l’histoire », au prétexte qu’aucune objectivité n’y serait plus possible. Or, sur ces questions plus larges, la méthode pour affirmer un jugement, une hypothèse, l’importance d’une relation, reste la même, procède par l’accumulation de faits, de coïncidences jusqu’à ce qu’une seule conclusion demeure possible pour quelque observateur que ce soit. Et s’il est vrai que l’historien sélectionne ses « faits pertinents », cela fait partie de son questionnement, structure ce dernier. Ce qui est le cas du reste dans toute discipline : on n’obtient jamais que les réponses permises par les questions posées. Ce qui suppose aussi de considérer chaque recherche comme une approche particulière, ne délivrant pas un savoir définitif, analyse destinée à être complétée par des approches adoptant d’autres points de vue, d’autres questionnements.
L’auteur conclut alors son chapitre 11 en montrant que l’étude des processus historiques à grande échelle doit porter sur trois niveaux de changements. Ce sont en premier lieu les événements « extra-historiques », souvent négligés, qui importent : changements climatiques, mutations biologiques ou épidémiologiques. À un second niveau, « semi-historique », on trouvera les « résultats imprévus de l’action humaine », portant sur les ressources, les maladies, la démographie, qu’ils aient pour origine la consommation de drogues, les usages alimentaires, les modalités éducatives. Enfin, au troisième niveau, « plus strictement historique », on abordera les effets conscients de l’action humaine (pas toujours prévus du reste) propres aux comportements politiques, économiques et sociaux. Le plus important reste que « ces types de développements sont en partie aveugles, beaucoup d’entre eux étant largement inconscients » ce qui amène Hodgson à insister sur l’importance de ce « tout inconscient » dans toute analyse d’histoire globale.
Au final, ce livre de Marshall Hodgson excède largement la place dévolue, sur un blog, à une recension d’ouvrage. Critique subtile de l’eurocentrisme, analyse fine des liens entre Islam et modernité, fondation méthodologique de l’histoire à grande échelle, il apporte un éclairage stimulant que certains de nos historiens contemporains, parfois bloqués dans le fétichisme de l’archive et des singularités, pourraient méditer avec profit.
Références bibliographiques
M. Hodgson, [1999], L’Islam dans l’histoire mondiale, Paris, Actes Sud, constitue pour l’essentiel une traduction de la deuxième partie de l’ouvrage.