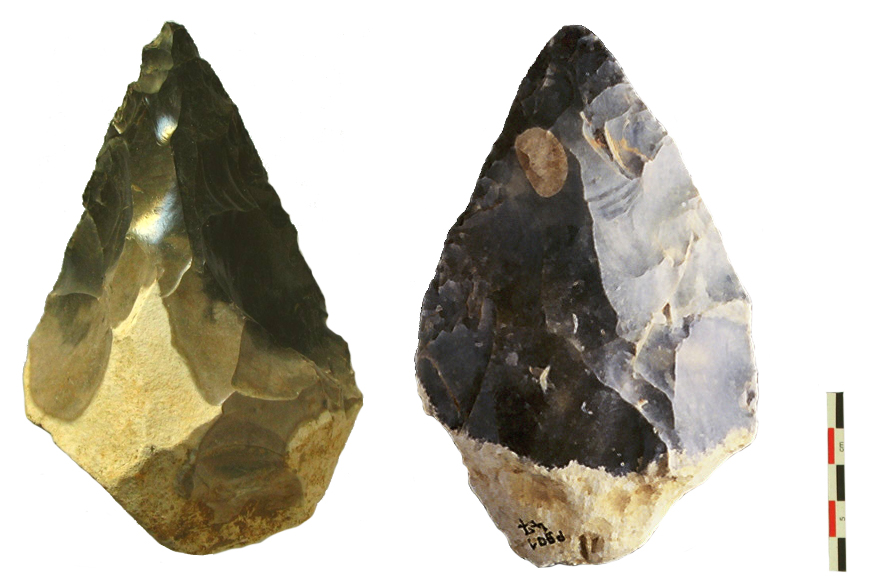Après avoir dressé la semaine dernière un tour d’horizon du concept d’Anthropocène, soulignons que l’Anthropocène est, enfin et surtout, un concept politique.
Le concept politique d’Anthropocène
L’historien Andreas Malm rappelle ainsi que si l’invention de Watt, ce moteur à vapeur disruptif, connut tant de succès, bien qu’elle fournisse initialement une énergie plus chère que l’énergie hydraulique, plus difficile à mettre en œuvre… C’est qu’elle autorisait à implanter les usines là où il y avait des poorhouses, c’est-à-dire une main-d’œuvre corvéable, avec un apport continu d’énergie aux machines. L’énergie hydraulique fluctuait, les usines l’exploitant se situaient loin des centres de population, il fallait augmenter les salaires pour y attirer les travailleurs, et ceux-ci pouvaient plus facilement bloquer la production. Bref, les détenteurs du capital plébiscitèrent non la meilleure solution énergétique, mais celle qui leur garantissait un contrôle optimisé des travailleurs. Plus tard, la situation s’inversa. Les libertés syndicales et notre démocratie contemporaine, comme l’a montré l’historien Timothy Mitchell, se forgèrent pour partie dans les luttes autour des mines de charbon, parce que les ouvriers pouvaient bloquer la production de ce charbon devenu vital. La leçon fut acquise par les pays producteurs de pétrole, qui à l’exception des États-Unis planifièrent l’extraction de l’or noir en atomisant toute revendication démocratique.
Quarante ans de perdu
Il en résulta, comme l’a éloquemment analysé John R. McNeill dans Du nouveau sous le Soleil, un 20e siècle qui affecta en profondeur toutes les sphères, lithosphère, pédosphère, hydrosphère, atmosphère, biosphère. Comment lutter ? Le concept d’Anthropocène peut donner conscience des processus, permettre de les envisager à de nouvelles échelles. À cet égard, le storytelling est primordial, et force est de constater l’échec total des mouvements écologistes en la matière. Comme l’a récemment et lucidement diagnostiqué Yves Cochet, nous avons perdu quarante ans – pour le reste du discours, je le commenterai dans un prochain article, mais je vais m’attarder sur la cause de ce retard.
En 1962, la biologiste Rachel Carson publiait Printemps silencieux, un réquisitoire inspiré contre les ravages des insecticides, incriminant notamment le produit vedette d’alors, le DDT. Premier (et seul) succès de l’écologie politique alors naissante : faire interdire, en Occident et progressivement un peu partout dans le Monde, le DDT. Mais les industriels avaient compris la leçon. Dès lors, comme le décrivent Naomi Oreskes et Eric Conway dans Les Marchands de doute, les budgets de développement des grandes firmes s’accompagnèrent de conséquentes dépenses de communication, avec une stratégie de lobbying d’autant plus efficace qu’elle disposait de budgets proportionnels aux colossaux intérêts financiers en jeu. Moyennant quoi l’industrie du tabac vendit son poison avec des images de cow-boys épanouis dans les grands espaces sauvages. L’industrie automobile nous convainquit que nos moteurs Diesel étaient propres. L’industrie agro-alimentaire traita les animaux à viande comme un « minerai » d’abattage à produire au plus bas coût possible. L’industrie du plastique put diffuser son produit sur toutes les plages du monde pour que nous puissions entre autres emballer « proprement » nos tranches de minerai et notre eau. Et l’industrie de la chimie nous gratifia de millions de molécules nouvelles, aux effets potentiellement irréversibles en matière génétique et sanitaire. Ajoutons à cela une bonne dose de gaz à effet de serre et de polluant atmosphérique pour générer ces flux, et le tableau sera esquissé dans ses grandes lignes. Celui de la construction progressive d’un désastre planétaire, qui menace de s’abattre sur nous avant la fin du 21e siècle.
L’échec programmé de la COP 21
Mettons de côté l’extinction mondiale de la biodiversité, qui nous vaut d’avoir perdu, en biomasse, environ la moitié des animaux sauvages depuis quarante ans, mais qui permet désormais à nos pare-brise de rester propres quand nous entreprenons un long trajet en voiture dans les campagnes françaises – faute d’insectes pour s’écraser dessus. Le consensus des sciences dures, aujourd’hui, nous garantit que nous avons envoyé d’ores et déjà assez de gaz à effet de serre dans l’atmosphère pour réchauffer la Terre de 3° C par rapport aux températures de référence, saisies vers 1880. On est d’ores et déjà bien au-delà des limites fixées par la COP 21, et les objectifs affichés ne pourraient être atteints que si on arrêtait immédiatement d’émettre tout gaz à effet de serre et si on trouvait moyen de nettoyer rapidement l’atmosphère d’une partie de ce que nous y avons déjà envoyé.
Cherchera-t-on notre salut dans la géoingénieurie ? Très probablement, et encore faudra-t-il lui allouer des budgets d’étude conséquents pour qu’elle puisse se révéler autre chose qu’une solution virtuelle. Clive Hamilton, dans Les Apprentis Sorciers du climat, rappelle en effet qu’à ce jour, l’histoire de cette discipline n’est qu’une longue suite d’échecs et de projets mégalomanes. Et les sciences humaines nous amènent pour leur part à penser que le problème va aller en s’aggravant. Du point de vue des relations internationales : comme l’idéologie néolibérale domine, les accords commerciaux ont une valeur juridique infiniment plus contraignante que les accords environnementaux. Les États-Unis peuvent se retirer sans risque de l’accord de Paris. Mais cela leur coûterait bien trop cher de se dédire des traités de libre-échange, bardés de clauses rendant l’application de ces documents irréversibles. Du point de vue de la psychologie : si l’énergie est disponible, le supermarché ouvert, et que tout le monde agit comme son voisin, nous continuerons à toujours émettre plus de gaz à effet de serre. Résultat : Certains de nous volent régulièrement dans les nuages, quand d’autres n’ont pas de toilettes. Ce monde est très confortable pour la moitié de ses habitants, mais par contraste, il offre le visage de l’enfer pour le reste. Et les évolutions contemporaines du Monde poussent à penser que les proportions de gagnants et de perdants vont évoluer dans le mauvais sens.
Une histoire pour comprendre, une narration pour penser, un récit pour agir
Que faire ? D’abord répéter ce qui vient d’être dit, l’illustrer, le compléter, le diffuser. En faire prendre conscience : le réchauffement va être infiniment destructeur. Pour notre confort. Pour notre morale. Pour nos civilisations. Il faudra alerter. Par tout média possible. Il faudra agir dans le cadre des institutions existantes, celui des États au niveau global, celui des initiatives citoyennes au niveau local, et celui des ONG au niveau intermédiaire. Il n’y en a pas d’autres, et il est trop tard pour construire d’autres espaces. Si la démocratie échoue à remédier aux problèmes colossaux qui se complexifient chaque jour sous nos yeux, nous entrerons prochainement dans une ère de dictature qui sera présentée comme la seule solution aux problèmes vitaux que notre inconscience aura créé au 20e siècle. La dictature douce commence d’ailleurs, par petites doses d’anesthésie quotidienne : vous accepterez bien qu’on retranche un peu à vos libertés pour rajouter à votre sécurité, qu’on restreigne vos droits si c’est pour déjouer des attentats ?
Il nous faut désormais penser les processus qui nous ont amenés à un Monde où les inégalités explosent, où l’atmosphère est saturée à plus de 410 ppm de CO2, où on trouve du plastique dans n’importe quel prélèvement d’eau douce ou salée, où les perturbateurs endocriniens affectent le développement cognitif et sexuel de nos embryons… Ce monde est riche de conflits dont les derniers siècles n’ont peut-être été que les brouillons. Il faut étudier comment l’Empire ottoman s’est effrité pour mieux comprendre ce qui se joue en Syrie aujourd’hui, ce qui se jouera en Afrique demain.
Retenons l’essentiel : l’Anthropocène est un concept qui permet d’appréhender la totalité des processus affectant aujourd’hui notre planète. Et il y a urgence de penser ces processus globalement, de poser de grands récits qui permettrons de mobiliser l’humanité pour sa survie. Qu’on juge de la variété des termes qu’une recherche Internet permet d’exhumer en synonymes d’Anthropocène, chacun de ces termes débouchant sur un récit, reflétant une facette pertinente de notre présent Anthropocène : Occidentalocène, Capitalocène, Machinocène, Chimicocène, Mégalocène, Industrialocène, Énergitocène, Mégalocène, Molysmocène – que l’on pourrait traduire par l’éloquent Poubellien…
Bibliographie
PYNE Stephen J., World Fire. The Culture of Fire on Earth, New York, Henry Holt and Company, 1995.
GLIKSON Andrew Y., GROVES Colin, Climate, Fire and Human Evolution. The Deep Time Dimensions of the Anthropocene, Switzerland, Springer, 2015.
RUDDIMAN William F., Plows, Plagues, and Petroleum. How Humans Took Control of Climate, Princeton University Press, 2010, rééd. 2016 – l’ouvrage a été traduit en français : La Charrue, la Peste et le Climat, traduit de l’anglais par Anne Pietrasik, Courbevoie, Randall, 2009.
CROSBY Alfred W. Jr, The Colombian Exchange. Biological and Cultural Consequences of 1492, Wesport, Greenwood Publishers, 1973, rééd. « 30th Anniversary edition », Londres, Praeger, 2003.
WHITE Sam, The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire, Cambridge, Cambridge University Press, 2011.
PARKER Geoffrey, Global Crisis. War, Climate Change and Catastrophe in the Seventeenth Century, New Haven/Londres, Yale University Press, 2013.
GRAS Alain, Le Choix du feu. Aux origines de la crise climatique, Paris, Fayard, 2007.
D’ARCY WODD Gillen, 1816, l’année sans été, traduit de l’anglais par Philippe Pignarre, Paris, La Découverte, 2016.
KLINGAMAN William K., KLINGAMAN Nicholas P., The Year Without Summer. 1816 and the Volcano That Darkened the World and Changed History, New York, St Martin’s Press, 2013.
MALM Andreas, L’Anthropocène contre l’histoire. Le réchauffement climatique à l’ère du capital, La Fabrique, 2017.
MITCHELL Timothy, Carbon Democracy. Le pouvoir politique à l’âge du pétrole, traduit de l’anglais par Christophe Jaquet, Paris, La Découverte, 2013.
McNEILL John R., 2000, Du nouveau sous le Soleil. Une histoire de l’environnement mondial au XXe siècle, traduit de l’anglais par Philippe Beaugrand, Seyssel, Champ Vallon, 2010.
CARSON Rachel, 1962, Printemps silencieux, traduit de l’anglais par Jean-François Gravand et Baptiste Lanaspeze, rééd. Wildproject, 2014.
ORESKES Naomi, CONWAY Erik M., Les Marchands de doute. Ou comment une poignée de scientifiques ont masqué la vérité sur des enjeux de société tels que le tabagisme et le r.chauffement climatique, traduit de l’anglais par Jacques Treiner, Paris, Le Pommier, 2012, rééd. 2014.
HAMILTON Clive, Les Apprentis Sorciers du climat. Raisons et déraisons de la géo-ingénierie, traduit de l’anglais par Cyril Le Roy, Paris, Seuil, 2013.
MONSAINGEON Baptiste, Homo detritus. Critique de la société du déchet, Paris, Seuil, 2017.
SERVIGNE Pablo, STEVENS Raphaël, Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes, Paris, Seuil, 2015.
NB : Ceci est le texte révisé de la conférence « Vivre en Anthropocène » que j’ai délivrée le samedi 13 mai 2017 à Auxerre, dans le cadre des Rencontres Auxerroises du Développement Durable (RADD). Merci à Denis Roycourt, à l’équipe des RADD et au public, pour leur formidable accueil. Merci aussi à Gilles Verdiani, du média d’avenir Subjectif, qui m’a récemment invité à un débat pour s’interroger sur « les théories de l’effondrement », avec Anastasia Colossimo et Vincent Message.