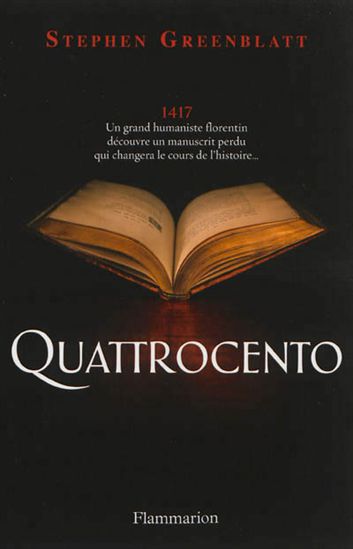À propos de
Quattrocento
1417. Un grand humaniste florentin découvre un manuscrit perdu qui changera le cours de l’histoire
Stephen Greenblatt
Trad. fr. Cécile Arnaud, Flammarion, 2013.
Titre original : The Swerve, 2011.
Ce livre tient de l’hybride entre Le Nom de la Rose d’Umberto Eco et un classique ouvrage d’histoire de la Renaissance européenne – c’est dire s’il est adapté à des vacances imminentes. Nous sommes en 1417. Un homme mystérieux, le Pogge – diminutif pour Poggio Bracciolini –, chemine vers une abbaye en décrépitude. Ex-secrétaire apostolique d’un pape tout juste déposé, calligraphe expert, humaniste et cynique, tenace chasseur de livres oubliés, en cela héritier intellectuel de Pétrarque, il est en quête d’ouvrages ayant conservé des bribes du savoir de la Rome antique. Là, plongeant dans l’enfer de la silencieuse bibliothèque monastique, il va exhumer de la poussière des siècles, outre un traité du grand architecte Vitruve, le De rerum natura de Lucrèce. Ce faisant, il aurait imprimé au destin de l’humanité un virage décisif. Car il est question, dans ce long poème commis par un lointain partisan d’Épicure, d’atomes, d’un univers dénué de lien avec le divin, d’une philosophie du bonheur radicalement opposée au dolorisme catholique qui règne alors en maître sur l’Europe.
Ce court synopsis fait écho au Nom de la Rose, dominé par la figure d’un Guillaume de Baskerville confronté à la puissance subversive et empoisonnée du second tome de La Poétique d’Aristote – que la comédie rejaillisse, et l’Église tremblera. Ajoutons, pour renforcer l’aspect romanesque, que Stephen Greenblatt meuble les trous de son enquête par de nombreux passages semi-fictionnels. Ceux-ci lui permettent de présenter ses hypothèses, tout en évitant de recourir au conditionnel plus que le minimum. « Imaginons… » que la découverte ait eu lieu, ce qui est possible, dans l’abbaye de Fulda. Et hop, dix pages sur l’histoire de ladite abbaye, censée être le cadre de la découverte. Malheur au lecteur inattentif qui aura négligé la nuance introduite par cet « imaginons… ». Plus loin, on apprend qu’Euclide a posé ses théorèmes dans la bibliothèque d’Alexandrie – encore faudrait-il être positivement certain que ce mathématicien ait existé, avant de mentionner au conditionnel, « imaginons… » qu’il ait affûté sa géométrie dans ce cadre prestigieux.
Quelque chose s’est passé…
Cette critique étant posée, allons au-delà. Ce que postule ce livre, c’est une exceptionnalité européenne, nourrie dans la Rome antique, étouffée par le christianisme médiéval, revitalisée à la Renaissance. Un miracle européen appuyé, non sur l’économie, la démographie ou l’innovation technologique, mais sur les idées. L’argument sera séduisant pour certains, irritant pour d’autres, au premier rang desquels figurent les artisans d’une histoire qui se veut globale et s’emploie souvent à réfuter les multiples thèses défendant une exceptionnalité européenne. Ceci dit, je vais me faire ici l’avocat du Diable : l’auteur sait nuancer. A contrario des artifices étalés sur la couverture du livre – The Swerve, « Le Virage », titre original de l’ouvrage ; un manuscrit perdu qui changera le cours de l’histoire pour le sous-titre en français –, Greenblatt reconnaît être parfaitement conscient de ce qu’un livre ne change pas à lui seul le monde. Au mieux, et il défend que ce fut le cas de celui-ci, il contribue à induire une mutation. « Quelque chose s’est passé au cours de la Renaissance qui a libéré les entraves séculaires à la curiosité, au désir, à l’individualisme, et qui a permis de s’intéresser au monde matériel et aux exigences du corps. »
Rétrospectivement, l’apport des humanistes, clamant que l’homme est la mesure de toute chose et élaborant leurs réflexions perchés sur les épaules des géants qu’étaient les penseurs antiques, fut en effet décisif pour l’Europe occidentale. Art, architecture, idées…, jaillissaient de cette manne, pour partie exhumée des bibliothèques monastiques, pour partie glanée dans les ouvrages arabes – ce dont l’auteur ne souffle mot. Mais Quattrocento brasse large. Il faut le prendre pour ce qu’il est : une promenade amoureuse dans l’histoire de cette connexion entre une Antiquité dont ne subsiste plus que des bribes, et un moment d’exaltation, ensanglanté par les guerres de Religion, qui rima avec le début des Temps modernes. Le lecteur novice y apprendra beaucoup, sur la culture gréco-romaine, la destruction des œuvres antiques, le labeur des innombrables moines copistes de temps dits « obscurs » ou le quotidien de Florence ou du Vatican à la Renaissance.
L’annihilation des livres antiques
Greenblatt nous plonge ainsi dans l’univers des riches Romains, férus de philosophie, collectionneurs de parchemins, organisant des soirées où se confrontaient dans une bienveillance réciproque les visions du monde défendues par les stoïciens, aristotéliciens, épicuriens ou platoniciens… Il évoque les bibliothèques publiques romaines, dont celle d’Alexandrie, morte selon lui d’une longue agonie et non d’un incendie, alors que les païens éclairés cédaient la place aux talibans de l’époque, qui sous la houlette de saint Cyrille lapidèrent la « sorcière » Hypatie, philosophe païenne de renom. Il nous rappelle que ne subsistent aujourd’hui que d’infimes fragments des livres antiques : sept pièces de Sophocle, qui en écrivit plus de cent vingt ; quelques lignes du travail encyclopédique du savant Didyme d’Alexandrie, crédité de la rédaction de 3 500 textes ; rien du tout, si ce n’est quelques fragments épistolaires, de l’œuvre d’Épicure pourtant féconde de plusieurs centaines d’ouvrages. Il nous emmène visiter ces bibliothèques abbatiales où régnait la discipline du silence absolu, où les moines copistes recouraient à une langue des signes pour commander les ouvrages dont ils avaient besoin, recopiant inlassablement des textes dont ils avaient, pour certains, irrémédiablement perdu les clés. Il nous fait rencontrer nombre de personnages, dont l’hérétique Jean Hus, ou Niccolò Niccoli, proche ami du Pogge, riche excentrique qui dissipa la fortune familiale dans l’achat de morceaux de statues antiques que les laboureurs exhumaient accidentellement de la glèbe, une nouveauté quasi absolue dans la Florence des années 1400, et dans l’instauration nostalgique d’une bibliothèque publique – chose oubliée depuis la chute de Rome…
Le Florentin le Pogge, soupçonne Greenblatt, aurait peut-être réfléchit à deux fois s’il avait appréhendé à quel point sa découverte allait bouleverser l’univers qu’il connaissait. Avec le long poème de Lucrèce ressuscitait l’authentique pensée épicurienne, qui faisait du plaisir un devoir moral et non un impératif sybarite subordonnant l’esprit à la dépravation, comme l’avaient affirmé ses détracteurs chrétiens menés par un saint Jérôme un temps acquis aux idées de Cicéron avant de s’en faire le Torquemada. Resurgissait l’idée grecque d’un monde constitué d’atomes, indifférent à l’égard des dieux, accessible à l’entendement humain – en bref, une pensée susceptible de libérer l’esprit des terreurs surnaturelles et donc de l’emprise d’institutions régnant par l’imposition de croyances superstitieuses. L’âme redevenait mortelle, et l’Église, comme l’avait pressenti le vindicatif théologien Tertullien qui considérait l’épicurisme comme la pire des menaces planant sur le christianisme, vacillait sur ses bases.
De la Nature, une révolution dans la pensée
Une partie du livre est consacrée à la carrière du Pogge dans la curie romaine – foyer d’hypocrisie que son contemporain Lapo Da Castiglionchio qualifie déjà de lieu où « le crime, l’amoralité, l’imposture et la tromperie se parent du nom de vertu et sont tenus en haute estime », avant de s’interroger : « Qu’y a-t-il de plus étranger à la religion que la curie ? » et d’appeler le pape à trier le bon grain de l’ivraie. Toute ressemblance avec l’actualité ne serait que fortuite, devine-t-on. En tout cas, le Pogge brille dans ce milieu dépravé, usant avec un art consommé de la calomnie mortelle autant, sinon plus, que de sa magistrale maîtrise du latin, consignant son quotidien dans une compilation de notes, les Facetiæ, allant jusqu’à se poser en moralisateur dans un Contre les hypocrites. Parti de rien, le Pogge était un carriériste exceptionnel devenu à 30 ans secrétaire apostolique du roi de l’intrigue qu’était le pape Jean XXIII – non, pas celui du concile Vatican II ; le premier Jean XXIII se fera tant d’ennemis qu’il sera le seul pape de l’histoire à être destitué et rayé des listes pontificales, ce qui « libérera » le nom de Jean XXIII pour un nouvel usager, qui attendra six siècles histoire de faire oublier ce sulfureux prédécesseur. Son maître mis hors jeu en 1416, le Pogge vécut dès lors sa passion dévorante de la bibliophilie comme une vocation salvatrice. Alors que son univers s’effondrait, il s’employa à ramener à la vie « le corps démembré et mutilé de l’Antiquité », dénichant et recopiant à tour de bras des manuscrits oubliés depuis un millénaire, voire plus.
De la Nature a été rédigé au premier siècle avant notre ère. Ce long poème se compose de 7 400 hexamètres non rimés, en six livres dépourvus de titres, alternant « des passages d’une impressionnante beauté lyrique avec des méditations philosophiques sur la religion, le plaisir et la mort, des réflexions complexes sur le monde physique, l’évolution des sociétés humaines, les dangers et les joies du sexe, la nature de la maladie ». Y est développée l’idée que le monde est fait de particules élémentaires invisibles, éternelles et insécables, et si le terme atome n’y est pas employé, on les reconnaît sans peine dans ces « corps premiers » ou « semences des choses ». Le temps y est décrit comme infini, l’espace sans borne, le vide comme la réalité de toute chose, l’univers sans créateur, l’existence gouvernée par le seul hasard, le libre arbitre comme la nature des êtres vivants, eux-mêmes présentés comme le fruit d’une évolution aléatoire – l’humanité est par nature transitoire, elle disparaîtra un jour, et les premiers hommes ne connaissaient ni le feu, ni l’agriculture. À l’instar des animaux, ils utilisaient des cris inarticulés et des gestes avant de réussir à partager des sons structurés en langage et d’inventer la musique. Et l’âme meurt, car elle est composée des mêmes matériaux que le corps – il ne peut y avoir de vie après la mort, plus de plaisir ni de douleur, plus de désir ni de peur. Toutes les religions sont des illusions, qui rendent les hommes esclaves de leurs propres rêves. La vie doit être mise au service de la poursuite du bonheur. Quant à la matière, si elle est éternelle, ses formes ne sont que transitoires : « Les composants qui les constituent se recomposeront tôt ou tard. » Cette pensée, à l’époque du Pogge, n’était qu’un tissu d’abominations et de démence. Elle nous est aujourd’hui familière. Au point d’être vue par le philosophe George Santayana comme la plus haute jamais développée par l’humanité. Une pensée explosive, qui allait pour Greenblatt faire office de détonateur de la modernité. Des dizaines de copies furent rapidement couchées, et l’ouvrage miraculé connut une seconde vie.
Mort alors qu’il approchait des 80 ans, le Pogge fut secrétaire apostolique de huit papes, et chancelier de Florence cinq années. Il eut le temps de voir son monde changer. Pas celui d’adopter la pensée qu’il avait exhumée. Une pensée qui, ceci dit, n’est pas sur certains points sans évoquer la philosophie indienne, notamment dans sa version Vaisheshika, première doctrine à avoir énoncé la théorie atomiste il y a environ deux mille cinq ans, ou dans le Lokāyata, système philosophique élaboré à la même époque. Car celui-ci posait déjà que le monde est juste un assemblage de matière, privé de divinité, et que la vie doit être consacrée à la recherche du plaisir.