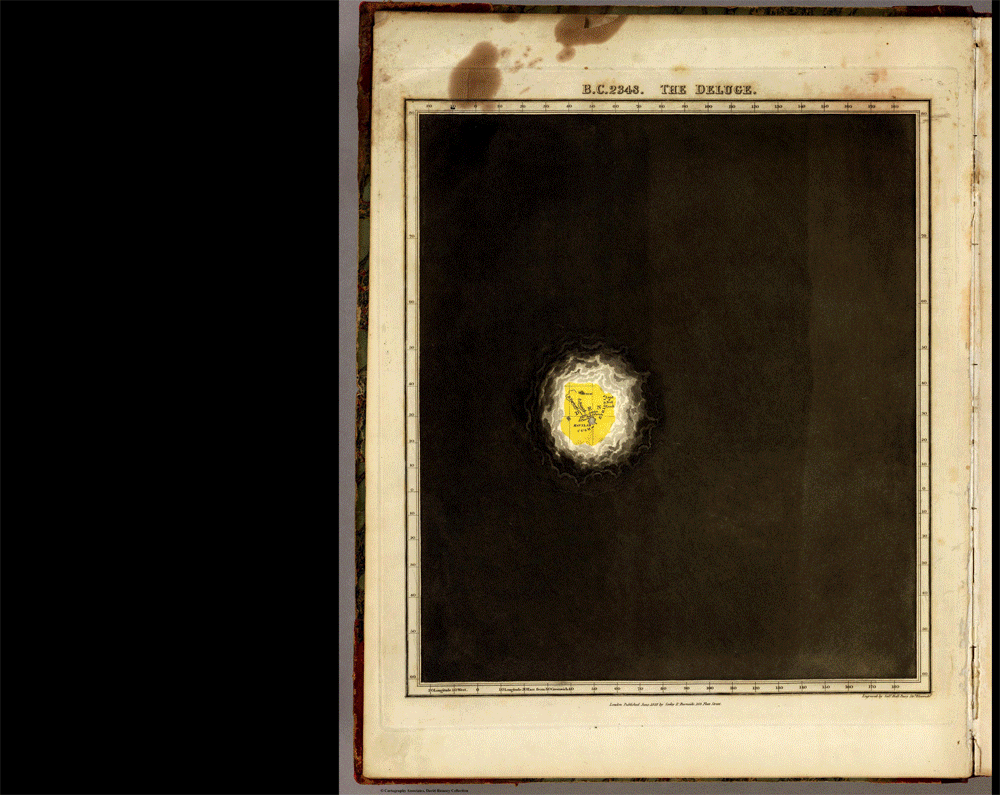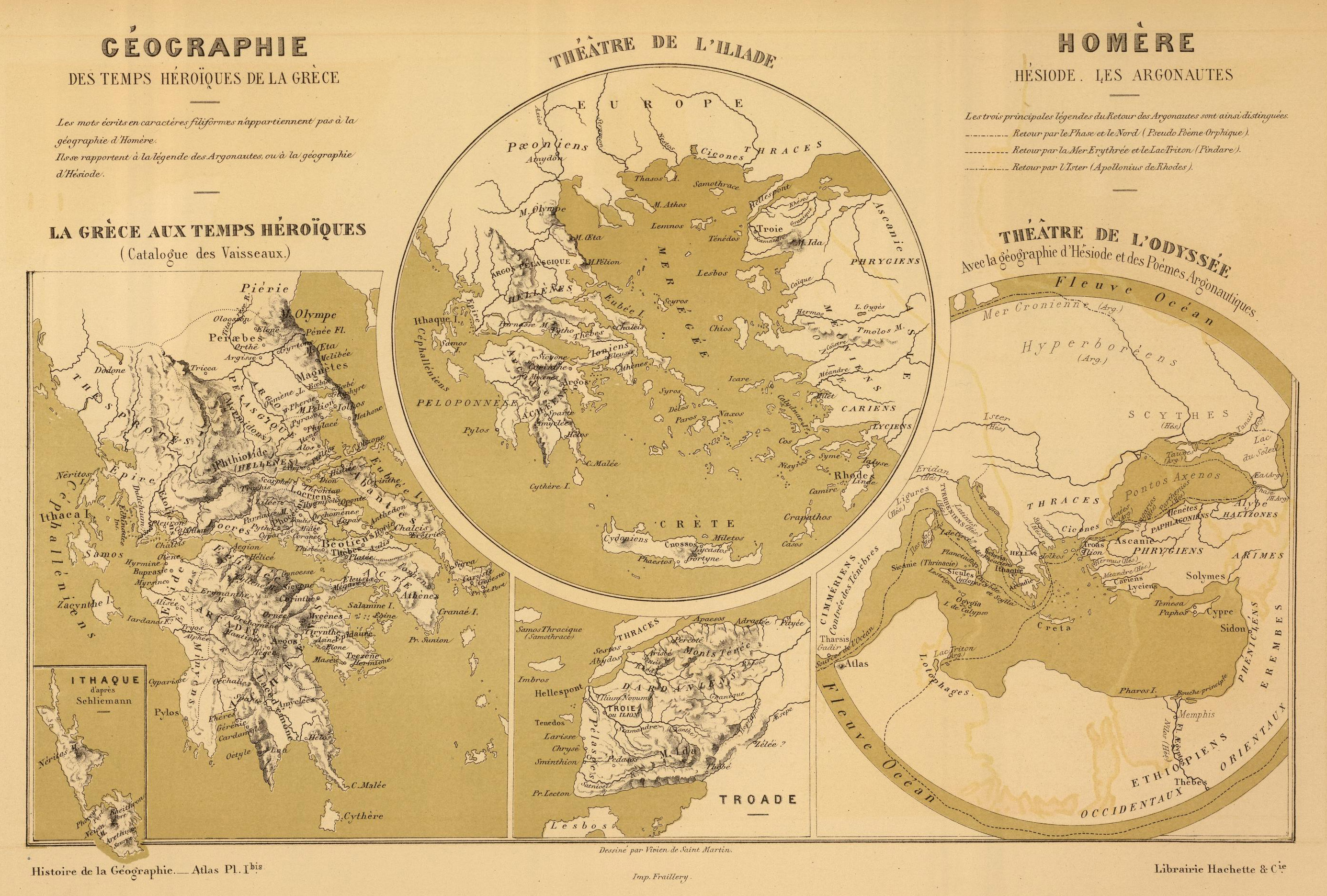Cet agenda couvre la période de septembre à décembre 2012. Ce sera le dernier publié sur le blog. À partir de fin septembre 2012, ce service basculera sur le site www.histoireglobale.com. Le pari de produire tous les trimestres un agenda sur le blog « Histoire globale », pendant deux ans, a montré ses limites : les annonces nous parvenaient trop tard, et nombre de manifestations intéressantes n’ont pas été annoncées. Nous espérons qu’une mise en ligne, actualisée plus régulièrement, offrira davantage de réactivité.
Colloques
Les sources de la mondialisation : pour une approche réflexive
Mercredi 19 et jeudi 20 septembre 2012.
Guyancourt (78280). 47 Boulevard Vauban.
Contacts : Lamia Missaoui, lamia.missaoui [at] libertysurf.fr ; Olivier Roueff, o.roueff [at] free.fr
Thématique émergente des sciences humaines et sociales il y a encore une vingtaine d’années, la mondialisation est devenue une interrogation majeure de l’ensemble de leurs disciplines. Question à la fois récente et transversale, son étude a ainsi donné lieu à une pluralité d’approches. Économistes, sociologues, anthropologues ou historiens ont ainsi découpé l’objet mondialisation selon les catégories que leur fournissait l’histoire de leurs disciplines. Cette diffraction se complexifie, par ailleurs, si l’on met en regard différents champs scientifiques nationaux : l’analyse de la mondialisation y est non seulement menée par des disciplines aux traditions différentes, mais aussi en fonction des principes propres qui structurent chaque espace national. Un sociologue allemand, indien ou français verra sa compréhension de la mondialisation orientée par certaines caractéristiques de la sociologie allemande, indienne ou française ; mais aussi de la place de la sociologie dans son pays, du rôle qu’elle a pu avoir dans l’étude des phénomènes globaux par rapport à d’autres disciplines, de l’existence ou non d’espaces interdisciplinaires du type globalization studies, etc. Objet diffracté, la mondialisation appelle cependant une compréhension unifiée et moins segmentée. À question globale analyse globale, pourrait-on dire, la mise en lumière des angles morts qu’implique le double biais disciplinaire et national revêtant ici une importance plus grande. C’est à une telle réflexion sur la pluralité des perspectives sur la mondialisation, mais aussi sur les moyens de les reconfigurer et de les dépasser, qu’invite le colloque. Les différents intervenants sont ainsi invités à présenter concrètement ce qui a constitué les étapes d’une recherche sur l’un des objets de la mondialisation, et à expliciter les choix théoriques et méthodologiques qui ont été opérés par rapport à d’autres possibles. Tout autant que le cœur de leurs recherches, ils en aborderont les à-côtés, préciseront l’histoire de leurs disciplines et les principes qui structurent les champs scientifiques nationaux auxquels ils appartiennent, pour donner à voir ce qui a orienté leur démarche.
Passeurs de culture et transferts culturels
Vendredi 5 et samedi 6 octobre 2012.
Nancy. Université Nancy-2.
Contacts : Elsa Chaarani, Elsa.Chaarani [at] univ-nancy2.fr ; Catherine Delesse, Catherine.Delesse [at] univ-nancy2.fr ; Laurence Denooz, Laurence.Denooz [at] univ-nancy2.fr
http://ticri.inpl-nancy.fr/wicri-lor.fr/index.php/Passeurs_de_culture_et_transferts_culturels_2012_Nancy
Toute langue traduit et véhicule une identité culturelle spécifique, collective ou personnelle, selon l’histoire du locuteur, de l’écrivain ou de l’artiste. Toutefois, au travers des mariages mixtes, des migrations, du déracinement, des exils, des expatriations, des redécouvertes identitaires dans les peuples postcoloniaux, se créent de nouvelles synergies qui, de nouveau, agissent sur la langue et la culture, générant ainsi une (des) nouvelle(s) langue(s) et une (des) nouvelle(s) culture(s) à l’intersection de deux ou plusieurs cultures originelles. Il se crée ainsi un nouvel espace interculturel en perpétuelle évolution et construction.
Le patrimoine archéologique et son droit : questions juridiques, éthiques et culturelles
Mardi 9 et mercredi 10 octobre 2012.
Paris, 75007, Théâtre Claude Lévi-Strauss, musée du quai Branly, 218, rue de l’Université.
Entrée libre et gratuite. Renseignement et inscription auprès du Cecoji : cecoji [at] ivry.cnrs.fr ; tél. 01 49 60 41 91 ; fax 01 49 60 49 36.
Coproduit par le Centre d’études sur la coopération juridique internationale (Cecoji/CNRS), le ministère de la Culture et de la Communication (direction générale des patrimoines/sous-direction de l’archéologie), et le musée du quai Branly.
Les facettes du paysage : nature, culture, économie
23e Festival international de géographie
Du jeudi 11 au dimanche 14 octobre 2011.
Saint-Dié-des-Vosges (88).
Contact : Freddy Clairembault, fclairembault [at] ville-saintdie.fr
www.fig.saint-die-des-vosges.fr
La fabrique et la genèse des paysages seront au cœur des débats. On s’interrogera aussi bien sur le « beau » paysage que sur le paysage « ordinaire ». Les valeurs du paysage, qu’elles soient environnementales (nature/culture ; services éco-systémiques), économiques (tourisme, immobilier), culturelles ou sociales seront évoquées. L’aménagement du territoire et l’impact paysager aussi : comment construire, aménager, gérer les paysages contemporains aussi bien au plan local qu’à l’échelle mondiale ? Le rôle des acteurs et des règlementations sera abordé ainsi que celle de la gouvernance paysagère. La Turquie, pays invité d’honneur, centralisera les réflexions autour de sa position géopolitique, de la question du modèle turc mais également de son dynamisme.
Les paysans
14e Rendez-Vous de l’histoire
Blois (41).
Du jeudi 18 au dimanche 21 octobre 2011.
www.rdv-histoire.com
Plus de 300 débats et 800 intervenants, une cinquantaine de films, un salon du livre d’histoire et un du livre ancien, des rencontres pédagogiques, des expositions, des cafés et dîners historiques… D’un programme pléthorique, retenons quelques-unes des manifestations liées à l’histoire globale :
• Jeudi 18 octobre 2012, de 14 h 30 à 16 h, Maison de la Magie : « La naissance de l’agriculture », avec Jean-Paul Demoule, Jean Guilaine, Éric Huysecom, Danièle Lavallée, Laurent Nespoulous.
• Vendredi 19 octobre 2012, de 15 h à 16 h 30, Hémicycle de la Halle aux grains : « Comment l’idéologie vient aux programmes d’histoire », avec Henri Guaino (sous réserve), Emmanuel Laurentin, Michel Lefebvre, Nicolas Offenstadt, Vincent Peillon (Sous réserve).
• Vendredi 19 octobre 2012, de 19 h 30 à 20 h 30, Hémicycle de la Halle aux grains : « Nourrir le monde, hier, aujourd’hui et demain : pour une agriculture durable », conférence de Sylvie Brunel.
• Samedi 20 octobre 2012, de 9 h 30 à 11 h, Maison de la Magie : « Les racines du monde global », avec Jean-Paul Demoule, Christian Grataloup, Philippe Norel, Laurent Testot, à l’occasion de la parution de Une histoire du monde global, coordonné par P. Norel et L. Testot, Édition Sciences Humaines, 2012.
• Samedi 20 octobre 2012, de 11 h à 12 h 30, Amphi 1, Université : « Les grandes étapes historiques de l’agriculture depuis dix mille ans », avec Mathieu Calame, Marc Dufumier, Olivier de Schutter (sous réserve), Michel Vanderpooten.
• Samedi 20 octobre 2012, de 14 h 15 à 15 h 45, Amphi 2, Université : « Des premiers agriculteurs aux rurbains », avec Hervé Hennezon, Christine Bousquet, Christophe Chandezon, Jocelyne Peigney.
• Dimanche 21 octobre 2012, de 11 h 30 à 12 h 30, Salle des conférences, Château royal : « Naissance de l’histoire du climat », conférence d’Emmanuel Le Roy Ladurie.
• Dimanche 21 octobre 2012, de 11 h 30 à 13 h, Amphi rouge, Campus de la CCI : « Produire plus ? Les mutations de l’agriculture du Moyen Âge à nos jours », avec Laurent Feller, Llorenc Ferrer-Alos, Anne-Lise Head-König, Laurent Herment, Cédric Perrin.
• Dimanche 21 octobre 2012, de 14 h à 15 h 30, Amphi vert, Campus de la CCI : « Les paysans : racines et sève des civilisations ? », avec Laurent Guerreiro, Éric Janvier, Brigitte Lion, Théophile M’Baka.
• Dimanche 21 octobre 2012, de 14 h à 15 h 30, Amphi 2, Université : « Disettes et famines », avec Guido Alfani, Gérard Béaur, Laurent Feller, Cormac o’Grada, Gilles van Kote.
• Dimanche 21 octobre 2012, de 14 h 30 à 16 h, Amphi 1, Université : « Les révoltes paysannes », avec Korine Amacher, Laurent Bourquin, Jean Garrigues, Pierre-François Souyri.
Révoltes et transitions dans le monde arabe : vers un nouvel agenda urbain ?
Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 novembre 2012.
Le Caire (Égypte). Centre d’études et de documentation économiques, juridiques et sociales (CEDEJ).
Contacts : Pierre-Arnaud Barthel, barthelp [at] enpc.fr ; Roman Stadnicki, roman.stadnicki [at] cedej-eg.com
Ce colloque international vise à débattre de la dimension urbaine des grands changements qui touchent actuellement le monde arabe, depuis les origines des épisodes révolutionnaires de 2011 jusqu’aux expériences actuelles de démocratisation, en passant par les phases de transition politique et de crise économique et sociale plus ou moins longues dans lesquelles les États sont encore pris.
L’invention de la « valeur universelle exceptionnelle »
Mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2012.
Dijon (21000). Université de Bourgogne, 36 rue Chabot-Charny.
Contact : Alain Chenevez, alainchenevez [at] gmail.com
http://colloque-patrimoinemondial.u-bourgogne.fr
L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial est aujourd’hui un label très recherché par les Etats pour identifier, conserver et valoriser les biens culturels et/ou naturels. Une demande sociale s’est fortement développée et nous interroge sur l’émergence d’une valeur exceptionnelle universelle. Quelle est son histoire, quelles sont ses évolutions, ses difficultés, ses écueils ? Dans une perspective critique et pluridisciplinaire, ce colloque, organisé par le laboratoire Cimeos, le Centre Georges-Chevrier et la Maison des Sciences de l’Homme de l’Université de Bourgogne à l’occasion du 40e anniversaire de la Convention du patrimoine mondial de l’Unesco, vise à rendre compte de la diversité des approches pour appréhender la notion de patrimoine universel.
Le commerce du luxe – le luxe du commerce
Production, exposition et circulation des objets précieux du Moyen Âge à nos jours
Mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012.
Lyon (69005). Musées Gadagne, 1, place du Petit-Collège.
Contact : Natacha Coquery, natacha.coquery [a] wanadoo.fr
Comment se produisent, s’exposent, se diffusent et se consomment les produits du luxe ? Le but de ce colloque est de revenir sur la question de la spécialisation progressive d’un commerce voué aux objets précieux qui concourent à l’embellissement de la personne ou du cadre de vie. Le luxe a souvent été cantonné aux productions des beaux-arts ; il s’agira ici de montrer la richesse et la diversité de ce qui était (et reste) compris sous cette appellation et d’observer comment se sont progressivement mis en place des marchés spécialisés.
L’âge d’or des cartes marines
Lundi 3 et mardi 4 décembre 2012.
Paris (75002). Amphithéâtre Colbert, INHA, 2, rue Vivienne.
Contacts : Emmanuelle Vagnon, evagnon [at] yahoo.fr ; Catherine Hofmann, catherine.hofmann [at] bnf.fr
Ce colloque organisé par la Bibliothèque nationale de France et le programme de recherche de l’ANR Median, avec la collaboration du Comité français de cartographie et de l’International Society for the History of Maps, vient apporter un éclairage scientifique complémentaire à l’exposition « L’âge d’or des cartes marines », qui aura lieu à la BnF d’octobre 2012 à janvier 2013. Les communications porteront sur la fabrication et l’usage des cartes marines, puis sur les représentations cartographiques de l’océan Indien de l’Antiquité à l’époque moderne.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Les traumatismes de l’Empire : expressions, effets et usages des violences (post)coloniales
Jeudi 6 et vendredi 7 décembre 2012.
Montpellier (34090). Maison des sciences de l’homme, 17, rue de l’Abbé de l’Épée.
Contact : Éric Soriano, eric.soriano [at] univ-montp3.fr
Les recherches sur les dynamiques impériales permettent, depuis quelques années, de renouveler l’appréhension des questions coloniales et postcoloniales. Elles engagent en effet à s’affranchir d’une histoire strictement nationale pour mieux approcher la dynamique des sociétés et des groupes en déplacement, et incitent à approcher les politiques d’États en rendant mieux compte de l’espace de négociation qui les anime dans leurs relations avec les populations placées sous domination coloniale et postcoloniale. L’usage de la notion d’Empire permet ainsi de ne verser ni dans la vision unilatéralement « par le bas » des subaltern studies, ni dans la vision parfois trop textualisée ou trop centrée sur les seules représentations et imaginaires des études postcoloniales. Elle invite à penser le contact des populations de manière symétrique et à le situer dans leur espace social de pratiques. Elle invite également à repenser le lien métropole-colonie et à rompre avec l’idée souvent inconsciente d’un « âge zéro » de l’histoire correspondant à la conquête ou la gestion coloniales, en prenant également en considération les dynamiques sociales antérieures à la colonisation.
Sortie de la religion : racines chrétiennes et modèles chinois
Jeudi 6 décembre 2012.
Paris (75006). Auditorium, Centre Sèvres, 35bis, rue de Sèvres.
Contact : Sylvie Taussig, sylvie.taussig [at] gmail.com
Cette journée d’étude est consacrée aux inventions et productions religieuses de la modernité. Selon Marcel Gauchet, le christianisme est la religion de la sortie de la religion. Cependant pour certains sinologues, l’évolution du fait religieux en Chine indiquerait que le christianisme ne serait pas unique en l’espèce. Il s’agit donc d’évaluer si et comment la Chine remet en cause les théories occidentales en sciences sociales des religions et si les religions chinoises (confucianisme, bouddhisme, taoïsme, religion locale) sont compatibles avec nos modèles théoriques, en interrogeant notamment lien social et religion en Chine et en Occident.
Ailleurs
Religion in a globalized context: The Mediterranean and the World
Cesnur 2012 International Conference
Jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 septembre 2012.
El Jedida, Maroc. Chouaîb Doukkali University .
www.cesnur.org/2012/el_programme.html
Co-organized with Intercultural Studies and Research Laboratory (URAC 57) and Moroccan Culture Research Group (MCRG) at Chouaîb Doukkali University, El Jadida, Morocco, and the International Society for the Study of New Religions, the 2012 CESNUR (Center for Studies of New Religions) Conference will scan the world of globalized religions…
Integrating Research and Teaching: Africa in World History
NERWHA Fall symposium
Samedi 22 septembre 2012.
Boston, MA, États-Unis. African Studies Center, Boston University 232 Bay State Road.
Contact : Dane Morrison, dmorrison [at] salemstate.edu
www.nerwha.org
Organised by the Nerwha (New England Regional World History Association), this event will be headlighted by Trevor Getz, San Francisco State University, co-author of Abina and the Important Men: A Graphic History (2012).
New Directions in Global History
Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 septembre 2012.
Oxford, Royaume-Uni, St. Antony’s College.
Contact : global [at] history.ox.ac.uk
www.history.ox.ac.uk/global
Global History has established itself over the last ten years as a powerful and dynamic sector in historical research with wide appeal to an informed lay readership outside the academy. Now is the time to take stock. This is partly to ask what have been the most fruitful lines of inquiry and the most productive approaches. But it is also to speculate on which new directions global history is likely to follow and what we should see as the most urgent or important new lines of inquiry. For its Founding Conference, Oxfords new Centre for Global History will engage with these questions across the whole chronological range from Ancient to Late Modern History. We have invited some of the foremost practitioners in the field to debate these issues. We expect that among the major themes to emerge will be how global history can connect with – and serve – different kinds of history, how it can benefit both from a dialogue across chronological periods and from cross-disciplinary research, and whether conceptual innovation should be a major priority. Plenary speakers include Nicholas Purcell, Arjun Appadurai, Kenneth Pomeranz, Linda Colley, Chris Bayly, Ian Morris, Bob Moore, Kevin ORourke, John McNeill, Maxine Berg, Jurgen Osterhammel, Francis Robinson, Chris Wickham and James Belich.
Aid, Emerging Economies and Global Policies
Conference on the launch of the 4th issue of International Development Policy
Mercredi 3 octobre 2012, après-midi.
Berne (3012), Suisse. Room 501, University of Berne, Hochschulstrasse 4.
Contact : Marie Thorndahl, marie.thorndahl [at] graduateinstitute.ch
http://graduateinstitute.ch/corporate/resources/events_types/calendarofevents_en.html?evenementId=144403
The emergence of new donors and development aid actors from the global South coupled with an increased focus on global public goods are challenging long-established aid agencies and policies. Emerging economies are turning into significant aid players… A panel of policy makers, scholars and practitioners from a diversity of backgrounds will discuss these complex issues in a lively roundtable moderated by a renowned journalist.
The Environment in World History: Seeing through a local or global lens
Portland, Oregon, États-Unis.
Vendredi 12 et samedi 13 octobre 2012.
http://public.wsu.edu/~nwwha
Histoire du capitalisme
37th annual meeting of the Social Science History Association
Du jeudi 1er au dimanche 4 novembre 2012.
Vancouver, Canada.
Contacts : Stefan Bargheer, sbargheer [at] mpiwg-berlin.mpg.de ; Emily Barman, eabarman [at] bu.edu ; Victoria Johnson, vjohnsn [at] umich.edu
www.ssha.org
Global Commodities: The material culture of early modern connections, 1400-1800
Mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2012.
Université de Warwick, Royaume-Uni.
Contacts : Anne Gerritsen, a.t.gerritsen [at] warwick.ac.uk ; Giorgio Riello, g.riello [at] arwick.ac.uk
Registration fee : £100 (£45 for students) till 15 October 2012.
Organised by Global History and Culture Centre University of Warwick, this conference seeks to explore how our understanding of early modern global connections changes if we consider the role material culture played in shaping such connections. In what ways did material objects participate in the development of the multiple processes often referred to as globalisation? How did objects contribute to the construction of such notions as hybridism and cosmopolitanism? What was their role in trade and migration, gifts and diplomacy, encounters and conflict? What kind of geographies did they create in the early modern world? What was their cultural value vis-à-vis their economic value? In short, we seek to explore the ways in which commodities and connections intersected in the early modern world.
Conférences
L’autre en question
Jeudi 13 septembre 2012.
Paris, 75007, musée du quai Branly, 218, rue de l’Université.
Entrée libre. Réservation obligatoire au 01 58 71 01 01 ou au 01 81 69 18 38, ou par email : rencontres [at] festival-idf.fr (précisez vos nom, prénom et adresse postale afin de pouvoir recevoir les billets correspondant à votre réservation).
• À partir de 18 h 30 : Table ronde avec Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche au CNRS (Ceri/Sciences-Po), Pap Ndiaye, historien, maître de conférences à l’EHESS, et Yvan Gastaut, historien, maître de conférences à l’Université de Nice Sophia Antipolis. Animée par Marie Poinsot, politologue, rédactrice en chef de la revue Hommes et migrations, responsable du département Éditions de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration.
Entre rejet et solidarité, la présence en France de populations venues d’un « ailleurs » plus ou moins lointain n’a cessé de façonner la société dans ses multiples dimensions. De quelle manière les diasporas et les migrants qui les composent ont-ils nourri l’imaginaire français à travers les différentes époques ? L’immigration, loin de concerner seulement la France, s’inscrit plus largement dans une problématique mondiale. Comment les politiques d’immigration (les politiques de contrôles des flux migratoires et les politiques d’accueil des étrangers) ont-elles évolué au cours de ces trente dernières années ?
Organisé dans le cadre du festival d’Île-de-France, en collaboration avec le musée du quai Branly.
Mémoires de diasporas, entre effacement et transmission
Lundi 17 septembre 2012.
Paris (75005). Grand auditorium du Collège des Bernardins, 24 Rue de Poissy.
Entrée libre. Réservation obligatoire au 01 58 71 01 01 ou au 01 81 69 18 38, ou par email : rencontres [at] festival-idf.fr (précisez vos nom, prénom et adresse postale afin de pouvoir recevoir les billets correspondant à votre réservation).
• À partir de 20 h : Table ronde avec Alexis Nouss, professeur à la School of European Studies de l’Université de Cardiff (Royaume-Uni), fondateur et directeur du groupe de recherche montréalais POexil, Michel Bruneau, géographe, directeur de recherche émérite au CNRS, Paul Alerini, psychanalyste, et Zad Moultaka, compositeur. Animée par Virginie Symaniec, chercheur et traductrice, et Alexandra Galitzine-Loumpet, anthropologue.
En quittant leur pays d’origine, les individus en situation de diaspora font face à un exil intérieur autant que physique. De ces expériences vécues directement ou de manière lointaine, épanouies ou subies, découlent des mémoires, traumatiques ou refoulées, ou au sein desquelles il est parfois possible « de nourrir la nostalgie d’un pays que l’on n’a jamais connu, d’éprouver le manque d’une langue que l’on n’a jamais parlée » (A. Nouss). La présence du compositeur d’origine libanaise Zad Moultaka à la table ronde mettra également en lumière le fait que la création artistique est tout autant un vecteur essentiel de transmission de ces mémoires de diasporas qu’un catalyseur de rencontres des cultures.
Organisé dans le cadre du festival d’Île-de-France, en partenariat avec le Collège des Bernardins et en collaboration avec les rencontres Non-lieux de l’exil (Réseau Asie, CNRS/FMSH).
L’histoire mondiale de la colonisation
Cycle de conférences du musée du quai Branly
Paris, 75007, musée du quai Branly, 218, rue de l’Université.
Contact : Nathalie Mercier, nathalie.mercier [at] quaibranly.fr
www.quaibranly.fr
• Jeudi 20 septembre 2012, à partir de 18 h 30 : conférence-débat en présence de Alain Testard, anthropologue, « L’esclavage dans les sociétés archaïques ».
• Jeudi 29 novembre 2012, à partir de 18 h 30 : conférence-débat en présence de Jean Andreau, historien, « L’esclavage dans l’Antiquité gréco-romaine ».
• Jeudi 13 décembre 2012, à partir de 18 h 30 : conférence-débat en présence de Myriam Cottias, historienne, « Mémoire(s) des esclavages ».
Décalages : les autres et nous
Cycle de conférences du musée du quai Branly
Paris, 75007, musée du quai Branly, 218, rue de l’Université.
Contact : Nathalie Mercier, nathalie.mercier [at] quaibranly.fr
www.quaibranly.fr
• Jeudi 27 septembre 2012, à partir de 18 h 30 : conférence-débat en présence de Françoise Sabban, sinologue et anthropologue, et Noëlie Vialles, anthropologue, « La viande en Chine et en Europe ».
• Jeudi 11 octobre 2012, à partir de 18 h 30 : conférence-débat en présence de Marie-France Auzépy, historienne, et Anne-Marie Moulin, historienne et philosophe de la médecine, « Le poil en Islam et dans le monde chrétien ».
• Jeudi 22 novembre 2012, à partir de 18 h 30 : conférence-débat en présence de François Vatin, sociologue et économiste, et Carole Ferret, ethnologue, « Le lait en Europe et en Inde ».
Repenser les phénomènes circulatoires
Journée d’études doctorales – Paris-1
Vendredi 28 septembre 2012.
Paris.
Contact : paris1jed2012 [at] gmail.com
Cette journée d’études sera l’occasion de questionner la manière dont on analyse aujourd’hui les phénomènes circulatoires, en proposant une approche pluridisciplinaire et une réflexion à plusieurs échelles afin de repenser ces processus.
Diasporas, une histoire en devenir : vers un monde transnational ?
Mardi 2 octobre 2012.
Paris (75013). Auditorium du Pôle des langues et civilisations, 65 rue des Grands-Moulins.
Entrée libre. Réservation obligatoire au 01 58 71 01 01 ou au 01 81 69 18 38, ou par email : rencontres [at] festival-idf.fr (précisez vos nom, prénom et adresse postale afin de pouvoir recevoir les billets correspondant à votre réservation).
• À partir de 18 h 30 : table ronde avec Stéphane Dufoix, maître de conférences HDR en sociologie (Université Paris-Ouest-Nanterre, laboratoire Sophiapol) et membre de l’Institut universitaire de France, auteur notamment de La Dispersion. Une histoire des usages du mot diaspora, Amsterdam, 2012, Dominique Schnapper, directrice d’études à l’EHESS, et El Mouhoub Mouhoud, professeur d’économie à l’Université Paris IX-Dauphine. Animée par François Durpaire, historien, Université de Cergy-Pontoise.
À partir d’une approche historique des diasporas et d’une tentative de définition de la notion, cette table ronde s’interrogera sur le(s) sens et la pertinence d’un terme, devenu un véritable phénomène, à l’heure de la mondialisation et d’un mode de vie de plus en plus transnational. Elle mettra également en lumière le poids incontestable de ces mouvements de populations dans les échanges économiques et politiques mondiaux.
Organisé dans le cadre du festival d’Île-de-France, en partenariat avec la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (Bulac). Dans le cadre du cycle de conférences Les Mardis de la Bulac.
Grands témoins
Cycle de conférences du musée du quai Branly
Paris, 75007, musée du quai Branly, 218, rue de l’Université.
Contact : Nathalie Mercier, nathalie.mercier [at] quaibranly.fr
www.quaibranly.fr
• Vendredi 14 décembre 2012, à partir de 18 h 30 : conférence-débat en présence de Maurice Godelier, anthropologue, spécialiste des sociétés d’Océanie.
Séminaires
Genre, mobilisations et dynamiques sociales en Asie du Sud
12e séminaire jeunes chercheurs de l’AJEI
Paris, 75006, Ceri, 56 rue Jacob.
Jeudi 8 novembre 2012.
Contact : seminaire [at] ajei.org
Public : étudiants en sciences sociales de niveaux master, doctoral ou post-doctoral, travaillant sur l’Asie du Sud.
Aux origines de la mondialisation : histoire économique comparée Asie Europe, 1500-2000
Paris (75013). salle 681, bât. Le France, 190-198 avenue de France.
Les 1er, 3e et 5e mardis du mois, de 11 h à 13 h, du mardi 6 novembre 2012 au mardi 18 juin 2013.
Renseignements : Isabelle Deron, ideron [at] ehess.fr
www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2012/ue/307
Niveau requis : Étudiants, projet de recherche écrit, connaissance du chinois ou du japonais souhaitée.
Ce programme d’enseignement propose d’explorer une histoire économique comparée (Chine/Europe) en prenant pour objet d’étude les institutions économiques et les pratiques commerciales. Il s’agit d’une investigation, entreprise sur une vaste échelle, portant sur des institutions économiques ayant joué un rôle crucial dans la première mondialisation (16e siècle) et sur la « grande divergence » qui est advenue par la suite entre l’Asie et l’Europe. Parmi ces institutions l’on peut citer les partenariats commerciaux, les diverses formes de mobilisation des capitaux, le développement de sociétés en commandite et les sociétés par action…
Le principal objectif de cette recherche est de comparer systématiquement la trajectoire d’institutions économiques et de pratiques d’affaires dans deux environnement bien différenciés – l’Europe occidentale et l’Asie (essentiellement la Chine et le Japon) –, sur une longue période, courant du 16e au 21e siècle, et en prenant pour fil directeur l’analyse des pratiques de trois grands réseaux marchands chinois : celui du Fujian, celui de Huizhou (Anhui), et celui du Shanxi.
Racialisation et mondialisation
Le lundi, de 17 h à 19 h, d’octobre 2012 à mai 2013.
Paris (75016). NYU Paris, 56, rue de Passy.
Organisé par Beth Epstein et Carole Reynaud-Paligot (Paris-1) en collaboration avec Ann Thomson (Paris-8), ce séminaire a pour objectif l’étude, dans la longue durée et au sein de différents espaces géopolitiques, des processus de racialisation et/ou d’ethnicisation dans différents contextes sociohistoriques. Les catastrophes du 20e siècle ont rendu la notion de race impensable, mais elle continue néanmoins à structurer les pensées et la politique dans un monde où les frontières d’antan deviennent pourtant de plus en plus fluides. Comment expliquer la permanence de ces catégories qui ont si fortement façonné le monde moderne, alors que l’intensification des échanges semble rendre les identités moins rigides ? En créant un réseau de chercheurs de disciplines différentes (histoire, sociologie, ethnologie, anthropologie, science politique, littérature, histoire de l’art), il s’agit de mobiliser des méthodes et des problématiques diverses à travers le temps et l’espace afin d’enrichir la compréhension de ces phénomènes dans une perspective comparatiste.
Ce séminaire est ouvert à tout chercheur qui de près ou de loin s’intéresse à ces sujets.