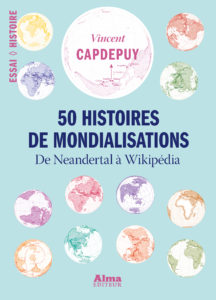Ce texte avait été initialement écrit pour le collectif Aggiornamento hist-géo ; il avait été ensuite proposé au journal Le Monde, qui s’était engagé à le publier. Trois mois plus tard, l’équipe a fini par y renoncer en s’excusant platement. Le voici donc, un peu décalé par rapport à l’actualité, mais toujours valable a priori sur le fond.
En novembre 2018, Emmanuel Macron aurait dû faire un tour à Lunéville-en-Ornois, afin de rendre hommage à Fernand Braudel, qui y naquit en 1902[1]. Il n’y vint pas. Un an auparavant, dans une interview au Point, le chef de l’État avait évoqué l’historien parmi ses références intellectuelles[2]. Il l’a à nouveau convoqué lors de son discours au dîner du Crif le 20 février dernier :
« Au-delà, l’école doit jouer à plein son rôle de rempart républicain contre les préjugés et contre les haines, mais aussi contre ce qui en fait le lit, l’empire de l’immédiateté, le règne d’une forme de relativisme absolu. L’enseignement de la méthode scientifique, de la méthode historique, sera renforcé. Tous les enfants de France seront sensibilisés au temps long des grandes civilisations, ce temps long cher à BRAUDEL, qui apporte le goût de la tolérance et de l’humanisme. Mais revenir à ces fondamentaux, au cœur de notre éducation, ce qui, parfois, avait été oublié. »[3]
Mais le président sait-il de quoi il parle ?
Pour rappel, en juillet 1957 paraissait au Bulletin officiel de l’Éducation nationale un nouveau programme d’histoire pour le second degré. En classe de Terminale, l’enseignement devait désormais porter sur « Les principales civilisations contemporaines (titre provisoire) », éclaté en sept chapitres :
« Le monde contemporain
I/ Introduction
Conception et sens de ce programme
(Cette introduction devra, tout d’abord, définir la notion de civilisation ; puis elle soulignera, pour chacun des ensembles énumérés ci-après, trois éléments essentiels : fondements, facteurs essentiels de l’évolution, aspects particuliers de sa civilisation.)
II/ Le monde occidental
a) Fondements et évolution de sa civilisation
(la tradition gréco-romaine ; la tradition chrétienne et médiévale ; la tradition révolutionnaire et libérale ; la révolution industrielle) ;
b) Aspects particuliers actuels de sa civilisation
(Europe occidentale ; Amérique anglo-saxonne ; Amérique latine)
III/ Le monde soviétique
a) Fondements et évolution de sa civilisation
(la tradition chrétienne et byzantine ; les influences asiatiques ; les influences occidentales jusqu’au XXe siècle ; l’influence marxiste) ;
b) Aspects particuliers actuels de sa civilisation
(U.R.S.S. ; « démocraties populaires »).
IV/ Le monde musulman
a) Fondements et évolution de sa civilisation
(l’Islam ; les influences iraniennes, égyptienne, turque, espagnole) ;
b) Aspects particuliers actuels de sa civilisation
(les pays du Moyen-Orient ; le Pakistan ; l’Insulinde ; les pays d’Afrique du Nord).
V/ Le monde extrême-oriental
a) Fondements et évolution de sa civilisation
b) Aspects particuliers actuels de sa civilisation
(Chine ; Japon ; Indochine, sauf Cambodge).
VI/ Le monde asiatique du Sud-Est
a) Fondements et évolution de sa civilisation
(le bouddhisme ; le brahmanisme ; les influences européennes…) ;
b) Aspects particuliers actuels de sa civilisation
VII / Le monde africain noir
a) Fondements et évolution de sa civilisation ;
b) Aspects particuliers actuels de sa civilisation »[4]
Ces programmes sont réputés avoir été dictés par Fernand Braudel. Comme Patricia Legris l’a bien étudié dans sa thèse sur l’écriture des programmes, ce n’est pas si évident que cela. La réécriture des programmes de Terminale en 1956-1957 a été assez mouvementée. Le ministre de l’Éducation nationale, René Billères, a joué un rôle important, au détriment de l’Inspection générale et de la Société des professeurs d’histoire et de géographie, traditionnellement associée. Il a fermement défendu « la connaissance du présent », ce qui impliquait un prolongement temporel au-delà de 1945 et un élargissement spatial aux civilisations extra-européennes. S’il est un historien derrière cela, c’est probablement davantage Pierre Renouvin.
Si une confusion a pu s’installer à propos du rôle de Fernand Braudel dans les programmes de 1957, c’est probablement à la suite de la réédition en 1987 de ce qu’on a dès lors appelé la « Grammaire des civilisations », et qui est l’extrait d’un manuel scolaire de Terminale publié en 1963[5] et coécrit avec Suzanne Baille et Robert Philippe[6]. Par la même occasion, cette réédition a fait oublier qu’il n’existait pas qu’un seul manuel. Citons celui paru chez Hatier et rédigé par Lucien Genet, René Rémond, Pierre Chaunu, Alice Marcet et Joseph Ki Zerbo, ou encore celui publié à la Libraire Delagrave par Jean Sentou et Charles-Olivier Carbonell.
En revanche, Fernand Braudel fut bien l’auteur, en 1956, d’un Rapport préliminaire sur les sciences humaines portant sur l’enseignement supérieur et sur la recherche. Dans celui-ci, il plaidait effectivement en faveur de l’importance des études sur le monde actuel :
« Un des rôles essentiels des sciences humaines est la difficile prospection du monde actuel. Sa reconnaissance n’est possible que par la collaboration des différentes disciplines qui, à cet effet, doivent se soumettre à une orchestration entièrement nouvelle. Leur efficience est au prix d’une collaboration aussi large que possible entre les sciences politiques (insuffisamment développées chez nous) ; économiques, linguistiques, géographiques, historiques, sociologiques, ethnographiques. La connaissance de cette vie mondiale, je le répète, est absolument nécessaire à la politique clairvoyante d’un grand pays comme le nôtre. »[7]
Fernand Braudel, alors en pleine négociation pour la création de la Maison des sciences de l’homme en relation avec le Rockefeller Center, était très influencé par les area studies états-uniennes. Plus loin, il dressait une liste de ces « grands espaces politiques et culturels du monde » : Russie, Chine, États-Unis, Indes, Amérique Latine, Islam, Afrique Noire[8]. Mais cela ne correspond pas exactement au découpage du programme de Terminale et surtout la notion de « monde » comme synonyme de « civilisation » n’est pas employée. En réalité, ce n’est qu’en 1963 que Fernand Braudel proposa sa collaboration à l’écriture de nouveaux programmes dans une lettre à Laurent Capdecomme, directeur général de l’enseignement supérieur. Selon lui, c’est tout l’enseignement du second cycle qui devait être consacré au monde contemporain [9]:
– Seconde : Le monde 1914-1963.
– Première : Les grandes civilisations d’aujourd’hui (« considérées dans leur passé et leur présent, afin de monter qu’il s’agit d’un tout »).
– Terminale : Les dimensions du monde actuel (programme unique d’histoire, géographie, économie, démographie, etc.)
Mais la proposition qu’il fit en 1963 resta lettre morte. Ce que proposait Fernand Braudel allait plus loin encore que les programmes de 1957, alors que d’autres forces entraient en œuvre pour aller à rebours. Le programme de Terminale tel qu’il s’appliqua à partir de 1962 n’était pas exactement tel qu’il avait été écrit en 1957. La Société des Professeurs d’Histoire et Géographie était intervenue rapidement auprès de l’Inspection Générale et du ministère. Dès 1959, elle avait obtenu le rétablissement d’une approche chronologique en trois périodes : 1789-1848 en Seconde, 1848-1914 en Première, 1914-1945 en Terminale. À partir de 1965, les horaires d’enseignement de l’histoire-géographie diminuèrent, des allègements furent introduits dans le programme d’histoire de Terminale et les civilisations disparurent, au profit de la seule étude de la période 1914-1945.
Ce débat sur l’ouverture de l’enseignement au reste du Monde, on l’a connu à plusieurs reprises au cours des dix ans passés à chaque réécriture des programmes de collège et de lycée. Au sein du collectif Aggiornamento, nous sommes régulièrement intervenus dans ces débats, défendant une ouverture au Monde[10].
Alors même que les propositions n’ont jamais atteint ce qui avait été décrété en 1957 et a fortiori ce qui avait été proposé par Fernand Braudel en 1963, à chaque fois, des voix se sont élevés pour tirer les programmes en arrière, en un repli franco-centré aussi suranné que dangereux, renforcé aujourd’hui par le déploiement d’une symbolique nationaliste qui devra être omniprésente avec drapeaux, cartes et hymne guerrier.
L’imposture macronienne est finalement celle qui se déploie dans le hiatus qui existe dans les nouveaux programmes d’histoire de lycée. Le préambule pose une discipline géographico-historique à la base de toute émancipation :
« Par l’étude du passé et l’examen du présent, l’histoire et la géographie enseignées au lycée transmettent aux élèves des connaissances précises et diverses sur un large empan historique, s’étendant de l’Antiquité à nos jours. Elles les aident à acquérir des repères temporels et spatiaux ; elles leur permettent de discerner l’évolution des sociétés, des cultures, des politiques, les différentes phases de leur histoire ainsi que les actions et décisions des acteurs ; elles les confrontent à l’altérité par la connaissance d’expériences humaines antérieures et de territoires variés. Partant, elles leur donnent les moyens d’une compréhension éclairée du monde d’hier et d’aujourd’hui, qu’ils appréhendent ainsi de manière plus distanciée et réfléchie.
Le monde dans lequel les lycéens entreront en tant qu’adultes et citoyens est traversé par des dynamiques complémentaires, conflictuelles, voire contradictoires dont beaucoup sont les conséquences de faits antérieurs, de longues ou brèves mutations. L’histoire et la géographie permettent d’éclairer ces mouvements complexes et incitent les élèves à s’instruire de manière rigoureuse et, en développant une réflexion approfondie qui dépasse les évidences, les préparent à opérer des choix raisonnés.
L’histoire et la géographie montrent aux élèves comment les choix des acteurs passés et présents (individuels et collectifs), qu’ils soient en rupture ou en continuité avec des héritages, influent sur l’ensemble de la société : elles éduquent ainsi à la liberté et à la responsabilité. »[11]
Mais tout le reste n’est qu’un carcan thématique et horaire. Les fenêtres du Monde ont été fermées. Le titre du programme de Seconde est pourtant prometteur : « Grandes étapes de la formation du monde moderne ». Tout de suite, l’esprit se met à gambader. On imagine les empires-mondes romains et chinois, les commerçants, aventuriers, ambassadeurs, missionnaires traversant l’épaisseur de l’Eufrasie, les grandes religions, chrétienne, musulmane, bouddhiste se diffusant, de gré ou de force, et se divisant, les grandes chevauchées mongoles, les navigations des Vikings dans l’Atlantique Nord, celles des Austronésiens dans l’océan Pacifique et dans l’océan Indien, l’arrivée des Indiens du Brésil en France et celle des Jésuites en Chine, les routes de l’argent et de l’or, les grandes épidémies, l’histoire amère du sucre, ici et là la mort de la mégafaune, le grand désenclavement planétaire, la diffusion de l’imprimerie et l’histoire de la lecture, ou bien la naissance et l’expansion du capitalisme, pour rester dans une optique braudélienne… Que sais-je encore ? Il y a tant d’histoires à enseigner. Trop sans doute pour les porte-plumes du ministère.
Malgré quelques concessions, les programmes sont un ressassement du roman civilisationnel qui s’est contruit depuis le XIXe siècle. Cette incapacité à tourner la page pour inventer une nouvelle manière d’enseigner l’histoire est absolument tragique et participe de cette cécité morale de notre prétendue élite politique qui nous conduit nulle part, ou pire.
[1] L’Est Républicain, 8 novembre 2018.
[2] Florent Barraco, « Saint-Simon, Levinas, Daoud… dans la bibliothèque d’Emmanuel Macron », Le Point, 1er septembre 2017.
[3] http://discours.vie-publique.fr/notices/197000388.html
[4] Arrêté du 19 juillet 1957 BOEN n°30, 25 juillet 1957, pp. 2467-2471.
[5] Les programme de 6e et 5e entrèrent en application à la rentrée 1958, ceux de 4e et 3e en 1959, celui de Seconde en 1960, celui de Première en 1961 et celui de Terminale en 1962.
[6] Fernand Braudel, 1963, « Jadis, hier et aujourd’hui : les grandes civilisations du monde actuel », in Baille S., Braudel F. & Philippe R., Le monde actuel. Histoire et civilisations, Paris, Belin, pp. 143-475.
[7] Fernand Braudel, 1956, Rapport préliminaire sur les sciences humaines, tapuscrit, p. 5.
[8] Ibid., p. 16.
[9] Patricia Legris, L’écriture des programmes d’histoire en France (1944-2010), thèse de doctorat, Paris I-Panthéon Sorbonne, 2010, p. 153.
[10] Vincent Capdepuy, « Le déni du Monde », 17 juin 2013, https://aggiornamento.hypotheses.org/1453 ; Vincent Capdepuy, Laurence De Cock, « Programmes d’histoire, le CSP a reculé ? What a surprise ! », Mediapart, 18 septembre 2015, https://blogs.mediapart.fr/edition/aggiornamento-histoire-geo/article/180915/programmes-d-histoire-le-csp-recule-what-surprise ; Vincent Capdepuy, « Programmes d’histoire : “Quelle misère intellectuelle !” », Le Monde, 25 octobre 2018, https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/10/25/programmes-d-histoire-quelle-misere-intellectuelle_5374192_3232.html ; cf. également plusieurs contributions dans Laurence De Cok (dir.), 2017, La fabrique scolaire de l’histoire, Marseille, Agone, 2e éd.
[11] Programme de l’enseignement d’histoire-géographie de la classe de seconde générale et technologique, de la classe de première de la voie générale et de la classe de première de la voie technologique, arrêté du 17-1-2019 – J.O. du 20-1-2019, B.O. spécial n° 1 du 22 janvier 2019.