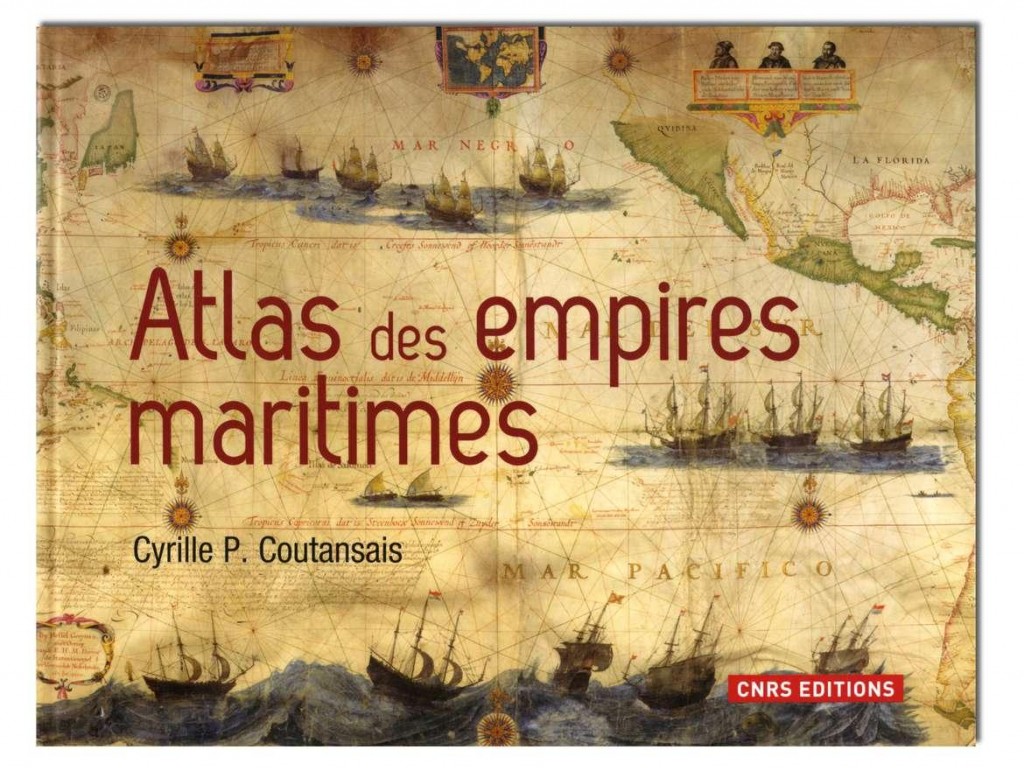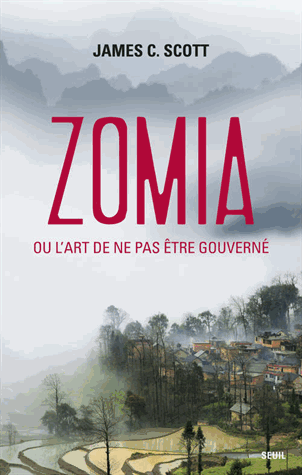Ce blog a déjà parlé des réseaux commerçants de l’océan Indien et de la route de la Soie, des diasporas en général, des réseaux sogdiens ou kârimî en particulier. Il a aussi présenté en détails la carrière d’un marchand juif de l’océan Indien, Abraham Ben Yiju, durant le 12e siècle. Il va s’agir aujourd’hui d’introduire plus généralement à l’histoire des réseaux marchands juifs qui ont tenu une place très importante dans le commerce afro-eurasien, mais pas toujours la première, comme on va le voir. L’enjeu pour l’histoire globale consiste d’abord à décrypter les logiques marchandes de ces réseaux anciens, élément à l’évidence crucial pour l’histoire des marchés. Il est aussi de comprendre comment la diaspora juive a pu fonctionner en bonne entente avec les pouvoirs musulmans et les commerçants d’autres origines. Cette histoire concerne l’océan Indien d’avant les Portugais, une époque caractérisée par des relations entre populations qui peuvent nous étonner aujourd’hui…
La présence juive est ancienne dans l’océan Indien occidental. Des juifs émigrent vers la côte Ouest de l’Inde sans doute dès la période de l’empire babylonien : les juifs de la région de Cochin ont conservé jusqu’à nos jours un type de jeu connu en Babylonie du temps de Nabuchodonosor II. Au début de l’ère chrétienne, des marchands juifs sont partie prenante dans le développement du commerce romain à partir de l’Égypte ; des juifs s’installent aussi en Perse et en Inde aux 1er et 2e siècles pour fuir le joug romain. Les persécutions des juifs dans l’État perse sassanide aux 5e et 6e siècles amènent à de nouvelles migrations vers l’Inde. La religion juive est par ailleurs bien implantée au Yémen avant l’islam.
Le développement du commerce au loin lors de la deuxième phase du système-monde afro-eurasien (6e-10e siècle) permet un déploiement des réseaux juifs. Selon le géographe persan Ibn Khordâdbeh, des juifs radhanites « contrôlent les routes de la soie » [1865, p. 513, et M. Lombard, 1971] (leur nom vient de la région de Radhan, à l’est du Tigre, non loin de Bagdad). L’aristocratie de l’Empire khazar du sud de la Russie se convertit au judaïsme vers 740, sans doute sous l’influence de ces juifs radhanites. Des juifs chassés de Byzance arrivent en grand nombre en Khazarie aux 7e et 8e siècles. L’irruption des armées musulmanes au Khwarezm entraîne également un départ des juifs de cette région vers la Khazarie. L’historien Abû Zayd, de Sîrâf, mentionne des juifs parmi les étrangers massacrés à Canton par les troupes du chef rebelle Huang Chao en 879. À côté des musulmans, les juifs sont également présents sur les routes maritimes de l’océan Indien. Le livre d’al-Sîrâfî que l’on appelait Livre des Merveilles de l’Inde (10e siècle) évoque ainsi la figure du grand marchand juif Ishâq, qui commerce entre l’Oman et la Chine [cf. D. Lombard, 1990, t. II, p. 28]. Au 8e siècle, l’exemple d’un certain Issupu Irappan (Joseph Raban) révèle l’intégration des marchands juifs dans le Sud de l’Inde et le respect qu’on leur accordait. À la tête de la guilde des Anjuvannam, Raban obtint des privilèges princiaux, l’exemption de toute taxe et un quart du revenu des commerçants du port de Cranganore sur la côte de Malabar. En « échange », Raban plaçait ses navires à la disposition du roi chera. La Relation de la Chine et de l’Inde indique aussi la présence de juifs à Ceylan.
Dans l’espace carolingien, des marchands juifs animent le commerce à longue distance, à côté de marchands lombards et frisons. Les négociants de ces réseaux juifs ont évidemment contribué à des transferts de savoirs et de techniques – ainsi dans l’industrie textile, vers l’Italie, mais aussi dans le domaine des techniques bancaires. À côté de chrétiens nestoriens, des juifs jouent un rôle important dans la transmission du savoir grec ancien dans le monde musulman.
Pour le troisième cycle du système-monde, les réseaux juifs nous sont mieux connus, pour leur importance dans la sphère économique, mais aussi parfois politique. Aux 10e et 11e siècles, en Irak et en Égypte, des représentants de familles marchandes juives sont établis comme banquiers officiels et collecteurs de taxes ; ainsi les banquiers Joseph b. Phineas et Aaron b. ’Amran, qui se sont associés pour fonder une firme au 10e siècle, prêtent de l’argent au calife et à ses vizirs. Ibn ’Allan al-Yahûdî (mort en 1079), collecteur de taxes à Basra, servit les califes pendant plus de vingt ans et prêta de l’argent au célèbre ministre des Seljukides Nizâm al-Mulk. D’autres marchands devinrent les fournisseurs du palais en marchandises précieuses.
En Égypte, le juif espagnol Benjamin de Tudela compte 30 000 juifs, dont 7000 au Caire. Dans l’Égypte fatimide, la gestion de l’État est parfois confiée à des fonctionnaires d’origine juive [Bianquis, 1999, p. 14]. Certains marchands accèdent à des fonctions importantes et même au vizirat. Un exemple célèbre est celui des frères Tustârî, d’Ahwâz, « banquiers juifs et négociants en objets précieux de l’océan Indien et de la Chine », qui gouvernèrent l’Égypte fatimide de 1036 à 1048 [M. Lombard, 1971, p. 169]. Au Caire, nous dit Benjamin de Tudela, réside « Rabbi Nathanael, le prince des princes et le chef de l’académie et de tous les juifs d’Égypte […]. Il est aussi ministre du grand roi qui demeure au palais de Tsoane el-Medinah » [Harboun, 1986, p. 131]. Les juifs dominent l’industrie et le commerce de la soie, une industrie déjà ancienne en Palestine et en Syrie.
Dans l’océan Indien occidental, aux 11e et 12e siècles, les marchands juifs semblent avoir la haute main sur le commerce en mer Rouge et entre l’Inde et le Yémen [Goitein 1954, Goitein et Friedman 2007]. Les lettres trouvées dans la Geniza de la synagogue du Caire (documents qui concernent surtout les 11e et 12e siècles, et pour les rapports avec l’Inde, la période 1080-1160) témoignent des contacts des marchands d’Égypte et du Yémen (juifs et arabes) avec ceux de l’Inde du Sud, juifs, arabes et indiens. Ces documents illustrent le rôle d’Aden et la dimension des réseaux de l’océan Indien. D’une famille d’origine persane, Madmûn ben Hasan, représentant des marchands et superintendant du port d’Aden, également propriétaire de navires, joue ainsi le rôle d’intermédiaire entre les juifs de Méditerranée et ceux installés en Inde. Il porte le titre de « leader de la communauté juive de l’océan Indien », dont jouiront également ses descendants. Son père, Hasan-Japhet ben Bundar, jouait déjà avant lui un rôle de représentant des marchands, de banquier, et de « leader des congrégations juives » [Goitein et Friedman, 2007, pp. 37sq.], et il était en charge de la douane d’Aden. La suprématie navale des chrétiens en Méditerranée au 12e siècle a peut-être incité certains marchands juifs à développer leur négoce avec l’océan Indien. Les marchands juifs exportent vers l’Inde des textiles (soie, drap de Russie…), du cuivre, du plomb, des récipients et ornements d’argent, de bronze, de verre, du storax, de l’huile d’olive, du corail et du papier. Les importations concernent des textiles, des épices, des aromates, des remèdes, des teintures, des bois, des perles et des pierres précieuses, des objets en fer ou en acier, des récipients de cuivre et de bronze. Les biens transportés ne concernent donc pas seulement des produits de luxe, mais toute une gamme de marchandises. Les importations indiennes étaient pour une part réglées avec des métaux précieux, argent et or, notamment à partir du 12e siècle, lorsque l’or de l’Afrique de l’Ouest et celui de la côte de Sofala trouvent leur chemin vers l’Égypte. Il est à noter que, contrairement aux juifs d’Asie occidentale et d’Asie centrale (radhanites, juifs du Khorassan…), les marchands juifs d’Aden et d’Égypte ne semblent pas impliqués dans la traite d’esclaves. Dans les années 1120, deux marchands juifs illustrent l’étendue des réseaux et des routes parcourues. Halfon, un fils de Madmûn, commerce entre Égypte, Inde, Afrique de l’Est, Syrie, Maroc et Espagne. Le juif Marocain ‘Abû Zikrî as-Sijilmassî, représentant des marchands du Caire, se déplace entre Égypte, Aden, Europe du Sud et Inde.
Au-delà de l’étendue des réseaux (pour l’Inde occidentale, douze ports au moins sont mentionnés), les documents étudiés montrent leur complexité. « Toutes les transactions s’effectuaient par l’intermédiaire d’associés, chacun des associés agissant dans une localité différente et pratiquant un commerce d’importation et d’exportation d’un pays à l’autre » [Gil, 2003, p. 273]. Les réseaux marchands recoupaient souvent des liens familiaux. Le caractère interconfessionnel de certains réseaux ou entreprises est par ailleurs remarquable. Les associations commerciales ne se faisaient pas seulement entre marchands juifs, mais pouvaient inclure juifs, musulmans, hindous et chrétiens nestoriens. Madmûn fait ainsi parvenir un message à des marchands indiens, les informant des prix du poivre et du fer à Aden. Il leur conseille d’envoyer un navire de Mangalore à Diu, avec poivre, fer, cubèbe, gingembre, coir, et bois d’aloès, « car toutes ces marchandises se vendent bien » [Goitein et Friedman, 2007, p. 59].
La coupure, remarque Goitein, « se fait moins entre les religions et les nationalités qu’entre les soldatesques dirigeantes et les commerçants entrepreneurs » [1954 : 197]. Toutefois, les entreprises commerciales mêlaient parfois marchands et élites politiques. Ainsi, Madmûn et le Yémenite Bilâl ben Jarîr, commandant des forces d’un sultan d’Aden, développent un partenariat dans le commerce avec l’Égypte [Margariti, 2007, p. 155], et possèdent conjointement un bateau qui voyage entre Aden et Ceylan.
Bagdad demeure le centre d’un rayonnement juif : l’exilarque (chef de la diaspora) y résidait, et « plusieurs des ministres du calife sont juifs » au 12e s. [Harboun, 1986, p. 63]. Parlant de l’île de Qays, en 1176, Benjamin de Tudela évoque la présence de 500 juifs installés là. Les juifs sont également bien présents dans l’Asie intérieure. À Samarcande, « où se rassemblent, nous dit Benjamin de Tudela (12e siècle), [des marchands] de tous les endroits du monde », demeurent « 50 000 juifs » (le nombre ici donné est cependant peu crédible, Benjamin de Tudela ne s’est pas rendu en Asie centrale). Ghaznî abrite également une forte communauté juive.
Les juifs transmettent des biens, mais ils sont aussi les vecteurs de savoirs techniques et culturels. Les juifs d’Italie et d’Espagne vont jouer un rôle important dans la transmission des savoirs grec et musulman dans le monde chrétien. Frédéric II, dirigeant du Saint-Empire romain germanique et roi de Sicile, attire à sa cour des savants juifs et musulmans. En dehors du commerce, M. Lombard note que « dans les corporations orientales, Juifs, Chrétiens et Musulmans sont admis à égalité; dans certaines, même, les non-Musulmans sont majoritaires, notamment chez les orfèvres, les négociants en métaux précieux et les banquiers, où les juifs tiennent un rôle considérable. La plupart des médecins sont chrétiens ou juifs » ([1980, pp. 175-176]. Le philosophe juif andalou Maïmonide (1135-1204), installé en Égypte, exerce comme médecin à la cour de Saladin.
Avec l’installation en Égypte du pouvoir ayyûbide en 1174 puis des mamlûks Bahriyya en 1250, et dans le Yémen rasûlide sunnite, l’importance des juifs dans le commerce au loin et la sphère politique va toutefois sensiblement décroître. Les liens des réseaux juifs du Yémen et d’Égypte avec l’Inde semblent se défaire. Les marchands musulmans, kârimî et autres, en relation avec le Yémen, le Gujarat et Cambay, deviennent prééminents dans le commerce de l’océan Indien.L’Ouest de l’Inde voit une implication croissante des musulmans dans le commerce, notamment au Gujarat et sur la côte du Malabar, où les marchands sont bien accueillis par les pouvoirs hindous. Une présence juive se maintient toutefois, comme en témoigne Marco Polo pour la ville de Kulam [1980, t. 2, p. 462]. Juifs et musulmans sont associés en 1282 dans l’envoi d’une mission commerciale à la cour de Kûbilai. En Perse, les Ilkhâns placent des juifs et des chrétiens dans leur administration. À partir du 13e siècle, cependant, avec l’expansion et le raidissement idéologique de l’islam, les juifs ne retrouveront jamais la place qui fut la leur au début du 2e millénaire dans les réseaux commerciaux de l’océan Indien.
Bibliographie
BEAUJARD, P., 2012, Les Mondes de l’océan Indien, t. 1 et 2, Paris, Armand Colin.
BIANQUIS, T., 1999, « Le monde musulman du IXe/IIIe siècle au XVe/Xe siècle », in J. C. Garcin et al. (éds.), États, sociétés et cultures du monde musulman médiéval, vol. 2, Paris, PUF.
GIL, M., 2003, « The Jewish merchants in the light of eleventh-century Geniza documents », Journal of the Economic and Social History of the Orient, 46 (3), p. 273-319.
GOITEIN, S. D., 1954, « From the Mediterranean to India. Documents on the trade to India, South Arabia, and East Africa from the eleventh and twelfth centuries », Speculum. A Journal of Mediaeval Studies, XXIX, 2 (1), p. 181-197.
GOITEIN, S. D., 1980, « From Aden to India : Specimens of the correspondence of India traders of the twelfth century », Journal of the Economic and Social History of the Orient, 23, p. 43-66.
GOITEIN, S. D., et FRIEDMAN, M. A., 2007, India Traders of the Middle Ages : Documents from the Cairo Geniza.« India Book », Part One, Leiden, Brill.
HARBOUN, H., 1986, Les Voyageurs Juifs du XIIe siècle (Benjamin de Tudèle ; Pétahia de Ratisbonne ; Nathanel Hacohen), Aix-en Provence, Éditions Massoreth.
IBN KHURDADBEH, 1865, Le Livre des Routes et des Provinces, éd. C. Barbier de Meynard, Journal Asiatique, mars-avril et mai-juin 1885, p. 227-296 et 446-532.
LOMBARD, D., 1990, Le Carrefour javanais. Essai d’histoire globale. t. I : Les Limites de l’occidentalisation. t. II : Les Réseaux asiatiques. t. III : L’Héritage des royaumes concentriques, Paris, EHESS.
LOMBARD, M., 1971, L’Islam dans sa première grandeur VIIIe-XIe siècle, Paris, Flammarion.
MARGARITI, R. E., 2007, Aden and the Indian Ocean Trade. 150 Years of the Life of a Medieval Arabian Port, Chapel Hill, The University of North Carolina Press.
POLO, M., 1980, Le Devisement du monde. Le livre des merveilles, 2 tomes, texte intégral établi par A.-C. Moule et P. Pelliot, version française de L. Hambis, introduction et notes de S. Yerasimos, Paris, Maspéro.
Relation de la Chine et de l’Inde, ‘Akbâr as-sîn wa l-hind, anonyme, SAUVAGET, J. (éd.), 1948, Paris, Les Belles Lettres.