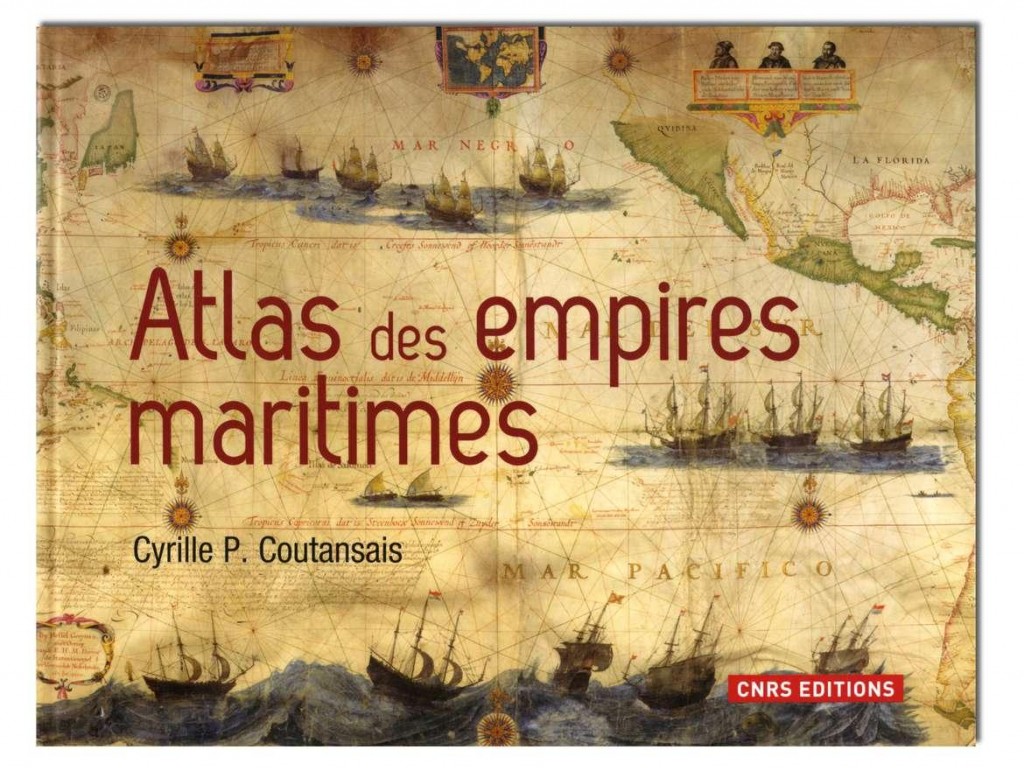Les trois siècles qui précèdent la révolution industrielle ne relèvent pas, au sens strict, de ce que l’on nomme aujourd’hui mondialisation économique. Cette dernière est historiquement matérialisée, du moins aux yeux de la plupart des économistes, par deux périodes spécifiques, dans les années 1860-1914 d’une part, depuis le milieu des années 1980 d’autre part. Il a néanmoins été montré que ces deux phases particulières révèlent des régularités sous-jacentes, éventuellement beaucoup plus anciennes. Au-delà de la libéralisation des échanges de biens et de capitaux (et des phénomènes de convergence connexes), ces deux périodes voient se conforter des régulations internationale ou supranationale qui vont certainement dans le sens d’un approfondissement des dispositifs de marché… Si bien que sur la longue durée le processus de mondialisation a pu être qualifié de synergie entre l’extension géographique des échanges et l’approfondissement des structures de marché [Norel, 2004]. Plus précisément, avant la révolution industrielle, c’est bien le grand commerce, l’expansion géographique des échanges (pas nécessairement ni toujours marchands) qui stimulerait la création de « systèmes de marché », entendus comme la mise en place, au côté des marchés de biens, de marchés de facteurs (terre, travail et capital) de plus en plus sophistiqués, permettant ainsi en principe une meilleure allocation des ressources. On sait en effet que les premiers marchés de facteurs dignes de ce nom en Europe apparaissent aux Pays-Bas puis en Angleterre, pays phares dans l’expansion commerciale qui suit le siècle d’or espagnol, et cela ne saurait être fortuit.
Si l’on envisage ainsi que la mondialisation constitue, non pas seulement un état repérable lors de périodes spécifiques, mais aussi et surtout un processus historique de longue durée, caractérisé par cette synergie entre un phénomène d’ordre géographique et une transformation institutionnelle particulière, alors il devient possible d’étudier les liens entre ce processus historique de mondialisation et la mise en place des innovations touchant les marchés de facteurs, innovations financières entre autres… Le développement de la finance de marché apparaît ainsi comme une conséquence directe de l’extension géographique des échanges et du développement du commerce hors frontières. Rien d’étonnant s’il émerge après le premier tour du monde (Magellan, 1522) qui fait que la terre devient promesse de conquête, et s’il s’accélère au 17e et surtout au 18e siècle, quand les revenus du commerce explosent.
La relative « dématérialisation » qui prend clairement son essor au 17e siècle, notamment aux Pays-Bas et en Angleterre (effets de commerce puis billets plutôt que métaux précieux et espèces), et l’intermédiation de professionnels (financiers organisant les émissions et plaçant les titres), s’expliquent par la croissance des échanges au sein des premiers « empires coloniaux ». On pense évidemment à la Compagnie néerlandaise des Indes Orientales, sa capacité à faire circuler sa signature, sa capacité à transférer des fonds de façon sûre et rapide. La City constitue, dans ce domaine, un autre exemple saisissant. Fondée sur la Tamise, juste à l’endroit où les bateaux arrivaient pour décharger leurs marchandises, la City est le nom du quartier le plus ancien de la ville. Le commerce y a du reste toujours été florissant et ce depuis le Moyen Âge, notamment avec les villes hollandaises, puis les villes de la Hanse et les villes italiennes entre les 12e et 14e siècles.
L’expansion du 16e siècle a amené les Britanniques, comme bien d’autres, à développer leur flotte marchande, ainsi que le commerce d’épices et de thé en provenance des pays asiatiques. Comme les bateaux et leur armement coûtaient chers, ils eurent l’idée de créer des sociétés, développant ainsi le principe de la commenda ou de la colleganza vénitienne (elle-même d’origine arabe). Ce système permettait au public d’investir en achetant des titres de la société et de profiter des bénéfices réalisés grâce au commerce. Il devint vite clair, que ces titres pouvaient se vendre et s’acheter, comme n’importe quel produit : ainsi commença l’histoire financière européenne. Certes, elle était aussi née de la dette publique, apparue clairement en Europe aux 14e et 15e siècles, mais avec des financeurs plus institutionnels (villes, grands marchands ou banquiers) et sans réel marché, à grande échelle, des titres de dette.
Au-delà de ces données factuelles qui montrent l’imbrication étroite entre grand commerce d’une part, innovations financières d’autre part, il nous faut analyser plus systématiquement la relation qui unit l’extension géographique des échanges et la formation du marché du capital en Europe de l’Ouest. Nous proposons de privilégier trois étapes dans l’enchaînement logique menant du simple commerce de longue distance aux perfectionnements du marché financier.
La première étape concerne la lettre de change, à la fois ses transformations en tant que moyen de paiement et son évolution en tant qu’instrument de crédit.
Cette lettre est d’abord une reconnaissance de dette sur papier, suite à une transaction commerciale entre partenaires étrangers. Muni de ce papier, le vendeur peut aller voir sa banque pour en percevoir immédiatement le montant, laissant alors la banque se débrouiller avec le client extérieur. Mais il peut aussi l’utiliser comme moyen de paiement et la transférer à quelqu’un d’autre qui aurait confiance dans la reconnaissance de dette signée par ce client. De fait, la lettre de change évolue au 16e siècle, en premier lieu parce que la révolution commerciale impose des distances plus longues, donc des délais supplémentaires avant perception des recettes liées à une transaction. Par exemple une importation de produits asiatiques en Europe devra être réglée aujourd’hui mais n’assurera un revenu qu’après que le produit soit parvenu en Europe… Cette extension géographique des échanges multiplie par ailleurs les partenaires éloignés et donc accroît aussi le risque de contrepartie commerciale.
Pour ce qui est de ce dernier, une solution partielle est trouvée à Anvers, dans la seconde moitié du 16e siècle, avec les pratiques d’endossement multiple des lettres de change [De Roover, 1953, p.83-118 ; Kohn, 1999, p.23-28]. Traditionnellement le « payé » ou « possesseur » d’une lettre de change, par exemple un exportateur, peut décider de ne pas présenter, auprès d’un merchant-banker domestique, le « payeur », la lettre de change remise par son client étranger (le « tiré » de la lettre), pour s’en servir à son tour comme moyen de paiement. Si les partenaires se connaissent bien, la circulation de la lettre comme moyen de paiement est sans difficultés. Un problème se pose évidemment en revanche dans un espace commercial élargi. Comment le nouveau récipiendaire peut-il être sûr que le merchant-banker « payeur » associé au « possesseur » est fiable ? Simplement en exigeant que celui qui lui remet la lettre de change appose sa signature au dos et se rende ainsi coresponsable du paiement final (au même titre que le « tiré » et le « payeur »). Avec la multiplication des usages successifs d’une même lettre comme moyen de paiement, la sécurité de celle-ci s’accroît d’autant puisque de plus en plus d’agents économiques affichent leur solidarité. Dans ces conditions, un vendeur peu enclin à courir des risques aura tendance à n’accepter en paiement que des lettres de change déjà endossées par des « signatures » prestigieuses… Les dangers liés à la multiplication des partenaires commerciaux sont ainsi circonscrits à partir du moment où la plupart, par la technique de l’endossement, confirment leur responsabilité dans la chaîne officielle de paiements.
Le premier problème (celui du délai entre le paiement du produit asiatique et sa mise en vente en Europe) est aussi indirectement réglé par cette même évolution. Les grands importateurs européens sont essentiellement, voire exclusivement, les grandes compagnies de commerce. Le prestige de leur signature leur permet de régler assez largement leurs achats sur d’autres continents par émission d’une lettre de change payable dans une « banque » locale (mais aussi à Londres ou Amsterdam) ou simple endossement d’une lettre déjà en circulation. Les vendeurs n’escompteront que rarement cette lettre dans la mesure où elle pourra leur servir de moyen de paiement local, à peu près unanimement accepté. En conséquence l’importation pourra avoir commencé de créer des revenus en Europe avant même d’avoir été payée, en espèces sonnantes et trébuchantes… Le règlement réel se fera, d’abord par compensation, puis ultérieurement et pour le solde, par le premier galion transportant du métal précieux…
Moyen de paiement, la lettre de change a toujours été aussi un instrument de crédit. Vendre à Londres, à un merchant-banker local, une lettre de change payable sur une banque d’Amsterdam, n’est rien d’autre qu’un emprunt à Londres réalisé par ce vendeur (« tireur » de la lettre). Le merchant-banker londonien détient alors une créance sur Amsterdam qui peut être incluse dans une opération de compensation. Mais se développent vite d’autres pratiques qui n’ont plus rien à voir avec le commerce. C’est notamment la technique du « rechange » utilisée dès la fin du Moyen Âge. Supposons qu’une lettre de change vendue à Londres et payable sur Amsterdam soit doublée par une lettre semblable, vendue par le « payeur » initial à Amsterdam et réglable au final par le « tireur » initial à Londres. Dans ce dispositif, il peut donc y avoir émission de deux lettres de change symétriques et qui se neutralisent sans contrepartie commerciale aucune… Ce genre de dispositif semble à l’époque avoir connu un grand succès parce qu’il permettait de déguiser une opération locale de prêt à intérêt, donc répréhensible aux yeux de l’Église, en une opération formellement internationale et a priori commerciale…
Mais ce qui est nouveau au 16e siècle, et encore à Anvers (officialisé en 1540), c’est l’escompte, par des money dealers, des lettres de change désormais endossables. En clair, ces agents achetaient avec un rabais (plus ou moins important selon l’état de resserrement du crédit) les lettres de change en circulation. Jusqu’alors de telles pratiques n’avaient guère concerné que les dettes publiques à Florence. Mais l’existence d’endossements rendait ces papiers fiables, donc négociables et ce, à n’importe quelle date avant leur maturité. Autrement dit cette négociabilité permettait de fixer des taux d’intérêt à diverses échéances, pour des instruments a priori sans risque. Comme on va le voir dans notre deuxième partie, on dispose alors de ce qui serait « le fondement de la banque commerciale moderne, aux 17e et surtout 18e siècles » [Kohn, 1999, p. 28]. Là encore l’évolution commerciale extérieure serait bien au point de départ, avec la nécessité de l’endossement des lettres de change, des tout premiers pas de la banque commerciale…
Mais surtout le financement à long terme des opérations lourdes qu’impose le grand commerce (armement des bateaux, achat des cargaisons…) amène d’une certaine façon la transformation de crédits à court terme, matérialisés par une lettre de change, en crédits à long terme sous forme de rentes sur les sociétés commerciales. C’est là notre deuxième étape. Au tout début du 17e siècle, la Compagnie néerlandaise des Indes Orientales, la VOC, finance ses premières opérations par emprunt à court terme. Celui-ci prend la forme d’une vente de lettres de change domestiques. Mais devant la multiplication des voyages, la compagnie décide, en 1609, de convertir ces dettes en « parts » de la société. Techniquement, le procédé consiste à convertir les lettres en rentes perpétuelles négociables, sur le modèle de celles qui avaient été créées en 1542 pour financer l’impôt exigé par Charles Quint de ses provinces flamandes… Autrement dit les exigences du grand commerce amènent à étendre aux sociétés commerciales le type de financement qui était jusqu’ici, et depuis peu, l’apanage des puissances publiques provinciales. Mais il y a aussi des raisons politiques à cette extension.
La VOC en effet a commencé comme une entreprise gérée strictement par des représentants politiques des différentes provinces (les Heeren XVII). Et l’obtention de parts dans la société, sous forme de rentes perpétuelles, ne devait en rien modifier cet état de fait. Ce type de gouvernance d’entreprise, dans lequel les porteurs de parts n’ont strictement aucun contrôle opérationnel et, en quelque sorte, « mandatent » des représentants du pouvoir politique pour gérer au mieux l’entreprise, semble avoir à son tour stimulé l’innovation financière précédemment décrite. D’une part les pouvoirs politiques provinciaux avaient tout intérêt à trouver un financement de long terme pour la VOC qui n’entame pas leur propre contrôle : à l’inverse la cession de droits à des privés par la couronne britannique pour mener à bien les grandes compagnies commerciales s’est accompagné d’un net recul du contrôle étatique. La création de rentes perpétuelles était donc un bon moyen, pour les pouvoirs provinciaux, de conserver le contrôle et de tirer parti au maximum des bénéfices dégagés. D’autre part il semble que ce dispositif de gouvernance ait permis le spectaculaire succès de l’émission des rentes citées : les souscripteurs étrangers semblent avoir été positivement sensibles au fait que cette « augmentation de capital » allait accroître les moyens d’action de la VOC, sans diluer le pouvoir de décision effectif [Neal, 1993, p. 9]. En définitive, l’exigence d’innovation financière, issue du rôle moteur des Provinces-Unies dans l’économie monde du 17e siècle, s’est trouvée facilitée, dans sa mise en œuvre, par un mode très particulier de gouvernance de la principale compagnie néerlandaise de l’époque…
La troisième étape, dans laquelle se manifesterait une influence déterminante de l’extension géographique des échanges sur les innovations financières, est sans doute à situer au début du 18e siècle. Tant en France qu’en Angleterre, une réponse au surendettement de l’État est, on le sait, la vente aux épargnants de titres de dette des grandes compagnies commerciales (compagnie d’Occident devenue compagnie des Indes en France, compagnie des Mers du Sud en Angleterre) en échange des rentes sur le Trésor royal détenues par ces mêmes particuliers. Une fois en possession de ces rentes, les compagnies en négociaient le « remboursement » avec ce même Trésor, notamment par l’obtention de privilèges commerciaux supplémentaires ou encore le monopole de frappe des monnaies. On sait qu’en France, ce dispositif devait aussi être associé à l’émission massive de billets par la Banque Royale, notamment afin de contribuer à l’achat de titres de la Compagnie des Indes, débouchant sur la panique associée au nom de John Law et à une réelle méfiance vis-à-vis des billets de banque pour plusieurs décennies. C’est au début 1720 qu’éclate la bulle boursière en France. En Angleterre, l’éclatement de la bulle sur les titres de la South Sea Company survient en août 1720, six mois après l’autorisation d’émettre des titres en échange de rentes publiques.
Ce qui frappe dans les deux chronologies, c’est d’abord l’instrumentalisation, par les pouvoirs publics, des grandes compagnies et de leurs perspectives de bénéfice commercial, pour se désendetter d’une façon particulièrement habile (même si elle devait très mal tourner en France). En clair on adossait les dépenses publiques et la prospérité permise par l’émission monétaire sur les espoirs plus ou moins fantasmatiques de profits commerciaux sur longue distance. Et l’on pourrait alors penser que cette instrumentalisation du commerce au long cours fut alors une dramatique erreur. Il est probable au contraire que cette « faute » devait servir l’innovation financière en stabilisant les marchés financiers et en relançant la croissance… Pour Neal [1993, p. 80], c’est non seulement la prospérité des vingt années qui ont suivi, mais aussi et surtout « le renforcement des liens financiers entre Londres et Amsterdam » qui furent les vraies conséquences des deux crises. Ce renforcement serait imputable à l’habitude prise par les spéculateurs de spéculer alternativement sur Paris, Londres et Amsterdam et de procéder à des allers-retours successifs, en fonction des événements. Par ailleurs, il apparaît clairement que les deux marchés financiers deviennent beaucoup plus intégrés et efficients à partir de 1725 (idem, p. 163). Le premier marché international des capitaux serait donc indirectement imputable à cette instrumentalisation des profits des compagnies maritimes, si dramatiquement vécue en 1720…
BOYER-XAMBEU M.-T., DELEPLACE G., GILLARD L., [1986], Monnaie privée et pouvoir des princes, Paris, Editions du CNRS et Presses de la FNSP.
De ROOVER R., [1953], L’Évolution de la lettre de change, 14ème – 18ème siècle, Paris, Armand Colin.
KOHN M., [1999], Bills of Exchange and the Money Market to 1600, Dept of Economics – DartmouthCollege, Working paper 99-04.
NEAL L., [1993], The Rise of Financial Capitalism – International Capital Markets in the Age of Reason, Cambridge, CUP.
NOREL P. [2004], L’Invention du Marché, une histoire économique de la mondialisation, Paris, Seuil.