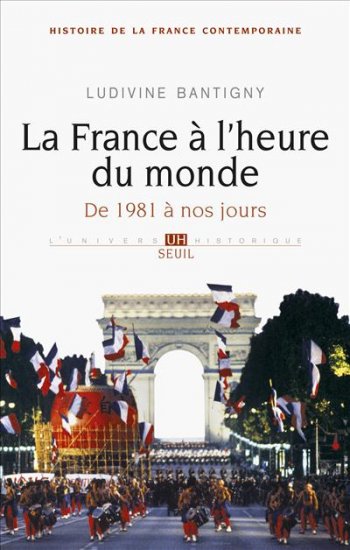Ludivine Bantigny, 2013, La France à l’heure du monde. De 1981 à nos jours, Paris, Seuil, coll. « L’Univers historique ».
L’ouvrage de Ludivine Bantigny se lit avec plaisir. L’écriture est leste, riche d’assonances et d’échos intertextuels, et l’auteure joue avec la mémoire vive du lecteur. La période couverte est relativement courte, trente ans, un peu plus, mais par l’ensemble des aspects abordés, ce travail est une somme très riche sur la France du temps récent – au risque peut-être d’un effet kaléidoscopique et de chatoiements stylistiques. Nombre de paragraphes susciteront autant de satisfaction que de frustration. On voudrait souvent en savoir plus. Cependant, on appréciera la diversité des recherches sollicitées, géographiques, sociologiques, anthropologiques, économiques… La nature « totalitaire » de l’histoire, comme le disait Fernand Braudel, est manifeste. Néanmoins toutes ces réflexions sont mobilisées par une historienne qui entend bien mettre le temps au centre de son analyse, ce qui n’est pas si banal, et plus encore s’interroger sur la maîtrise du temps : « qui donne l’heure » (p. 11). Mais ce temps est essentiellement pris dans sa dimension diachronique, dans son écoulement. La problématique axiale est celle du changement, même si ce n’est pas toujours celui promis par les politiques. Au lecteur de suivre les enchevêtrements de ces histoires parallèles de la France et de saisir la toile du Monde qui y est tissée en filigrane.
Il ne s’agira pas ici de faire un compte-rendu complet de cet ouvrage (on renverra par exemple à l’excellent billet d’Éric Fournier dans les Carnets d’Aggiornamento ou encore à celui de Vincent Chambarlhac et de Jean-Paul Salles dans la revue Dissidences), mais d’en proposer une lecture au regard de l’histoire globale. Involontairement, « l’heure du monde » entre en résonance avec le titre du livre de Serge Gruzinski, Quelle heure est-il là-bas ?, et d’une certaine manière, c’est bien la question que pose Bantigny : l’heure d’ici est-elle l’heure d’ailleurs ? Avec la synchronisation des sociétés du Monde, corrélative au processus de mondialisation, la contemporanéité globale s’inscrit de toute évidence comme une problématique centrale de la recherche historique d’un présent qui est aussi devenu une coprésence.
La première critique qu’on pourra adresser au texte de Bantigny est la difficulté à poser la notion même de mondialisation. Certes, en introduction, elle évoque succinctement le débat sur l’ancienneté du processus, opposant de façon assez étonnante des géographes qui seraient des historiens de la longue durée (sans doute Christian Grataloup, quoiqu’il ne soit ni cité ni référencé) et des anthropologues qui feraient de la mondialisation une expérience inédite (Marc Abélès probablement), mais sans parler d’histoire globale – signe indubitable au demeurant des difficultés de ce courant historiographique à pénétrer la recherche française et l’université. Au fil de l’ouvrage, les acceptions se multiplient et l’auteure ne parvient pas totalement à trancher. Toutefois, soyons honnête, cette confusion n’est pas propre à Bantigny. L’éclaircissement apporté par Cynthia Ghorra-Gobin aurait été bien utile entre :
1. la globalisation, qui correspondrait assez classiquement à l’expansion du capitalisme, à sa financiarisation et à sa transnationalisation ;
2. la mondialisation, qui désignerait l’émergence d’une nouvelle échelle, corollaire de l’interconnexion croissante des lieux ;
3. et la planétarisation, qui serait la prise de conscience de la planète Terre comme écosystème fini [1].
Quelles relations internationales dans un monde global ?
Dans la première partie de l’ouvrage, consacrée à l’histoire politique, le propos est sobre et sans ambiguïté : « Que peut vraiment une nation dont la surface s’étend sur moins de 1 % du globe, dont la population n’atteint pas même 0,5 % du total mondial et dont les moyens militaires ne lui permettent pas de rivaliser avec les “Grands” [p. 221] ? » La France n’est plus qu’une puissance moyenne et Bantigny montre bien les hésitations et les errements des gouvernements successifs pour maintenir une certaine autonomie de la France à l’intérieur d’un bloc occidental informel qui la maintient à sa place dans le Monde. De ce point de vue, l’Afrique reste le terrain d’hégémonie de la France, comme le rappellent encore une fois les dernières interventions militaires au Mali et en Centrafrique décidées par le président François Hollande. Mais pour traiter l’inéluctabilité d’un tel déclassement, le cadre imposé des trente dernières années ne permet pas d’aborder le processus de mondialisation dont dès le 19e siècle certains auteurs ont annoncé qu’il entraînerait un polycentrisme croissant. « L’heure du monde est aussi celle de nouveaux pivots » [p. 254] écrit Bantigny. « À l’ère de la politique européenne, a pour jamais succédé l’ère de la politique “mondiale” » écrivait Anatole Leroy-Beaulieu en 1901. Quelle est aujourd’hui la place de la douleur causée par la perte du rang dans la culture politique française ? Quelle est la légitimité d’« une puissance mondiale à vocation et ambition mondiales » [p. 254] ?
Quelle politique face à une économie globalisée ?
Dans un chapitre consacré à la domination et aux contestations du « néolibéralisme » (les guillemets sont de l’auteure), Bantigny remarque qu’« au début des années 1980, les expressions de “globalisation” et de “mondialisation” n’ont pas encore cours ; mais les processus économiques qui en constituent les contours s’imposent déjà en pratique » [p. 167]. Le lien entre mondialisation et néolibéralisme est donc prégnant et l’erreur d’optique est habituelle. S’il est vrai que le mot « globalisation », issu de l’anglais globalization, ne se diffuse massivement en France qu’à partir des années 1990, le mot « mondialisation », apparu pendant la Première Guerre mondiale, est usité, certes rarement, mais de plus en plus régulièrement depuis la fin des années 1940. Rappelons ainsi qu’en 1983, la notion est inscrite dans les programmes de géographie de classe de terminale et qu’elle est présente dans les manuels. Le rectificatif – « la mondialisation diffère de la seule “globalisation” entendue comme extension du marché et des réseaux de communication […] ; elle se fait transnationale par ses nouvelles mobilités et ses cultures partagées » (p. 449) – ne suffit pas à lever une certain ambiguïté. L’angle d’attaque de Bantigny, qui fait de son ouvrage une histoire critique, est celui de la politique :
« Si les États ne sont pas, loin s’en faut, les seules instances de décision, ils conservent leurs monopoles et leur autorité. Et si l’État, au cœur du “néo-libéralisme”, se démet de certaines prérogatives, il garde l’initiative, même pour organiser le marché. » [p. 9]
Le titre s’explicite ainsi par une citation de Pierre Bérégovoy lorsque celui-ci affirme dans une interview d’avril 1985 qu’il est temps de « mettre nos montres à l’heure », i.e. à l’heure du marché mondial.
« En France, le dirigisme est de droite.
Les socialistes ont à réfléchir là-dessus. Dans une économie où l’État dispose de puissants moyens d’orientation, avec la fiscalité, le budget, le plan, le secteur public, il faut laisser le marché jouer pleinement son rôle. Le marché n’est ni de gauche ni de droite. Il a une fonction d’échange qui est à restaurer. Le socialisme, c’est la liberté, sur ce terrain aussi, à condition que l’on n’oublie pas que la vraie liberté exige solidarité et égalité des chances. »[2]
Pascal Lamy n’est cité que pour son appréciation critique, mais tardive, du marché, moins pour son rôle à la tête de l’Organisation mondiale du commerce de 2005 à 2013, alors même qu’il est membre du Parti socialiste français depuis longtemps. Le fait aurait pourtant pu être souligné pour montrer à quel point ce parti s’est mis à l’heure du capitalisme mondial et a délaissé le vieil internationalisme ouvrier, qui a été un mondialisme.
Cependant, la critique de la politique économique est affaiblie par une analyse économique dispersée. Dans un tout autre chapitre, à propos d’une mondialisation de l’agriculture juste évoquée, la reterritorialisation de la production entamée par certains agriculteurs au profit de la qualité et de circuits courts est présentée comme un modèle de résistance au système productif global. Mais pourquoi ne pas avoir accordé plus de place à la désindustrialisation ?
Quel m/Monde ?
Au-delà de la seule notion de « mondialisation », dont on reconnaîtra qu’elle n’est pas simple, celle de « monde » est elle-aussi utilisée de façon très versatile. On le sait, le mot renvoie à deux sens distincts : soit l’ensemble de ce qui est (ce qui peut être plus ou moins vaste selon la focale, du proche à l’universel), soit l’ensemble de ce qui est sur la terre. Cette ambiguïté a conduit les géographes français, à la suite d’Olivier Dollfus, à mettre une majuscule à Monde lorsqu’ils désignent l’espace global tel qu’il a été unifié par le processus de mondialisation. Ce qui a bien des avantages. Dans son texte, en revanche, Bantigny multiplie les expressions où « le monde » n’est pas « le Monde », alors même que c’est bien ce dernier qu’elle a placé en titre. Un certain nombre de sous-titres par exemple, « Le monde à bras-le-corps », « La conscience du monde », ne renvoient nullement au Monde et déroutent le lecteur qui chercherait précisément des réflexions sur la conscience du Monde – problématique qui vient par ailleurs de faire l’objet d’une habilitation à diriger les recherches par Clarisse Didelon-Loiseau, elle aussi maîtresse de conférences à Rouen, mais en géographie (Le Monde comme territoire, 2013).
Erreur bénigne, Bantigny attribue à Hervé Le Bras l’image du Monde comme « village » (1992) quand elle est répétée régulièrement depuis son emploi par Marshall McLuhan dans The Medium is the Message en 1967.
Quelle conscience planétaire ?
Pareillement, la notion d’« imaginaire planétaire » est assez malmenée. Ce qu’on ne reprochera pas à Bantigny tant la confusion entre planétaire, mondial et global est généralisée et peut-être inextricable. Cependant, il est bien clair que la quatrième partie du livre, dont c’est le titre, ne parle qu’assez peu de la conscience planétaire ou même de l’imaginaire mondial. Qu’en est-il de la planétarisation en France ?
L’histoire des Verts (p. 115 sq.) est traitée dans l’histoire politique. Ailleurs, dans la partie plus sociologique, aucune mention n’est faite de Nicolas Hulot, de son émission Ushuaïa Nature, diffusée de 1998 à 2011, et de son implication lors de l’élection présidentielle de 2007 ; ni de Yann Arthus-Bertrand, dont l’œuvre photographique « La Terre vue du ciel », réalisée en 1994 en partenariat avec l’Unesco, a eu un incontestable succès, en France et ailleurs dans le Monde : le livre, traduit en une vingtaine de langues, a été vendu à plus de trois millions d’exemplaires et l’exposition gratuite de grands panneaux photographiques, inaugurée sur les grilles du jardin du Luxembourg en 2000, a fait le tour du Monde – j’ai pour souvenir d’avoir vu ces grands panneaux accrochés dans la rue au pied de la citadelle d’Alep, à l’époque où la Syrie était en paix. L’un et l’autre ont indéniablement contribué à diffuser une sensibilité à l’environnement planétaire, et à connecter l’opinion française à l’opinion internationale. Cela aurait permis de compléter les réflexions inspirées par l’ouvrage d’Edgar Morin, Terre-patrie, paru pour la première édition en 1993, et cité implicitement à propos de la prise de conscience planétaire [p. 359].
Quelle transnationalité ?
La dimension transnationale est également peu explorée, quoique évoquée en conclusion. Exemple parmi d’autres, lorsque l’auteure aborde la question du foulard, hormis quelques références à la révolution iranienne et à la fatwa lancée contre Salman Rushdie, la contextualisation reste maigre. L’auteure donne peut-être une clef de la peur, mais pas une explication d’un phénomène complexe qu’on retrouve dans les pays voisins (en Belgique, en Allemagne…) et ailleurs dans le monde (en Turquie, en Tunisie…).
Parmi les pratiques du quotidien, la cuisine est également rapidement faite alors que l’évolution des modes alimentaires s’inscrit pleinement dans le processus de mondialisation. On aurait pu trouver davantage de réflexions sur le développement des vendeurs de kebab ou des restaurants japonisants, et inversement sur l’exportation de la gastronomie française. « À quelle heure mange-t-on en France ? » soulève la question de la persistance d’une culture nationale et aux limites de la synchronisation globale. Le repas à la française a été récemment classé au patrimoine mondial de l’humanité (cf. un récent article dans le journal Le Monde).
L’« exception culturelle », évoquée mais non traitée, aurait pu constituer un axe d’analyse plus conséquent. Apparue en 1993 à l’occasion d’un nouveau cycle de négociations du Gatt, la notion n’a depuis cessé d’être brandie pour défendre la production d’œuvres culturelles françaises contre un libéralisme qui réduirait la culture à une simple marchandise comme les autres et qui entraînerait un recul de la culture française face à la culture états-unienne.
Quelle histoire-Monde ?
On trouve au terme de l’ouvrage un très court chapitre de conclusion assez étonnamment intitulé « L’histoire faite monde » – n’était-ce donc pas là l’enjeu même du livre en son entier ? Il y est rapidement question d’hybridations culturelles. Or, si on reste dans ce domaine, où on sent bien les choix personnels de l’auteure, l’absence d’Édouard Glissant peut surprendre. En créant en 1997 la notion de « Tout-monde », il proposait un dépassement de la créolité vers la mondialité, cet état d’interpénétration des identités et des cultures.
Présentation de la notion glissantienne de « Tout-monde » par Patrick Chamoiseau (RFO, 1998) – http://www.edouardglissant.fr/toutmonde.html
Même si l’analyse d’Édouard Glissant est discutable, la créolisation aurait pu être une problématique intéressante pour interroger « la France à l’heure du monde ».
Global Islands – An ongoing discussion with Édouard Glissant (réal. Cecila Tripp, New York, 2004)
« Ce qu’il faut voir aujourd’hui, c’est que les périphéries, au fond, qui sont les endroits faibles du point de vue de la puissance, économique, politique, militaire, social, etc., sont de plus en plus des endroits forts du point de vue de l’imaginaire, du point de vue de la conception du monde, du point de vue du vécu du monde, du point de vue de l’emploi des langues. »
Enfin, une question, fondamentale, reste en suspens : pourquoi la France s’enfonce-t-elle dans la peur du Monde ?
Post-scriptum. Terminons par une critique plus personnelle. Malgré une prolepse : « la figure géométrique de l’“Hexagone” laisserait à tort oublier les terres lointaines que la France s’est octroyée et qui, bien de France, sont des territoires contestés » [p. 338], l’outre-mer n’occupe que très peu de place dans cette histoire de la France. L’île de Mayotte, placée « au milieu de l’océan Indien », est présentée comme un « bout du monde » où l’isolement s’ajouterait à l’enclavement. Pourtant, située au milieu du canal du Mozambique, entre Afrique et Madagascar, Mayotte n’est séparée que de 70 kilomètres d’Anjouan, l’île comorienne la plus proche, à portée de kwassa-kwassa, ces embarcations utilisées par les passeurs pour amener des milliers de clandestins sur une île qui est une promesse de mieux-vivre. De façon générale, l’anecdotique (le « jardinage » à La Réunion…) l’emporte sur l’analyse de fond et sur les homologies qu’on aurait pu signaler entre outre-mer et métropole : la périurbanisation, le tout-automobile, et inversement les questions de la densification du bâti, du développement des transports en commun, de la création de parcs nationaux et de réserves, parfois perçus comme une forme de néo-colonisation écologique.
[1] Cynthia Ghorra-Gobin (dir.), 2012, Dictionnaire critique de la mondialisation, Paris, Armand Colin (rééd. revue et augmentée de l’éd. de 2006).
[2] « Pierre Bérégovoy répond à Raymond Barre. Un entretien avec le ministre de l’Économie et des Finances », propos recueillis par Jacques Mornand et Roger Priouret, Le Nouvel Observateur, 5 avril 1985, pp. 26-27. Remarque en passant, on aurait souhaité que les citations et les références de l’ouvrage soient données avec précision.