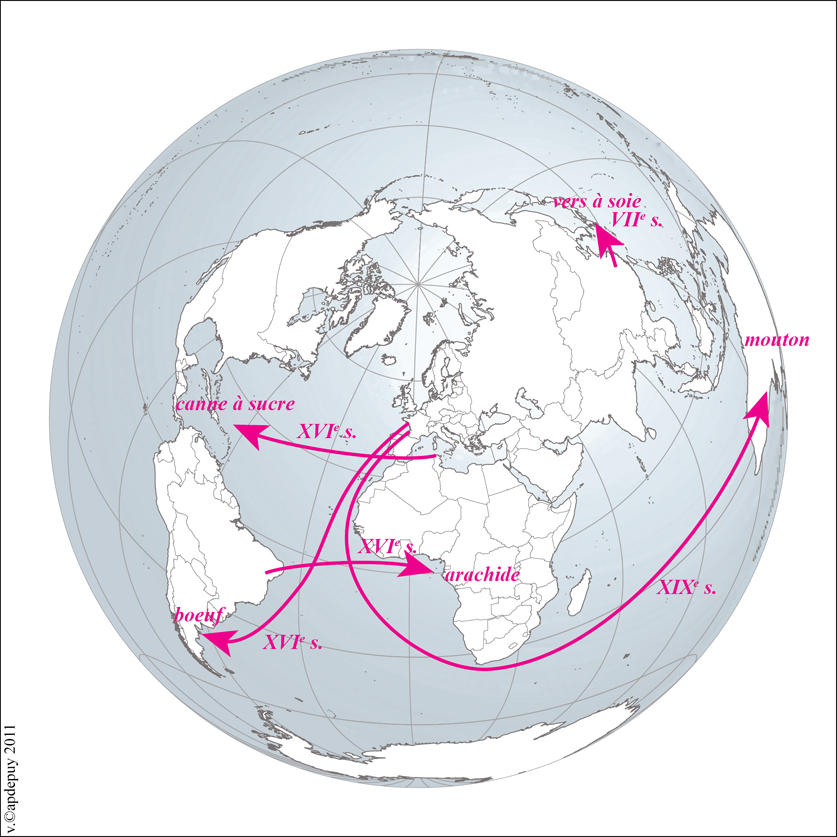Disons le d’emblée, l’objet de l’étude du jour a un statut un peu particulier car il servira désormais de logo à cette « histoire globale par les sources » entamée depuis le mois de septembre dernier. Il s’agit d’une carte, ou plus exactement d’un ensemble de cartes assemblées en un globe, un globe plat et dépliable : un fold-O-globe.
Le brevet en a été déposé en 1942 par Gerald A. Eddy, cartographe connu pour ses représentations panoramiques (par exemple de Los Angeles). Selon son concepteur, l’objet est révolutionnaire :
« ‘Rond comme la Terre elle-même’, ce fold-O-globe représente la première invention importante en 474 ans : une projection cartographique en continu conçue de manière à montrer en un seul coup d’œil les pays et les villes les plus importants dans le Monde et les véritables relations entre les continents. »
Figure 1. Le dépliement virtuel du globe
Même s’il est permis de douter du caractère résolument nouveau de ce type d’objet (cf. par exemple sur le site de la David Rumsey Maps Collection un globe pliable britannique de 1852), le fold-O-globe n’en demeure pas moins intéressant par ce qu’il révèle d’un phénomène majeur qui se produit aux États-Unis dans le courant de la Seconde Guerre mondiale et qu’on pourrait qualifier d’invention de la globalité.
L’entrée en guerre des États-Unis après deux décennies de relatif isolationnisme a provoqué une réelle rupture dans la vision états-unienne du Monde. Ceci se manifeste par un véritable engouement pour la question cartographique, dont le fold-O-globe n’est qu’un témoin assez marginal. Le rôle majeur a été tenu par Richard Edes Harrison, dont les illustrations cartographiques peu conventionnelles ont frappé l’imagination de ses concitoyens (Schulten, 1998). Harrison n’était ni géographe ni cartographe de formation, mais architecte ; le hasard l’a conduit à participer à l’illustration du magazine Fortune à partir de 1940. Optant pour une représentation non orthodoxe, il dessinait des cartes des différentes régions du conflit à partir de vues du globe « de l’espace ». Certaines ont été rééditées dans un atlas avant même la fin du conflit (Harrison, 1944), mais c’est surtout la carte qu’il a réalisée en juillet 1941 qui a marqué un tournant, quelques mois avant l’attaque aérienne sur Pearl Harbor et l’entrée en guerre des États-Unis.
Figure 2. The World divided (Harrison, Fortune Magazine, août 1941)
Le monde est vu selon une projection azimutale équidistante centrée sur le pôle Nord, ce qui permet d’embrasser le globe, et donc la guerre, d’un seul coup d’œil. L’idée n’est pas en soi particulièrement nouvelle puisque la première de la sorte est celle de Guillaume Postel au 17e siècle, mais son utilisation dans le contexte de la guerre mondiale a eu un impact très fort et dès mars 1942, Harrison réédita une carte de ce type, actualisée.
Figure 3. One World, One War (Harrison, Fortune Magazine, mars 1942)
En marge de la carte, on peut lire une des premières utilisations de l’expression « global war ». Celle-ci souligne le caractère différent de ce conflit par rapport au précédent. Alors que la Première Guerre mondiale fut qualifiée dès 1915 de « world war », la seconde commença à partir de 1942 à être qualifiée de « global war ». Un échelon supplémentaire dans l’extension de la guerre semblait avoir été franchi, en particulier du point de vue américain puisque les États-Unis, à partir de 1942, furent engagés sur les deux fronts, de part et d’autre du globe. Le terme de « globalization » semble ainsi avoir été inventé en 1943/1944 dans le cadre de la réflexion qui entoure les conférences de Moscou et de Téhéran de la fin de l’année 1943, où la décision fut prise de créer une organisation internationale des Nations unies (Capdepuy, 2011b).
La guerre a fait naître un besoin subit de mieux connaître le monde. C’est à peu près en ces termes que l’idée est exprimée en titre d’un article de Life du 3 août 1942.
Figure 4. Global war teaches global cartography (Life, 3 août 1942)
Ce besoin de voir le monde est général. Au cours de l’année 1942, sur une suggestion du général Dwight Eisenhower, George Marshall, chef d’état major de l’armée et conseiller de Roosevelt, fit construire deux globes de cinquante pouces (1 mètre 27) pour les offrir l’un à Roosevelt, l’autre à Churchill, à l’occasion de Noël. Il devait les aider à suivre les opérations militaires qui se déroulaient aux quatre coins du monde. À en croire Khrouchtchev, à la même époque, Staline aurait également eu à sa disposition un très grand globe sur lequel il décidait de la stratégie soviétique. Quant au fold-O-globe, il n’est finalement que la version populaire et portative de ces globes.
Figure 5. Le « globe du Président » dans le bureau de Franklin D. Roosevelt à la Maison Blanche (Life, 1943)
En 1942, Wendell Willkie, l’ancien candidat républicain aux élections présidentielles de 1940, désormais rallié à Franklin D. Roosevelt, fut chargé en tant que représentant spécial du président américain de faire un tour du monde en avion pour rencontrer quelques-uns des principaux alliés des États-Unis. Il réalisa son périple en quarante-neuf jours, du 26 août au 14 octobre 1942 :
« Si j’avais eu quelques doutes sur le fait que le monde était devenu petit et complètement interdépendant, ce voyage les aurait complètement dissipés. »[1]
De retour aux États-Unis, Willkie publia un livre dans lequel il reprit un certain nombre de ses observations et de ses réflexions. L’ensemble se présente comme un chapelet de considérations régionales sur El Alamein, le Moyen-Orient, la Turquie, l’URSS, la Chine et in fine sur les États-Unis, leur place dans le monde, leur rôle dans la guerre et celui qu’ils devraient avoir dans l’après-guerre. Car l’essentiel de l’ouvrage est là, dans l’affirmation de l’engagement des États-Unis en faveur de la liberté politique et économique d’un monde désormais uni, Willkie reconnaissant l’importance de l’idéal wilsonien et incidemment l’erreur du choix isolationniste commise par les républicains à la fin de la Première Guerre mondiale. Une phrase en résume peut-être l’esprit général :
« Notre pensée à l’avenir doit être à l’échelle du monde [world-wide]. »[2]
Cependant, l’implication militaire des États-Unis à la fois en Asie et en Europe n’est pas le seul facteur permettant d’expliquer l’élaboration de cette nouvelle vision du Monde et la fin de l’isolationnisme états-unien. Certes, la guerre a été le révélateur du besoin de mieux connaître ce Monde, un espace dont les parties sont désormais interdépendantes et où les États-Unis ne peuvent plus se considérer comme une île. C’est ce qu’écrivait Wendell Willkie en 1943 :
« Aujourd’hui, à cause des diverses censures, militaires et autres, l’Amérique est comme une cité assiégée qui vit entre de hautes murailles au travers desquelles ne passe qu’occasionnellement un courrier pour nous dire ce qui se passe à l’extérieur. J’ai été hors de ces murs. Et j’ai découvert que rien à l’extérieur n’est exactement comme il le semble à ceux qui sont à l’intérieur. »[3]
Mais c’est sans doute l’avion qui fut le principal facteur de cette prise de conscience du rétrécissement du globe :
« Quand je dis que la paix doit être planifiée sur une base mondiale, j’entends littéralement qu’elle doit embrasser la terre. Continents et océans ne forment pleinement que des parties d’un tout, vues, comme je les ai vues, des airs. »[4]
La carte mise au revers de la couverture est là pour l’illustrer.
Figure 6. Le trajet de Wendell Willkie à bord du Gulliver (One World, 1943)
C’est en effet tout autant la guerre que le développement de l’aviation qui est à l’origine de cette nouvelle vision du monde. L’usage commercial de l’avion remonte à l’après-guerre. Sa nouveauté est signalée dès 1925 par le géographe René Crozet dans un article des Annales de géographie :
« L’avion, engin d’expérience et de sport avant la guerre, instrument de combat pendant les hostilités, tend, depuis 1918, à devenir un moyen de transport. Le dernier venu et le plus rapide des engins créés par l’homme pour diminuer les distances ouvre à l’humanité le domaine illimité de l’atmosphère. Au-dessus de la route, du rail et du navire, l’avion commence à prendre rang parmi les moyens modernes de circulation. »[5]
En juin 1936, le journaliste américain John E. Lodge célèbre la traversée transatlantique entre Francfort et Lakehurst par le zeppelin Von Hindenburg au mois de mai, quelque temps après la mise en place de la traversée transpacifique entre San Francisco et Manille par l’hydravion China Clipper en novembre 1935 :
« Le Phileas Fogg de 1936 peut acheter ses tickets à l’avance et peut accomplir un tour du monde par les airs en tout confort. »[6]
A partir de 1942, on constate aux États-Unis une multiplication des atlas et des ouvrages qui ne sont pas reliés directement au conflit mondial, mais bien au développement de l’aviation. Les titres et les couvertures sont explicites : Toward New Frontiers of Our Global World (Engelhardt 1943), Our Global World: A Brief Geography for the Air Age (Hankins 1944), Atlas of Global Geography (Raisz 1944), Our Air-Age World: A Textbook in Global Geography (Packard et al. 1944).
Figure 7. Our Global World: A Brief Geography for the Air Age (Hankins, 1944)
Un événement mérite également d’être mentionné : en juillet 1943, une exposition s’ouvrit au Museum of Modern Art de New York, elle était intitulée « Airways to Peace ». Son but était de montrer les facteurs au fondement de la géographie de l’« ère aérienne » (air-age geography) et en quoi la compréhension de ceux-ci était indispensable à la victoire. Le texte de l’exposition fut rédigé par Wendell Willkie et le conseiller cartographique était Richard E. Harrison. Parmi les cartes, photographies et autres objets exposés, on trouvait le fameux « globe du Président », qui avait été momentanément prêté.
Vue des États-Unis, la Seconde Guerre mondiale a été globale et ne pouvait se comprendre que grâce à une nouvelle cartographie, globale.
1) Ce rétrécissement du monde est pourtant d’abord analysé comme étant le résultat du développement de l’aviation, ce que montre bien une vidéo éducative de 1946, Our Shrinking World. La guerre mondiale n’est que la conséquence de la globalization, non la cause.
2) Cette nouvelle cartographie a directement inspiré le drapeau dessiné pour l’Onu à partir du badge créé pour la conférence de San Francisco (Capdepuy, 2011a). Mais cette influence s’est rapidement dissipée. Le poids des traditions l’a emporté.
3) Toutefois, la vision globale développée aux États-Unis durant la guerre a perduré après 1945. Elle a été au fondement de la guerre froide, qui a été une guerre pour le globe.
Bibliographie
Capdepuy V., 2011a, « Le Monde de l’Onu. Réflexions sur une carte-drapeau », M@ppemonde, n° 102.
Capdepuy V., 2011b, « Au prisme des mots. La mondialisation et l’argument philologique », Cybergeo, document 576.
Crozet R., 1925, « L’aviation marchande », Annales de géographie, vol. 34, n° 187, pp. 1-12.
Deffontaines P., 1939, « Nouvelles visions de la terre par l’avion », La Revue des deux-mondes, vol. 109, pp. 430-439.
Engelhardt N.L., 1943, Toward New Frontiers of Our Global World, New York, Noble and Noble.
Hankins G.C., 1944, Our Global World: A Brief Geography for the Air Age, New York, The Gregg Publishing Company.
Harrison R.E., 1944, Look to the World: The Fortune Atlas for World Strategy, New York, Alfred A. Knof.
Lodge J.E., 1936, « Now You Can Fly Around the World », Popular Science Monthly, vol. 128, n° 6, pp. 34-36 + p. 119.
Packard L.O, Overton B., Wood B.D., 1944, Our Air-Age World: A Textbook in Global Geography, New York, The Macmillan Company.
Raisz E., 1944, Atlas of the Global Geography, New York, Global Press Corporation.
Willkie W.L., 1943, One World, New York, Simon and Schuster.
[1] Wendell L. Willkie, One World, New York, 1943, p. 1.
[2] Wendell L. Willkie, op. cit., p. 2.
[3] Wendell L. Willkie, op. cit., p. ix.
[4] Wendell L. Willkie, op. cit., p. 203.
[5] René Crozet, « L’aviation marchande », Annales de géographie, volume 34, n° 187, p. 1.
[6] John E. Lodge, 1936, « Now You Can Fly Around the World », Popular Science Monthly, vol. 128, n° 6, p. 119.