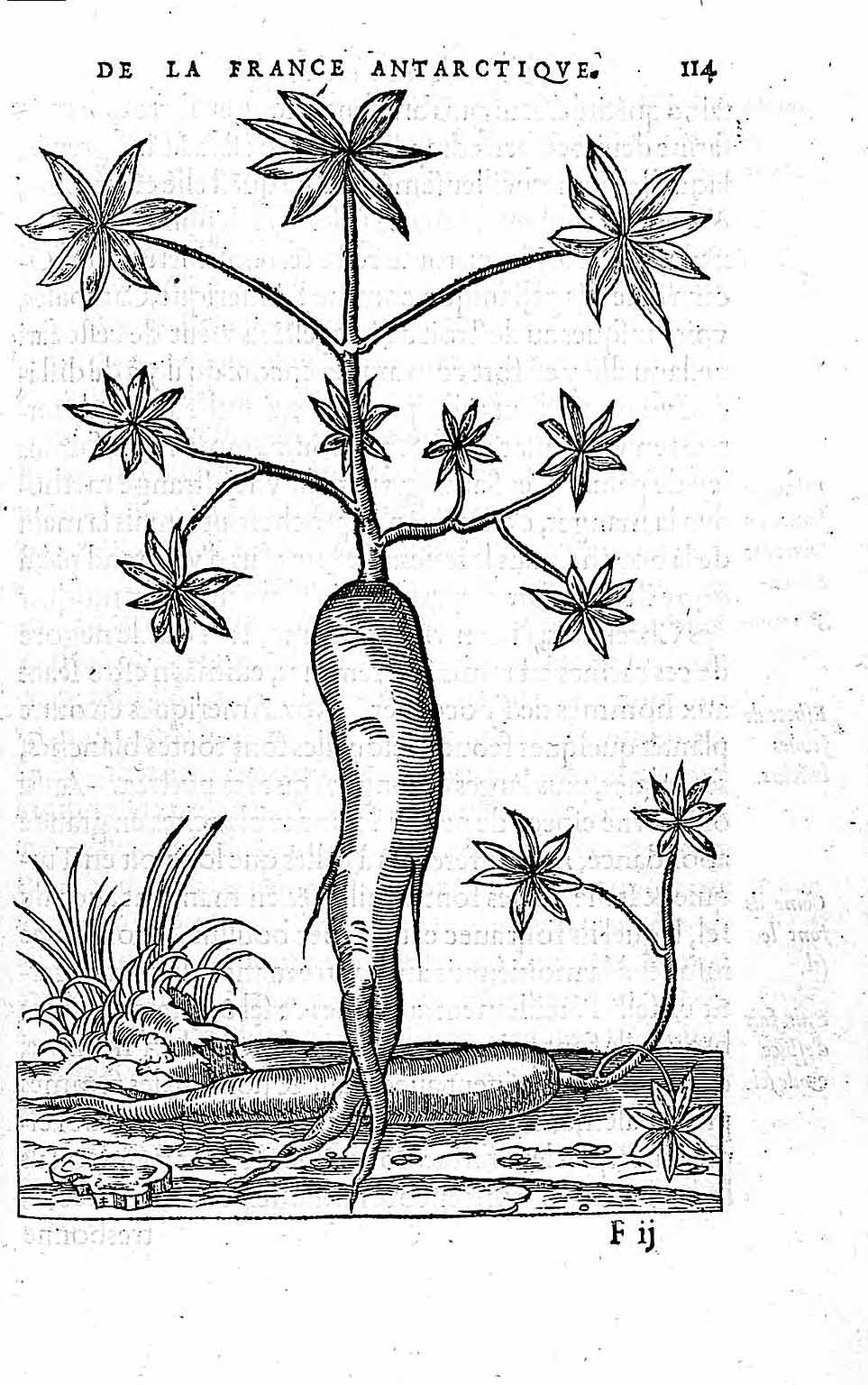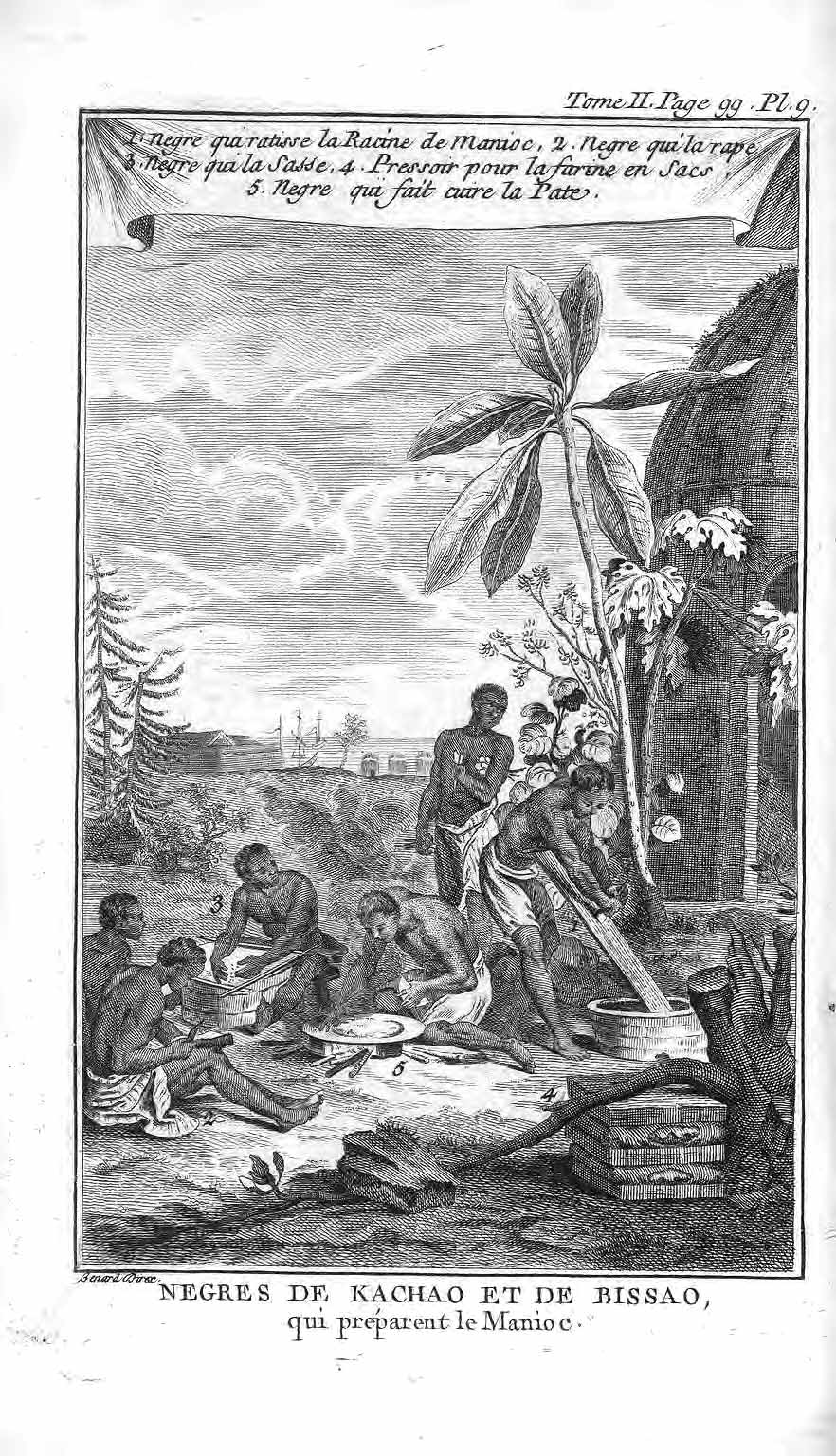Afin de poursuivre sur la notion d’hégémonie abordée dans les quatre billets précédents, je voudrais attirer l’attention sur un article du géographe anarchiste Élisée Reclus, paru en 1894 dans La Société nouvelle, et intitulé « L’hégémonie de l’Europe ». Dans le cadre d’un article consacré à la Nouvelle géographie universelle du même auteur, Federico Ferretti s’est interrogé sur la posture de l’auteur dans le contexte colonial de son époque. Mon approche sera quelque peu différente.
Je retiendrai trois points.
1) Pour Élisée Reclus, cette hégémonie de l’Europe consiste dans une domination directe et indirecte du monde.
« Après l’Australie, l’Europe est la plus petite parmi les parties du monde, mais si elle constitue un ensemble de terres émergées bien moindre que l’Asie, l’Afrique ou les deux continents américains, elle ne le cède qu’à la seule Asie par le nombre de ses habitants, et sa population, beaucoup plus dense, est animée d’une vie autrement active et d’un plus rapide élan de civilisation.
Trois cent soixante-dix millions d’hommes, soit environ le quart de la race humaine, telle est la part des Européens, mais ils possèdent beaucoup plus de la moitié des richesses du monde, et dans les autres continents c’est d’eux que vient la poussée d’initiative. L’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud appartiennent à des colons de leur race, de même que l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Ils se partagent l’Afrique et l’Océanie par le droit du plus fort : la plus puissante des nations européennes, l’Angleterre, a pris possession de la merveilleuse péninsule Gangétique, où vivent près de trois cents millions d’hommes entre l’océan des Indes et l’Himalaya. L’Indo-Chine est aussi plus qu’à moitié conquise par les Européens, et les nations de l’Extrême-Orient, Chine, Corée, Japon, subissent de plus en plus l’influence de ces “barbares de l’Occident” ; de ces “démons aux cheveux rouges” qu’elles méprisaient naguère. Même le Japon a poussé l’esprit d’imitation jusqu’à l’absurde en essayant de s’européaniser par les institutions politiques, le costume et les mœurs. Du moins a-t-il bien fait de se mettre à l’école des Européens pour apprendre les sciences et suivre la méthode rigoureuse d’observation et d’expérience, sans laquelle l’humanité ne procède qu’au hasard et comme en rêve.
Quelle est la raison de cette hégémonie de l’Europe ? » [1]
Le constat reste cependant assez banal et fait écho à celui de Conrad Malte-Brun au début du siècle :
« Tel est néanmoins le pouvoir de l’esprit humain. Cette région que la nature n’avait ornée que de forêts immenses, s’est peuplée de nations puissantes, s’est couverte de cités magnifiques, s’est enrichie du butin des deux mondes ; cette étroite presqu’île, qui ne figure sur le globe que comme un appendice à l’Asie, est devenue la métropole du genre humain et la législatrice de ce vaste univers. L’Europe est partout ; un continent entier n’est peuplé que de nos colons ; la moitié de nos armées suffirait pour conquérir la faible Asie et la féroce Afrique. Nos pavillons couvrent l’Océan, et tandis que l’industrieux Chinois n’ose dépasser les bornes des mers qui l’ont vu naître, nos hardis navigateurs suivent d’un pôle à l’autre les routes que leur traça dans son cabinet un de nos géographes. » [2]
Toutefois, de l’un à l’autre, l’hégémonie de l’Europe s’est renforcée par la colonisation de la seconde moitié du 19e siècle.
Mais ce n’est pas le seul biais de cette hégémonie européenne et un terme mérite d’être souligné : « européaniser ». Même si une étude resterait à faire, il appert que Reclus utilise une notion assez récente en français et qui remonterait au milieu du 19e siècle. Le nom même d’« européanisation » est encore plus tardif puis qu’il semble apparaître au milieu des années 1880, sans doute sous l’influence de la langue anglaise où le terme d’« europeanization » est usité depuis les années 1850. L’exemple du Japon auquel se réfère Reclus n’est d’ailleurs pas anodin. La notion d’européanisation est souvent associé à ce pays qui exerce une réelle fascination à cette époque pour un pays qui échappe à la conquête européenne, mais imite, intègre la culture européenne.
2) Mais l’européanisation, pour Reclus, doit aboutir à une égalisation du monde.
« C’est que les mouvements de la civilisation ne se propagent plus maintenant sur une seule ou sur quelques lignes de moindre résistance, mais se répercutent d’une extrémité du monde à l’autre, comme les ondulations qui frémissent à la surface d’un étang et vont se réfléchir sur le rivage. À chaque période de civilisation, le foyer d’irradiation complète se faisait plus vaste. Dans sa plus grande expansion, le monde grec embrassa non seulement toute la Méditerranée orientale, mais tout le bassin de la mer intérieure avec l’Égypte, l’Asie Mineure et même les approches de l’Inde. Rome fut le centre d’un monde beaucoup plus étendu, limité au sud par les solitudes du désert, au nord par les forêts de l’Hercynie. Beaucoup plus considérable encore fut le monde que l’on pourrait appeler celui des communes libres et qui était représenté dans l’Europe entière par les mille communes indépendantes et d’ardente initiative constituées en petites républiques guerroyantes ou fédérées, celles de l’Italie et de l’Espagne, de la France et des Pays-Bas, de l’Allemagne et même de la Russie, jusqu’à la grande Novgorod. Par leur trafic et leur mouvement de civilisation, elles propageaient leur puissance dans la Mongolie, en Chine, le pays de la Soie, dans l’Insulinde, l’archipel des Épices, l’Afrique ou pays de l’Ivoire. Et maintenant le foyer de l’Europe n’illumine-t-il pas le monde et n’a-t-il pas créé d’autres Europes sur la superficie de la terre entière, dans l’Amérique du Nord et du Sud, en Australie, dans l’Inde, au cap de Bonne-Espérance ? Ainsi, de progrès en progrès, la civilisation européenne en est arrivée à la négation de son point de départ. Elle visait à la domination, à la prépondérance, et par ses conquêtes mêmes elle constitue l’égalité. Le monde entier s’européanise : on peut même dire qu’il est européanisé déjà.
Il ne saurait donc plus être question d’une lente translation du foyer de lumière dans le sens de l’orient à l’occident, suivant la marche du soleil autour de la Terre. C’est là un phénomène qui fut relativement vrai dans le passé, mais qui n’a plus de réalité dans le présent. Les navires qui partent de la “Nouvelle Carthage” pour cingler vers d’autres Nouvelle Carthage, New York ou Sans-Francisco, Bombay, Madras ou Singapour, Hong-Kong, Sidney ou Valparaiso, passent à l’ouest par le détroit de Magellan ou bien à l’est autour du cap des Tempêtes. Les lignes de circumlocomotion, par mer ou par terre, se dirigent dans tous les sens : à l’ouest, à l’est, au nord, au midi. Non seulement le mouvement d’égalisation entre l’Europe et les autres parties du monde se fait par la fondation de colonies nouvelles, par le peuplement de régions désertes ou le croisement de race avec les indignes, mais il restaure les contrées déchues, leur inspire un nouveau souffle de vie, les rattache au monde de la civilisation dont elles étaient séparées. C’est ainsi que, grâce à l’Occident, la Grèce a pu se reconstituer et qu’elle a cessé d’être une terre de ruines pour se couvrir de cités nouvelles ; de même les pays où nous cherchons les origines première de notre civilisation, l’Égypte, ou la Chaldée, l’Inde surtout, sont désormais partie intégrante du monde moderne. La fille a retrouvé sa mère. Les savants ont eu le bonheur de remonter à la source de nos langues, à celle des religions qui, sous diverses modifications, s’étaient répandues en Europe, passant par la Judée, par la Grèce et par Rome. C’est à Ceylan, dans les montages du Tibet, que les affamés de mysticisme religieux vont se nourrir de la parole bouddhique, dont les Occidentaux n’avaient autrefois entendu que les lointains échos, presque étouffés par la distance. » [3]
La mondialisation introduit donc une rupture dans l’histoire de « la civilisation mondiale », de « l’humanité consciente », pour reprendre des expressions d’Élisée Reclus. Alors que pendant des millénaires, celle-ci a toujours suivi une ligne, une « marche en diagonale à travers le continent » européen [4], « maintenant, c’est le monde entier qui devient le théâtre de l’activité des peuples civilisés : la Terre est désormais sans limites, puisque le centre en est partout sur la surface planétaire et la circonférence nulle part. » [5]
La formule employée mérite explication. Elle est sans doute directement empruntée à Pascal :
« Tout ce que nous voyons du monde n’est qu’un trait imperceptible dans l’ample sein de la nature. Nulle idée n’approche de l’étendue de ses espaces. Nous avons beau enfler nos conceptions, nous n’enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses. C’est une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Enfin, c’est un des plus grands caractères sensibles de la toute-puissance de Dieu, que notre imagination se perde dans cette pensée. » [6]
Mais son origine est en fait plus ancienne puisque qu’elle provient d’un ouvrage qui daterait du 4e siècle et qui serait réapparu au 12e, le Liber viginti quattuor philosophorum, le Livre des vingt-quatre philosophes, où Maître Eckart, Nicolas de Cues, Giordano Bruno puis Blaise Pascal purent lire, parmi vingt-quatre définitions de Dieu, celle-ci :
« 2. Deus est sphaera infinita cuius centrum est ubique, circumferentia nusquam.
Dieu est une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part. »
Dans sa description de la mondialisation à venir, Reclus sécularise ainsi une vieille formule mystique qui lui permet d’exprimer le décentrement du monde moderne par la négation même du centre. De toute évidence, la géohistoire reclusienne appartient aux utopies planétaires. Reclus développe une vision eschatologique d’une mondialisation qui doit étendre le progrès au monde entier et abolir les inégalités.
3) Cependant, dans cette égalisation du monde, conséquence de son européanisation, une inquiétude sourd : quelle place aura l’Europe lorsque l’Europe sera partout ?
« Cette annexion de l’Orient à l’Occident dans le monde de la civilisation moderne effraie nombre d’historiens et d’économistes, qui se demandent si dans ces conditions nouvelles, l’homme civilisé d’Europe, enseignant ses sciences et ses industries, ne se condamne pas à une déchéance inévitable ou même à l’extermination dans la bataille de la vie.
Des usines s’élèvent dans l’Inde, aux Antilles, au Mexique, au Brésil, à côté des lieux de production, et les jaunes, les noirs, les gens de toute race commencent à travailler à la place des blancs, même à diriger les industries, sans que les travaux aient à souffrir de la différence de la main-d’œuvre, payée seulement à des prix inférieurs. Les esprits chagrins ou timorés en ont conclu que le jour viendrait bientôt où les Européens et leur descendance, incapables de lutter dans le grand drame de la concurrence vitale, seraient promptement écartés de la lutte et voués à la mort par l’intervention disciplinée des Chinois, des Hindous, même des Cafres, comme à Natal et dans le pays des Bechuana. Certainement les débouchés que cherchaient les industriels de notre Europe manufacturière leur manqueront successivement, et les ingénieurs que l’on fabrique à coups de diplômes pour l’exportation ne trouveront plus à s’employer chez tous ces peuples lointains dits “inférieurs”. Ce sont là des événements d’une gravité capitale qui nous pronostiquent toute une révolution économique, et à laquelle nous devons nous préparer, mais sans anxiété et surtout sans faiblesse. Ayons l’audace et l’intelligence d’aborder sur place tous les problèmes sociaux qui nous assiègent, d’utiliser toutes les ressources que nous avons dans chacune de nos contrées occidentales. Nous prétendons qu’elles sont largement suffisantes pour donner à tous les habitants le travail et le bien-être, même dans les contrées, comme l’Angleterre et la Belgique, obligées d’importer annuellement une partie de leur pain.
Mais pour cela il faut changer de régime et ne plus se fier aveuglement à la concurrence forcenée, à l’esprit de spéculation et d’accaparement, orienter toute notre politique vers une ère de solidarité, de compréhension commune et de bon vouloir entre les hommes. Les événements prouvent avec toute évidence qu’un immense travail d’égalisation s’accomplit à la surface de la planète. » [7]
Cependant, en des termes assez mystiques, Reclus termine sur l’idée que l’Europe pourrait continuer à montrer la voie au monde.
« Nous pouvons reprendre ici l’ancienne comparaison de la Bible qui nous montre la vérité s’élevant sans cesse comme une marée et recouvrant la terre entière ainsi que les eaux d’un océan. Nous progressons toujours, et bien que l’ère de la civilisation européenne ait commencé pour le Nouveau Monde, elle ne s’est point achevée pour l’Ancien.
L’heure de la mort n’a pas sonné pour nous et notre force n’est point épuisée. Nous nous sentons encore jeunes, emmagasinant sans cesse, pour une vie plus intense, plus de chaleur solaire. » [8]
Lorsqu’il écrit ce texte, en 1894, Élisée Reclus pressent le retournement de l’hégémonie européenne et l’émergence de nouvelles puissances. On ne peut évidemment que penser à l’ouvrage d’Albert Demangeon paru après la Première Guerre mondiale, qui s’ouvre sur cette interrogation :
« Déjà la fin du dix-neuvième siècle nous avait révélé la vitalité et la puissance de certaines nations extra-européennes, les unes comme les États-Unis nourries du sang même de l’Europe, les autres, comme le Japon, formées par ses modèles et ses conseils. En précipitant l’essor de ces nouveaux venus, en provoquant l’appauvrissement des vertus productrices de l’Europe, en créant ainsi un profond déséquilibre entre eux et nous, la guerre n’a-t-elle pas ouvert pour notre continent une crise d’hégémonie et d’expansion ? » [9]
Et qui se termine sur cette même idée d’une pérennité de l’Europe :
« Est-ce à dire que l’Europe ait fini son règne ? Est-ce à dire que, suivant l’originale expression de M. P. Valéry, elle “deviendra ce qu’elle est en réalité, c’est-à-dire un petit cap du continent asiatique” ? Pour cela, il faudrait qu’elle fût réduite à ne plus compter que proportionnellement à sa superficie. Or, l’espace n’est pas la mesure de la grandeur des peuples. Cette grandeur se fonde encore sur le nombre des hommes, sur leur état de civilisation, sur leur progrès mental, sur leurs aptitudes à dominer la nature ; il s’agit ici plutôt de valeur que de grandeur. C’est pourquoi l’on peut dire que, si l’Europe n’occupe plus le même rang dans l’échelle des grandeurs, elle doit à sa forte originalité de conserver une place toute personnelle dans l’échelle des valeurs. » [10]
Bibliographie
Le livre des vingt-quatre philosophes : Résurgence d’un texte du IVe siècle, éd. par F. Hudry, Paris, Vrin, 2009.
Demangeon A., 1920, Le déclin de l’Europe, Paris, Payot.
Ferretti F., 2010, « L’egemonia dell’Europa nella Nouvelle géographie universelle (1876-1894) di Élisée Reclus : una geografia anticoloniale ? », Rivista Geografica Italiana, vol. 117, pp. 65-92.
Malte-Brun C. & Mentelle E., 1803, Géographie mathématique, physique et politique de toutes les parties du monde, vol. 2, Paris, chez H. Tardieu / Laporte.
Mattelart A., 2009, Histoire de l’utopie planétaire. De la cité prophétique à la société globale, Paris, La Découverte (1ère éd. 1999, augmentée).
Reclus É., 1894, « Hégémonie de l’Europe », La Société nouvelle, pp. 433-443.
Sloterdikj P., 2010, Globes. Macrosphérologie. Sphères II, trad. de l’allemand, Paris, Méta-Éditions (éd. originale 1999).
Notes
[1] Élisée Reclus, 1894, « Hégémonie de l’Europe », La Société nouvelle, p. 433.
[2] Conrad Malte-Brun, 1803, Géographie mathématique, physique et politique de toutes les parties du monde, Paris, chez H. Tardieu / Laporte, Volume 2, pp. III-IV.
[3] Élisée Reclus, 1894, « Hégémonie de l’Europe », La Société nouvelle, pp. 441-442.
[4] Élisée Reclus, ibid., pp. 438.
[5] Élisée Reclus, 1889, Nouvelle géographie universelle. L’Homme et la Terre, vol. 14, Océan et terres océaniques, Paris, Hachette, p. 6.
[6] Blaise Pascal, Pensées, texte de l’éd. Brunschwicg, 1951, Paris, Garnier Frères, Pensée 72.
[7] Élisée Reclus, 1894, « Hégémonie de l’Europe », La Société nouvelle, p. 442.
[8] Élisée Reclus, ibid., p. 443.
[9] Albert Demangeon, 1920, Le déclin de l’Europe, Paris, Payot, p. 15.
[10] Albert Demangeon, ibid., pp. 313-314.