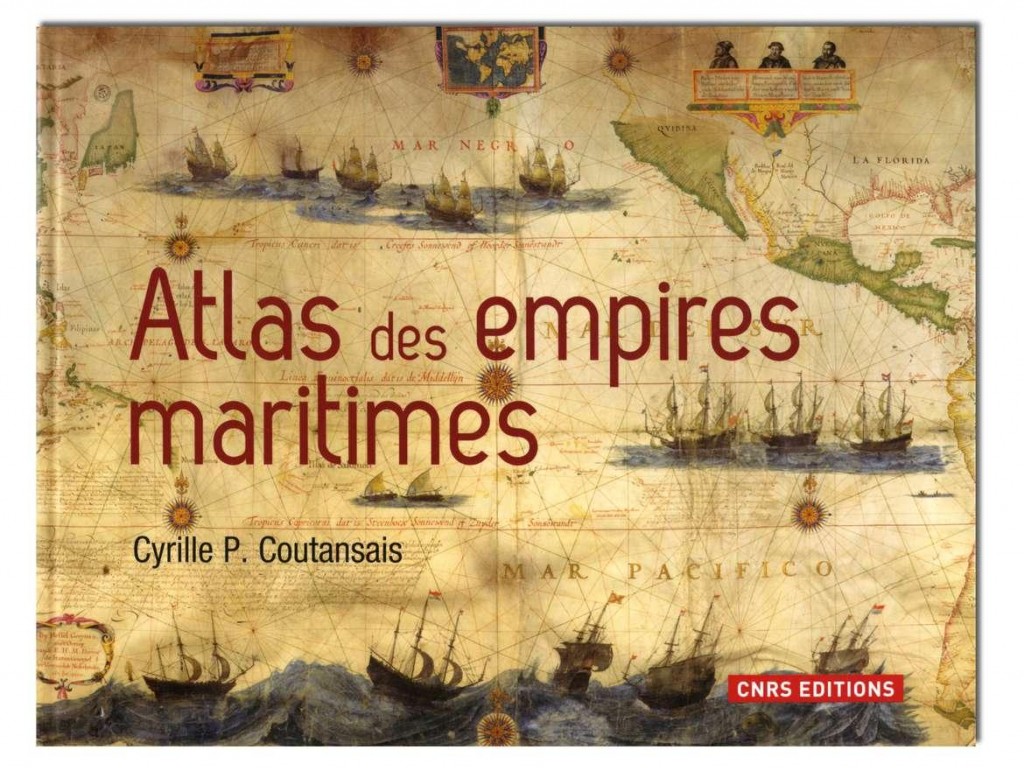Avec ce texte nous abordons le second volet d’une trilogie consacrée au concept d’hégémonie en histoire globale, et dont le premier texte a été publié la semaine dernière.
Comment passe-t-on d’une puissance hégémonique à une autre lors du déclin d’un système-monde ? Reprenant des remarques de Braudel, Arrighi [1994] observe d’abord que le système-monde moderne a clairement connu plusieurs phases d’une certaine « expansion financière », phases caractérisées par une importance accrue, accordée par les acteurs économiques, au capital financier par opposition au capital commercial ou au capital productif. Ainsi la « globalisation financière » actuelle, avec la recherche de retours sur investissement d’abord dans la sphère financière (recherche caractérisée notamment par la recherche institutionnalisée de gains spéculatifs en capital à court terme), serait proche de la période du « capital financier », à la fin du 19ème siècle, laquelle voyait les banques prendre le contrôle des entreprises productives et allait déboucher sur l’impérialisme et la recherche d’une valorisation à l’extérieur des pays dominants. Mais la parenté serait tout aussi étroite avec la période de retrait des Hollandais du grand commerce, autour de 1740, dans le but de devenir les banquiers de l’Europe. Cette parenté serait encore tout aussi évidente avec la diminution des activités commerciales des Génois, à partir de 1560, pour se consacrer eux aussi à une pure activité bancaire. Autrement dit, les phases d’expansion financière se répèteraient, à intervalles du reste de plus en plus courts, dans le système-monde moderne. Elles succèderaient à chaque fois à des phases d’expansion matérielle qui finiraient par s’épuiser…
Arrighi propose de théoriser ce mouvement en faisant référence au schéma de reproduction du capital proposé par Marx. Pour ce dernier, le mouvement même du capital se résumerait à la forme A-M-A’, dans laquelle un capital argent initial A, signifiant d’abord liquidité et donc liberté d’utilisation, choisirait de s’investir dans une combinaison productive, plus rigide, mais permettant de fabriquer une marchandise donnée M qui, une fois valorisée sur le marché, redonnerait un capital A’, en principe plus important et de nouveau libre d’être réinvesti. C’est évidemment en achetant, dans la combinaison productive, la force de travail, marchandise qui présente la particularité d’avoir une valeur moindre que celle que le travail crée (le prolétaire reçoit en salaire une somme qui lui permet d’acheter, pour sa subsistance, moins de travail d’autrui qu’il n’en a lui-même fourni) que l’augmentation, entre A et A’, est possible. Ce schéma fondamental de Marx donnait, très synthétiquement, la signification du rapport de production capitaliste et caractérisait à la fois la logique de tout investissement capitaliste particulier et celle du mode de production tout entier. Arrighi l’utilise ici, à vrai dire indûment, pour marquer que l’expansion matérielle coïncide résolument avec la phase A-M, tandis que l’expansion financière serait un retour généralisé de M vers A’. Ce n’est là pourtant qu’une allégorie « pédagogique », Marx ne voulant pas marquer, dans ce schéma, une succession de phases mais un mouvement logique permanent. Tout au plus peut-on dire que la phase d’expansion matérielle voit un réel enthousiasme des producteurs à transformer leur capital en combinaisons productives, la phase financière marquant une réticence à cette transformation et la recherche de gains spéculatifs dans le seul achat de titres.
Mais « ces périodes d’expansion financière ne seraient pas seulement l’expression de processus cycliques, propres au capitalisme historique, elles seraient également des périodes de réorganisation majeure du système-monde capitaliste – ce que nous appelons des transitions hégémoniques » [Arrighi et Silver, 2001, p.258]. Autrement dit, ces périodes où la finance prend une importance particulière témoigneraient d’une faiblesse toute nouvelle de la puissance hégémonique ancienne et annonceraient son prochain remplacement. Elles constitueraient le moment de repli, dans chaque cycle d’accumulation mené par un complexe spécifique d’organisations gouvernementales et privées, lequel conduirait le système capitaliste mondial, d’abord vers l’expansion productive, puis vers l’expansion financière, les deux moments constituant le cycle. Elles annonceraient l’imminence relative d’un tournant dans le « régime d’accumulation à l’échelle mondiale », à savoir le remplacement progressif d’un complexe d’organisations gouvernementales et privées par un autre.
Pourquoi passerait-on inéluctablement d’une phase d’expansion matérielle à une phase plus financière ? Arrighi invoque une baisse de rentabilité des fonds investis dans la production sans véritablement s’en expliquer, reprenant ainsi à son compte la thèse marxiste de la baisse tendancielle du taux de profit, dont il a pourtant été démontré qu’elle n’avait rien d’inéluctable. En admettant cette explication, comment comprendre alors qu’un taux de profit plus élevé puisse être réalisé dans la sphère financière de l’économie, apparemment indépendamment de la production, désormais négligée ? A la suite de Pollin [1996], Arrighi suggère trois possibilités : une lutte entre les capitalistes qui se redistribueraient un profit désormais limité ou freiné dans sa croissance ; la capacité de la classe capitaliste, à travers les marchés financiers, à procéder à une redistribution du revenu en sa faveur et au détriment des autres classes ; la possibilité que les fonds soient transférés hors des lieux et secteurs les moins profitables pour être investis dans de nouveaux secteurs ou des économies en forte croissance. La première est évidemment limitée dans le temps mais, en créant un jeu à somme négative, cette concurrence féroce diminuerait encore les taux de rentabilité, précipitant un abandon, par les capitalistes, de la sphère productive et augmentant les fonds disponibles pour la sphère financière. La seconde forme verrait le jour lorsque la demande de fonds correspondrait à l’offre : c’est pour Arrighi la montée des dettes publiques, consécutive au ralentissement de la croissance, qui obligerait les Etats à se concurrencer pour obtenir les capitaux existants. Dans l’opération, les organisations contrôlant la mobilité de ces capitaux se trouveraient en position de force et verraient leur part du revenu augmenter, ce qui est véritablement d’actualité avec la crise grecque. Quant à la troisième possibilité, Arrighi montre qu’elle n’est qu’apparemment financière dans la mesure où elle signifie déjà que l’on passe à un autre cycle d’accumulation, basé sur un investissement productif et rentable en d’autres lieux et dans d’autres activités… Cela dit, le financement par les Vénitiens, au 16ème siècle, des investissements hollandais, celui par les Hollandais, au 18ème siècle, de l’expansion britannique, et enfin le soutien britannique aux Etats-Unis, à la fin du 19ème siècle, sont bien au cœur du sujet et marquent, à travers cette troisième forme de réalisation d’un profit, à la fois l’expansion financière et l’inéluctabilité du changement d’hégémon…
Sur ces bases, Arrighi et Silver [2001, p.265] développent une stimulante typologie des cycles d’accumulation en montrant que, des Génois du 16ème siècle aux Etats-Unis du 20ème, en passant par les Provinces-Unies du 17ème et la Grande-Bretagne du 19ème, les hégémonies se succèdent et se ressemblent mais aussi se complexifient. Par exemple, les Génois sont incapables d’assurer vraiment leur protection militaire face aux armées de l’époque, qu’elles soient turques, espagnoles ou même vénitiennes, et doivent acheter celle-ci aux Habsbourg. En revanche, les Provinces-Unies qui leur succèdent développent une force suffisante pour résister victorieusement au Saint-Empire. Mais il leur manque aussi, selon Arrighi et Silver, une capacité suffisante de production qui explique qu’ils aient, pour l’essentiel, commercialisé les produits d’autres peuples. Cet autre élément n’allait pas faire défaut à leurs successeurs, les Britanniques, pourvus à la fois d’une forte armée et d’une capacité productive inédite suite à la révolution industrielle… Continuant ce raisonnement, que manquait-il aux Britanniques ? Essentiellement un marché intérieur suffisant ! Ce dernier élément, leur successeur américain allait évidemment en disposer, ajoutant à la puissance militaire et à la capacité productive une sécurisation relative de ses débouchés. Autrement dit, on l’a compris, chaque hégémon aurait définitivement quelque chose de plus que son prédécesseur, gage évident de son succès.
Une autre évolution, non plus vers l’accroissement des « qualités » de l’hégémon, comme nous venons de le voir, mais un mouvement de balancement, affecterait les hégémons successifs. En clair, si Gênes, comme la Grande-Bretagne, étendent l’espace géographique des échanges, déploient une stratégie en ce sens extensive, Provinces-Unies et Etats-Unis adoptent une attitude plus intensive, occupant les espaces ainsi dégagés par leurs prédécesseurs et tentant d’en rationaliser l’usage. Ces stratégies, extensive et intensive, sont respectivement associées à des structures organisationnelles dites « cosmopolites-impériales » (Gênes et Grande-Bretagne) et « nationales-entrepreneuriales » (Provinces-Unies et Etats-Unis). Les premières étendent l’envergure du système-monde, les secondes le rendent plus fonctionnel. Par ailleurs, plus les hégémons se renforcent, plus leur durée de vie apparaît faible, ce que les auteurs interprètent comme l’expression d’une contradiction majeure du capitalisme mondial.
Au-delà de cette caractérisation des hégémons, Arrighi et Silver montrent comment l’expansion financière, à la fois restaure provisoirement les forces de l’hégémon sur le déclin, tout en renforçant directement les contradictions qui le minent et sont vouées à l’emporter. Pour eux, l’hégémon déclinant, ou plutôt le complexe des organisations gouvernementales et privées qui en dépend, va utiliser sa position éminente pour capter les capitaux mobiles, plus nombreux du fait de la baisse de rentabilité des activités productives, et les recycler vers les activités et les lieux plus rémunérateurs. Il est clair qu’une telle intermédiation est de nature à rehausser le niveau des taux de profit dans l’économie hégémonique, du fait de l’importance nouvelle prise par ces activités financières, tout en dynamisant directement ses concurrentes éventuelles. A terme, le changement d’hégémon serait inéluctable, même si les bases de cette nouvelle prééminence sont tout aussi politiques qu’économiques [Arrighi, 1994, p.36-84].
Dans le troisième volet de cette trilogie, la semaine prochaine, nous nous efforcerons de concrétiser cette théorisation dont le repérage historique est assez clair et l’actualité tout à fait évidente…
ARRIGHI G. [1994], The Long Twentieth Century, Money, Power and the Origins of our Times, London, Verso.
ARRIGHI G., SILVER B. [2001], “Capitalism and World (dis]Order”, Review of International Studies, n°27, p.257-279. Traduction française in Beaujard, Berger, Norel [eds].
BEAUJARD Ph., BERGER L., NOREL Ph. [2009], Histoire globale, mondialisations, capitalisme, Paris, La Découverte.