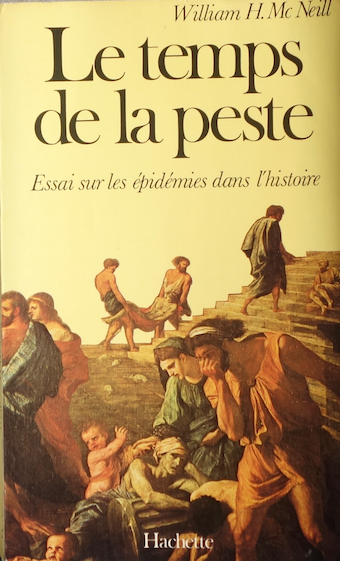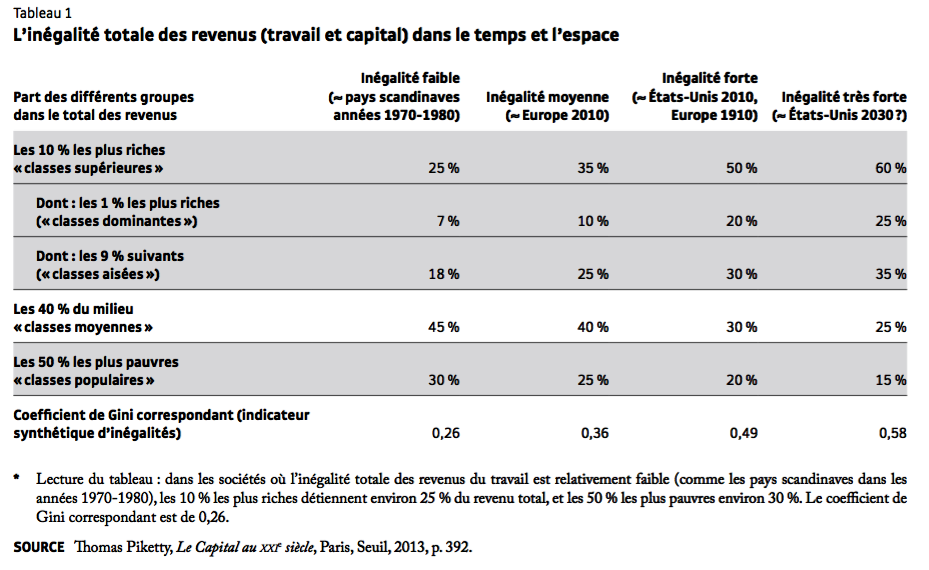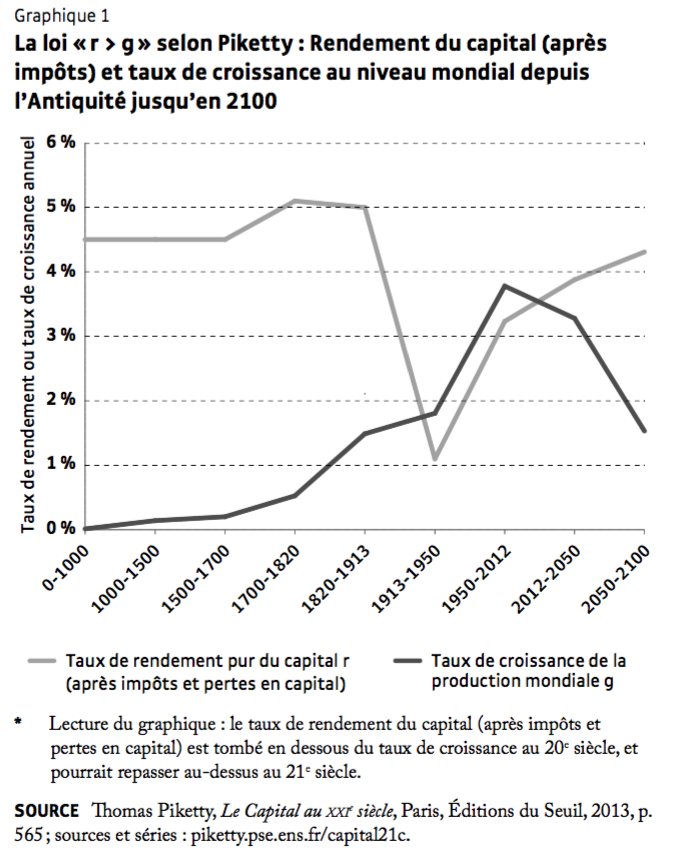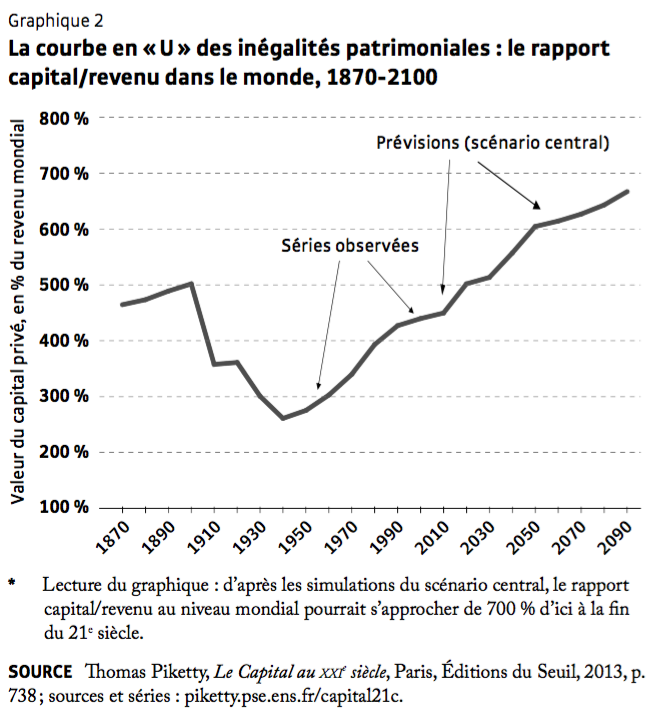Sébastien Lecompte-Ducharme
Étudiant au doctorat en histoire, Université du Québec à Montréal
À propos de :
Marcus Rediker et Peter Linebaugh, L’Hydre aux mille têtes. L’histoire cachée de l’Atlantique révolutionnaire, 2000, trad. fr. Christophe Jaquet et Hélène Quiniou, Amsterdam Éditions, 2008.
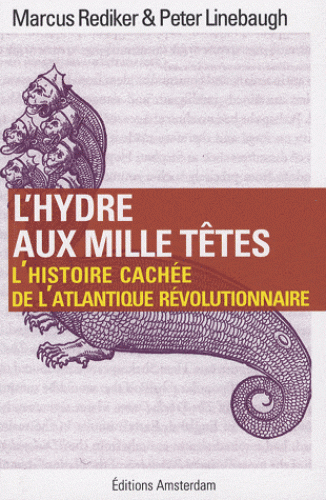
Histoire atlantique et histoire globale, même combat ? Dans L’Hydre aux mille têtes, Marcus Rediker et Peter Linebaugh décrivent l’émergence du capitalisme à l’échelle atlantique, et sont amenés à ouvrir la porte de l’histoire mondiale. Dans cet ouvrage, ils veulent en effet montrer que les marins, les esclaves et les commoners (synthétisés par l’expression « équipage bigarré », motley crew), par leur résistance et par leur mobilité atlantique forcée, développent un projet social égalitaire et libertaire. Néanmoins, ils participent pleinement, mais malgré eux, à l’émergence du capitalisme entre le 17e et le 19e siècles (pp. 17 et 28). Surtout, ils mettent en place leurs propres réseaux atlantiques, à l’intérieur des réseaux capitalistes ultramarins. Les auteurs défendent également l’idée que la répression des mouvements libertaires et égalitaires naît de la peur de ces mêmes mouvements par l’élite (pp. 16-17). Enfin, ce qui donne une dimension résolument atlantique à l’ouvrage, outre la circulation des idées et des personnes, est la thèse du travail et des solidarités multiethniques et multiraciales.
L’Hydre aux mille têtes a d’abord paru en 2000 chez Beacon Press, un éditeur d’essais membre de l’Association of American University Presses et lié à l’unitarisme universel, un groupe spirituel syncrétique de tendance progressiste. Ce parcours illustre bien les aspects académiques et militants de L’Hydre aux mille têtes, qui a par ailleurs reçu le Labor History Book Prize, pour le meilleur livre en histoire du travail publié en l’an 2000. L’ouvrage a été traduit en espagnol, en allemand, en portugais, en coréen et en français (1). Linebaugh (2) et Rediker (3) sont tous deux des historiens états-uniens, marxistes et militants. Proches de la New Left, ils partagent leur écriture entre revues universitaires et périodiques activistes.
Les deux historiens ont également des bagages différents, mais complémentaires. Rediker, auteur de quelques livres, tous traduits en plusieurs langues, est l’artisan d’un documentaire sur la révolte servile du navire Amistad survenue en 1839. Surtout, ses intérêts de recherche tournent autour de l’époque coloniale états-unienne, du monde atlantique et de l’esclavage. Linebaugh, quant à lui, se spécialise en histoire britannique. Fait digne de mention, il a déjà enseigné à une clientèle carcérale. Posons l’hypothèse que cette expérience, manifestement liée à ses convictions sociales, a pu influencer sa perception de l’équipage bigarré. Soulignons enfin que la thèse de doctorat de Linebaugh a été dirigée par Edward P. Thompson à la Warwick University. La filiation intellectuelle est par ailleurs nettement apparente dans l’ouvrage à l’étude.
En effet, l’histoire par le bas, dont Thompson est l’un des auteurs marquants (4), se situe également dans une approche plus socioculturelle des classes laborieuses, comme elle l’était dans The Making of the English Working Class (5). Rediker et Linebaugh s’insurgent d’ailleurs de l’oubli de cette histoire du bas dans l’histoire du monde atlantique. Ils affirment que son aspect multiethnique a été occulté par la répression des mouvements populaires et par la primauté de l’histoire de l’État-nation (p. 17). Plus précisément, ils militent contre la perception des révoltes atlantiques comme phénomènes isolés (p. 291). Plus largement, ils veulent rendre compte d’un univers, multiethnique, maritime et fait de résistance et de solidarité. En ce sens, une seconde source d’inspiration est sans nul doute C.L.R. James, lui aussi marxiste et ouvert à une perspective atlantique (6). Il faut enfin souligner le renouveau, et la popularité, des études atlantiques depuis les années 1970 et surtout 1990 (7).
Le contexte de la fin du 20e siècle est certainement riche en pistes pour comprendre l’étude offerte par Rediker et Linebaugh. En cette ère post-Guerre froide, l’élite pilote plusieurs processus socioéconomiques et politiques : construction de nouveaux nationalismes en Europe de l’Est et Union européenne, dans lesquels les peuples ont peu de place. Dans la même veine, les auteurs peuvent avoir été influencés par les guerres « fratricides », notamment au sein de l’ex-Yougoslavie. En effet, la violence et le mépris à l’intérieur des classes laborieuses sont pour Rediker et Linebaugh un produit de l’élite capitaliste destiné à asseoir son pouvoir (pp. 423 426). Plus important est le statut hégémonique du capitalisme avec la chute de l’URSS. Contrairement à l’équipage bigarré de l’époque moderne qui pouvait trouver refuge ailleurs, les critiques du système au tournant du 20e siècle n’ont plus de territoire libre. Ce phénomène est certainement à lire en parallèle avec l’émergence de l’altermondialisme, critique d’une nouvelle vague de mondialisation. Ainsi, les auteurs terminent l’ouvrage sur cette réflexion contemporaine : « Pourtant les vagabonds de la planète n’oublient pas, et ils se tiennent toujours prêts, d’Afrique aux Caraïbes et à Seattle, pour organiser la résistance à l’esclavage et restaurer les communs » (p. 520). Assurément, Rediker et Linebaugh voient dans les mouvements de protestation anti-impériaux et anticapitalistes contemporains les héritiers de l’équipage bigarré. Voilà un bel exemple de dialogue entre le présent et le passé.
La démonstration des auteurs, on l’a vu, est construite autour du point de vue populaire. Comment alors donner la parole à des paysans, des marins et des esclaves, qui peut-on croire, sont pour beaucoup analphabètes ? Cette question soulève une critique importante : il n’y a ni chapitre ni section approfondissant les postures historiographiques, méthodologiques et théoriques des auteurs. Si David Armitage, lui aussi spécialiste des révoltes atlantiques, critique l’utilisation de sources provenant de l’élite (8), le problème réside davantage dans l’absence d’analyse de ces documents. En effet, dans la perspective d’une histoire des gens sans histoire, on ne peut pas honnêtement juger négativement le peu de sources provenant de groupes qui n’ont pu s’exprimer. Néanmoins, Rediker et Linebaugh se sont surtout concentrés sur des sources publiées, notamment des récits de voyage rédigés par l’élite. Les sources manuscrites, qui pourraient éventuellement être issues de l’équipage bigarré (correspondance, journaux de bord), si elles existent, sont-elles riches en information ? Disent-elles la même chose que les documents publiés ? Le chapitre sur l’abolitionniste Robert Wedderburn, notamment basé sur sa correspondance, semble répondre par l’affirmative, mais cela n’est pas si clair pour le reste de l’ouvrage. De plus, la plupart des textes publiés à partir du 17e siècle ont été réédités au cours du 20e siècle. Ce choix témoigne d’une volonté d’aller vers des documents plus accessibles, mais donne l’impression que les deux auteurs ont cherché des témoignages qui concordaient bien avec leurs thèses. Armitage n’a pas tort sur ce point (9).
Les textes d’époque ne constituent toutefois pas la principale source d’information. En effet, les études, essentiellement publiées entre les années 1950 et 1990 inclusivement, sont largement sollicitées. Elles servent à la fois à situer l’histoire du bas et l’histoire du monde atlantique, à contextualiser ou à brosser un portrait des événements. Même si les auteurs ne se positionnent pas dans cette historiographie, elle est relativement bien développée à propos de l’histoire de l’équipage bigarré. À cet égard, la critique des « oublis » mentionnée plus tôt semble adressée aux historiens de l’État-nation (p. 17). Ainsi, il faudrait voir L’Hydre aux mille têtes comme une synthèse articulée autour d’arguments revendicateurs.
Sur une note plus théorique et épistémologique, les auteurs pourraient bien s’intégrer au courant de l’histoire mondiale. En effet, la perspective atlantique sert bien une histoire des connexions et des réseaux, capitalistes ou libertaires. Ainsi, l’histoire par « en bas » apporte un élément original à l’histoire mondiale où l’agentivité prend généralement une place nettement moindre. L’analyse se situe aussi entre la prise en compte des grandes vagues, c’est-à-dire la montée du capitalisme, et les détails d’individus de l’équipage bigarré. De même, si la trame chronologique suit essentiellement les moments-clés de l’histoire traditionnelle par le haut (révolution anglaise, colonisation, révolution américaine, abolitionnisme), la perspective demeure celle du bas, notamment par la relation des événements liés à la contestation populaire. Par exemple, on étudie les mouvements de l’équipage bigarré en 1647 plutôt que la mise en place de la République anglaise en 1649. Dans la même veine, les « grands » personnages historiques, de Shakespeare à Thomas Paine, ne sont pas occultés, mais deviennent des figures du capitalisme et de la répression et des personnages secondaires du récit (10). Cela n’empêche pourtant pas Armitage de critiquer l’absence de l’élite, « menacingly nameless and faceless » selon lui. La place des femmes constitue un avantage de l’histoire du bas et les deux historiens ne les négligent pas : elles participent activement aux révoltes, tant en geste qu’en idées, et elles ont une identité propre, quoiqu’elles sont souvent les épouses d’autres révoltés ou des servantes. Enfin, l’analyse par le bas est, tout comme le maître Thompson, teintée du marxisme des auteurs (pp. 36-37). Ainsi, la montée du capitalisme est considérée sous l’angle de l’expropriation (p. 29). Cela conduit également Linebaugh et Rediker à voir le projet libertaire et égalitaire de l’équipage bigarré comme une lutte de classe plutôt qu’un combat pour le maintien de leur mode de vie. En outre, l’équipage bigarré est présenté comme étant en quelque sorte précurseur du communisme : « La rencontre de Winstanley et de Blackhouse aida le premier à formuler une réponse nouvelle et différente à la crise : il prôna la mise en commun des terres et des biens et devint un théoricien des communs » (pp. 211-212).
Construit autour des révoltes et des projets égalitaires et libertaires des commoners, des marins et des esclaves, l’ouvrage suit une trame chronologique qui part de la colonisation de la Virginie au début du 17e siècle jusqu’au mouvement abolitionniste britannique au 19e siècle. Commençant sur les côtes américaines, le récit s’attarde ensuite sur les mouvements anglais, tout en analysant les univers ultramarins que constituent l’esclavage et le travail maritime. Le monde atlantique est ainsi cerné.
Le chapitre 5, intitulé « L’hydrarchie : les marins, les pirates et l’État maritime » tient un rôle charnière. D’abord, le territoire abordé, l’océan, est résolument atlantique et donc propice à une histoire mondiale. Ensuite, il permet le passage à l’étude de la côte américaine de l’Atlantique, tant chez les esclaves des Caraïbes que chez les colons du continent. Ce mouvement aboutit à la Révolution américaine, d’abord menée par le bas et vue comme lançant les révolutions atlantiques. Enfin, retour dans l’Angleterre du 19e siècle où on constate la victoire des partisans de l’abolition de la traite des esclaves, quoique sous une forme plus capitaliste, et la fin de la solidarité multiethnique qui a caractérisé l’équipage bigarré.
Si le livre suit une trame assez linéaire, quoiqu’avec des bonds dans le temps, la structure interne des chapitres permet des allées et venues dans le passé. Rediker et Linebaugh commencent généralement en évoquant une histoire individuelle, puis présentent la trame événementielle liée à un moment précis et le projet égalitaire et libertaire défendu par les protagonistes de l’équipage bigarré. Le contexte historique est parfois assez précis, alors qu’à d’autres moments, il semble plus général, comme pour les enclosures. Cela est peut-être la trace d’une volonté de s’adresser à un public moins académique. La répression est souvent abordée dès le début du chapitre, ce qui permet d’amoindrir la teinte romantique de l’ouvrage. Néanmoins, cela conduit à voir l’échec des projets du bas comme étant inéluctable. Voilà certainement un effet de la posture marxiste des auteurs, mais aussi des sources provenant de l’élite. Est-ce à ce point une défaite complète des idées égalitaires et libertaires du « peuple », malgré leur survie ? La forme moins linéaire des chapitres permet également d’insister sur la dimension transatlantique de l’équipage bigarré. En effet, on mentionne occasionnellement l’inspiration directe ou symbolique d’un personnage abordé dans un chapitre précédent pour l’événement analysé. Sinon, il est souvent question de l’héritage des révoltes et des idées qui ont habité les acteurs historiques. Cela est évoqué par exemple pour la Révolution américaine (pp. 354-355).
Par ailleurs, certains chapitres sont résolument atlantiques (chapitres 5 et 8), alors que d’autres se concentrent davantage sur un pôle (chapitres 2 et 4). Cela étant dit, les contours de l’Atlantique proposés sont essentiellement britanniques. Si ce choix est méthodologiquement et historiquement défendable, il n’est aucunement justifié. Il s’agit peut-être de rendre compte de la multiethnicité atlantique par le bas. Ce faisant, il est moins question des rencontres entre empires coloniaux et, en filigrane, d’État-nations. Cela dénote une attitude plus critique avec l’histoire des États-nations. Paradoxalement, l’étude reste toutefois centrée sur un seul État-empire. Dans ce contexte, il aurait été fort à propos de voir si des Espagnols, des Français ou des Portugais faisaient aussi, en quelque sorte, partie de cet équipage bigarré « anglais » ou encore s’ils avaient le « leur ». Plus simplement, la facette britannique demeure la spécialité des auteurs, en plus d’être au cœur de l’historiographie du monde atlantique (11). Enfin, soulignons les références occasionnelles à la métaphore de l’hydre dans les discours de l’élite, puis du peuple au 19e siècle. Cet usage permet de rappeler élégamment une partie de la thèse des auteurs, soit la peur qu’ont les élites capitalistes des mouvements égalitaires et libertaires.
L’autre versant de cette thèse est que les paysans, les marins et les esclaves ont développé dans la sphère atlantique une alternative libertaire et égalitaire au capitalisme. Selon Rediker et Linebaugh, la résistance de l’équipage bigarré n’est pas utopique, mais basée sur leur expérience (pp. 166 et 434). Le protestantisme, particulièrement l’anabaptisme, serait un terreau idéologique fertile pour fomenter la contestation populaire (les empires catholiques seraient-ils exclus de facto de cet atlantique révolutionnaire ?). En outre, la survie des idées libertaires et égalitaires au sein du peuple, malgré la répression et la montée du capitalisme qui suit ces échecs du bas, s’explique par le mouvement des idées le long des côtes atlantiques (pp. 180, 256, 259 et 520).
Cette idée est intéressante, mais constitue une limite à la prise en compte de l’agentivité. En effet, selon cette perspective, c’est le capitalisme atlantique qui permet au mouvement contestataire de se déplacer et non la volonté de l’équipage bigarré. Une dernière conclusion, qui apparaît plus clairement à mesure que le récit avance, porte sur les conséquences des échecs d’un mouvement populaire multiethnique : le racisme et le nationalisme (pp. 150, 310-311, 423). En effet, selon les deux historiens, l’avènement du nationalisme, né du capitalisme, met fin à l’universalisme promu par l’équipage bigarré et surtout, la rupture de la solidarité de classe à l’échelle mondiale (pp. 426 et 490). En ce sens, Linebaugh et Rediker semblent postuler implicitement qu’il existe deux formes de contrôle des idées subversives : la répression violente, largement abordée, mais aussi la recomposition sociale, qui a presque sonné le cas aux idées de l’équipage bigarré (aurait-elle survécu sous le slogan « prolétaires de tous les pays, unissez-vous » ?). Cette idée très stimulante mérite certainement un approfondissement ultérieur.
Comme l’affirme David Armitage, Rediker et Linebaugh se portent à la défense de l’équipage bigarré (12), notamment en montrant que la résistance au projet capitaliste est la norme (pp. 56-58). Armitage est-il trop dur envers les auteurs ? Il serait peut-être plus juste et nuancé d’affirmer qu’il y a une alternance de moments d’effervescence et d’apaisement. Les deux historiens nient également toute forme de hiérarchie ou de « proto - » classes sociales, par exemple chez les Amérindiens (p. 58), qui sont étonnamment peu présents dans l’ouvrage. Dans la même optique, le traitement de la piraterie comme société égalitaire et démocratique est peu appuyé par des sources. L’idée est intéressante, mais peu convaincante. De plus, le cadre d’analyse marxiste semble mener les auteurs à voir où le communisme aurait pu naître, bien avant le 19e siècle. Cela dit, comme Marx, l’Angleterre demeure le point névralgique de ce projet alternatif. Cela explique aussi le choix d’analyser l’Atlantique britannique, ce que Armitage souligne sans toutefois commenter (13). La décision d’aborder seulement la facette anglaise de l’Atlantique révolutionnaire donne finalement l’impression d’un univers plus maritime que réellement atlantique. Si les révolutions haïtiennes et françaises sont mentionnées, qu’en est-il des possibles inspirations en provenance des autres empires coloniaux ? Ne se révoltent-ils pas ?
En ce sens, Rediker et Linebaugh se situent dans une histoire partiellement globale : une histoire des connexions dans un cadre supranational, mais centré sur un seul État-empire. Il s’agit peut-être là d’un problème d’accès aux sources d’autres langues pour des historiens qui ne sont peut-être pas polyglottes, un frein majeur à l’histoire mondiale. De plus, soulignons que le versant africain de l’Atlantique occupe la part congrue : les esclaves sont bien présents, mais leur continent d’origine l’est beaucoup moins. Néanmoins, la maîtrise de plusieurs historiographies et de l’histoire de nombreux territoires constitue une limite importante à l’histoire mondiale (14).
En définitive, l’histoire atlantique et l’histoire mondiale s’écrivent de multiples façons. Malgré certaines lacunes, L’Hydre aux mille têtes fait certainement partie de ces mouvements historiographiques, même si Rediker et Linebaugh ne se revendiquent pas du second.
Notes
(1) Beacon Press. History and Mission ; Unitarian Universalist Association.
(2) Peter Linebaugh, Departement of History ; PM Press, Peter Linebaugh.
(3) Marcus Rediker: Historian, Writer, Teacher, Activist (9 mars 2016).
(4) Christian Delacroix, « Acteur », in Christian Delacroix et al., Historiographies II. Concepts et débats, Paris, Gallimard, 2010, p. 657.
(5) Edward P. Thompson, La Formation de la classe ouvrière anglaise, Paris, Gallimard, 1988, 791 p. ; Stéphane Van Damme, « Cultural Studies » dans Christian Delacroix et al., Historiographies I. Concepts et débats, Paris, Gallimard, 2010, pp. 92-93 ; David Armitage, « The Red Atlantic », Reviews in American History, vol. 29, n° 4, 2001, p. 480.
(6) CLR James, Les Jacobins noirs. Toussaint Louverture et la Révolution de Saint-Domingue, Paris, Éditions Amsterdam, 2008, 402 p.
(7) Allison Games, « Atlantic History; Definitions, Challenges, and Opportunities », American Historical Review, vol. 111, n° 3, 2006, p. 744; Cécile Vidal, « Pour une histoire globale du monde atlantique ou des histoires connectées dans et au-delà du monde atlantique ? », Annales, Histoire, Sciences Sociales, vol. 67, n° 2, 2012, p. 392.
(8) Armitage, op. cit., p. 482.
(9) Armitage souligne aussi cette idée, quoique dans un contexte plus large, ibid., p. 483.
(10) Ibid., p. 482.
(11) Games, op. cit., p. 744.
(12) Armitage, op. cit., p. 482.
(13) Armitage soulève également cette idée, ibid., p. 480.
(14) Games, op. cit., p. 751.


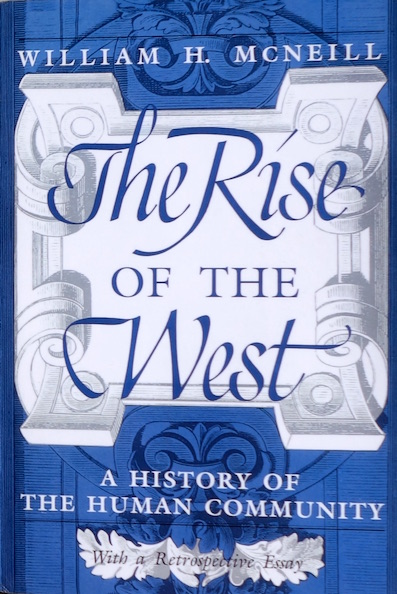 .
.