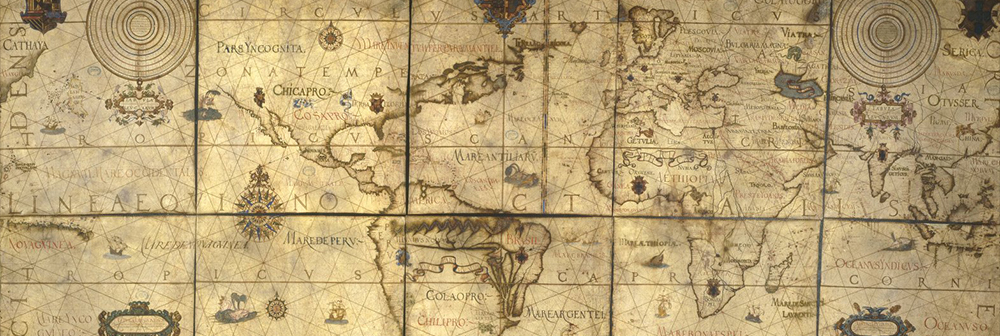« En cette même année [1291], Tedisio Doria, Ugolino Vivaldi et son frère, avec quelques autres citoyens de Gènes, entreprirent de faire un voyage que personne jusqu’alors n’avait jamais tenté de faire. En effet, ils équipèrent au mieux deux galères, et les ayant pourvues de vivres, d’eau, et autres choses nécessaires, ils les envoyèrent au mois de mai au dehors du détroit de Septa, afin qu’elles allassent par la mer océane jusqu’aux régions d’Inde, et en rapportassent des marchandises de profit. Les deux frères Vivaldi susdits y allèrent de leurs personnes, ainsi que deux cordeliers. Cela causa l’étonnement non seulement de ceux qui le virent, mais encore de ceux qui en entendirent parler. Après qu’ils eurent dépassé l’endroit qu’on appelle Gozora on n’eut plus aucunes nouvelles certaines d’eux. Que Dieu les garde et les ramène sains et saufs dans leur patrie ! »[1]
Ce texte est extrait des Annales de Jacopo Doria. Celui-ci, membre d’une des familles nobiliaires les plus importantes de Gênes, déposa en 1294 dans les annales officielles de la ville ses écrits historiques portant sur les quinze dernières années (Jacobi Aurie Annales). Ces quelques lignes sont le principal témoignage du voyage maritime entrepris par les frères Vivaldi vers les Indes. Cette expédition fut sans retour et nous n’en connaissons à peu près rien. Mais l’année, 1291, ne tient sans doute pas du hasard. Au moment où Saint-Jean-d’Acre, dernière ville franque de Terre Sainte, tombe aux mains des musulmans, des marchands génois s’aventurent dans l’Atlantique et tentent de contourner l’Afrique par le sud pour atteindre directement les régions productrices d’épices. Le projet était pour le moins risqué. Son principal instigateur, semble-t-il, Tedisio Doria, était amiral, mais il n’y participa pas personnellement. De fait, sa réalisation fut fatale aux audacieux.
Les documents qui confirmeraient cette expédition et compléteraient les informations sont rares. Pietro d’Abano, philosophe, médecin, astrologue, enseignant à Padoue, y fait référence dans son ouvrage Conciliator differentiarum quae inter philosophos et medicos versantur (1310). Discutant la question de l’habitabilité de la zone intertropicale, celui-ci fait brièvement allusion, sans les nommer, aux frères Vivaldi, pour mentionner également leur disparition :
« Il y a quelque temps de cela, des Génois ont apprêté deux fortes galères avec tout le nécessaire, ils sont passés par Gadès d’Hercule, à l’extrémité de l’Espagne. Mais jusqu’à aujourd’hui on ignore ce qui leur est arrivé en l’espace de presque trente ans. Le passage, cependant, est à présent ouvert en allant vers le nord par la grande Tartarie, puis en tournant vers l’est et le sud. »[2]
Selon ce texte, l’expédition aurait eu lieu vers 1280, mais la datation est clairement approximative et ne permet pas de remettre en question les Annales de Jacopo Doria. Par contre, l’objectif d’atteindre les Indes par une nouvelle route en raison du verrou levantin est confirmé. Or le contournement de l’Afrique est un pari géographique à une époque où la question de l’habitabilité de la zone intertropicale est débattue et où on s’interroge sur la possibilité de franchir la ligne équatoriale. Or, Pietro d’Abano reprend l’idée que la ville d’Arim, en Inde, existe bel et bien. Celle-ci, qu’on imagine située précisément sur l’équateur, voire au centre du monde, révèle l’influence des ouvrages astronomiques arabes traduits au 12e siècle en Espagne. En effet, Arim est le point de référence des longitudes dans le Zîj al-Sindhind (la Table indienne) composé par al-Khwârizmî vers 830, repris par l’astronome andalou Maslama al-Majrîtî (vers 1000), traduit et adapté au calendrier julien en 1116 par le juif converti Pierre Alphonse. Dans un autre texte (Expositio problematum Aristotelis), Pietro Abano signale que Marco Polo, au cours de son périple, a franchi l’équateur. Mais il ne revint à Venise qu’en 1295 ; son expérience n’a donc eu aucune influence sur l’expédition des frères Vivaldi, antérieure de quelques années. Il faut donc penser que ce sont uniquement les spéculations astronomiques qui ont permis de rendre envisageable le contournement de l’Afrique par le sud, mais la question mériterait d’être approfondie car elle pose également celle de la configuration de l’océan Indien.
Outre les textes qui reprennent directement le récit de Jacopo Doria, il existe trois autres documents qui ont parfois été pris en considération par les historiens, mais qui doivent être regardés avec la plus grande suspicion, voire tout simplement écartés.
Le premier est le témoignage de l’anonyme du Libro del conosçimiento de todos los rregnos. Dans cet ouvrage daté de la seconde moitié du 14e siècle, l’auteur, castillan, relate son voyage à travers le monde entier, décrivant tous les royaumes d’Europe, d’Afrique et d’Asie, et notamment leurs armoiries. Dans la ville de Graçiona, capitale de l’empire d’Abdeselib (‘Abd al-salib, « serviteur de la croix »), défenseur de l’Église de Nubie et d’Éthiopie, dominée par le Prêtre Jean, il apprend que l’une des deux galères génoises aurait fait naufrage à Amenuan (Almina ?) et que ses passagers auraient été amenés ici. Ailleurs, à Magdasor (Mogadiscio ?), on lui dit que le fils d’un des frères Vivaldi, Sor Leonis, serait venu à la recherche de son père et aurait voulu atteindre Graçiona, mais l’empereur de Magdasor l’en aurait dissuadé en raison des dangers des régions à traverser. Si différents éléments, y compris l’existence de Sorleone Vivaldi, attestée dans les archives génoises, sont vrais, sans doute en grande partie inspirés d’un atlas, l’ensemble est un tissu d’invraisemblances. Le récit est bel et bien imaginaire.
Le deuxième, encore plus étonnant, est une lettre écrite par Antoniotto Usodimare le 12 décembre 1455. Marchand génois au service du prince Henri le Navigateur, il explora en 1455 les côtes africaines jusqu’aux îles du Cap-Vert et la Guinée. De retour, il écrit une lettre à ses créanciers, en un mauvais latin mâtiné d’italien, afin d’obtenir de nouveaux subsides pour pouvoir mener une nouvelle expédition. Il raconte qu’il aurait rencontré un rescapé :
« J’ai trouvé au même endroit un vieil homme de notre nation, des galères, je crois, des Vivaldi, qui se sont perdues il y a 170 ans, à ce qu’il m’a dit, et ce secrétaire (sic) [du roi de Gambie] m’a confirmé que personne de sa race ne lui avait survécu. »[3]
Non seulement le fait est impossible, mais la rencontre avec un Européen qui aurait réchappé à un naufrage n’est pas corroborée par le témoignage du Vénitien Alvise Ca’da Mosto, dont la caravelle a accompagné celle d’Usodimare.
Le troisième est lié au précédent. Il s’agit d’un court texte retrouvé sur le même codex que la lettre d’Usodimare et sur lequel se trouve également une copie de l’Imago Mundi d’Honoré d’Autun. Le texte a parfois été attribué à Usodimare, mais sans autre preuve que la simple juxtaposition des textes.
« En 1290, deux galères ont quitté la ville de Gênes. Elles avaient pour patrons D. Vadino et Guido de Vivaldi, frères, qui voulaient aller au levant dans les régions de l’Inde. Ces galères naviguèrent beaucoup. Mais quand ces deux galères furent dans la mer de Ghinoia [Guinée], l’une d’elle s’échoua sur un bas fond, sans pouvoir aller ni naviguer. L’autre navigua et traversa cette mer jusqu’à une ville d’Éthiopie appelée Menam. Ils furent capturés et détenus par les gens de cette ville, qui sont des chrétiens d’Éthiopie soumis au Prêtre Jean. La ville elle-même est près de Marma, près du fleuve Sion [Gihon ?]. Ces hommes furent détenus, et aucun d’entre eux n’est jamais revenu. »[4]
Si ces documents attestent de la persistance du souvenir de l’expédition des frères Vivaldi réalisée il y a plus d’un siècle et demi, les traces en restent quelque peu évanescentes. Par ailleurs, il est un autre texte qui pourrait évoquer l’aventure des frères Vivaldi. Il s’agit d’un extrait de La Divine Comédie, écrite par Dante entre 1307 et 1321, soit quinze à trente ans après leur départ. C’est Edward Moore le premier, dans son article « Geography of Dante », qui fit l’hypothèse de voir une allusion à cette expédition dans le discours d’Ulysse, rencontré par Dante en enfer :
« Quand je me séparai de Circé, qui me tint
Plus d’une année caché, près de Gaëte,
– Avant qu’Énée ainsi ne l’eût nommée –Ni la douceur d’un fils, ni la pitié
De mon vieux père, ou cet amour juré
Qui devait réjouir le cœur de Pénélope,Ne purent vaincre au fond de moi l’ardeur
Que j’avais à me rendre un connaisseur du monde
Et des vertus et des vices humains.Mais je repris la mer, la haute mer ouverte,
Sur une nef, avec cette poignée
D’amis qui ne m’avaient jamais abandonné.Jusqu’à l’Espagne et jusqu’au Maroc
Je vis les continents, et l’île de Sardaigne
Et celles-là que baigne alentour notre mer.Nous étions vieux et las, moi et mes compagnons,
Comme nous parvenions à cette gorge étroite,
Où Hercule parut et planta ses deux bornes,Afin que nul n’osât se hasarder plus loin.
Je laissai donc Séville à la main droite,
À la gauche, déjà, Ceuta m’avait laissé.“Mes frères, dis-je, ô vous qui, à travers cent mille
Dangers, êtes venus aux confins d’occident,
À cette extrême et tremblante veilléeDe nos ardeurs, dont elle est le restant,
Ne vous refusez pas à faire connaissance,
En suivant le soleil, du monde inhabité.Considérez quelle est votre origine :
Vous n’avez été faits pour vivre comme brutes,
Mais pour ensuivre et science et vertu.”J’étais si fort excité mes amis,
Par ma simple harangue, au désir du voyage
Qu’à peine aurai-je pu, dès lors, les retenir.Et, tournant désormais notre poupe au matin,
Des rames nous faisons des ailes au vol fou,
Et nous gagnons toujours du côté gauche.Déjà la nuit contemplait les étoiles
De l’autre pôle, et le nôtre baissait
Tant qu’il ne montait plus sur la plaine marine.Par cinq fois ranimées, autant de fois éteinte,
La face de la lune avait reçu le jour,
Depuis que nous avions franchi le pas suprême,Quand se montra, bleui par la distance,
Un sommet isolé qui me parut plus haut
Qu’aucun des monts que j’avais jamais vus.Notre première joie se tourna vite en pleurs :
De la terre nouvelle il naquit une trombe,
Qui vint frapper notre nef à l’avant.Par trois fois dans sa masse elle le fit tourner :
Mais, à la quarte fois, la poupe se dressa
Et l’avant s’abîma, comme il plut à Quelqu’un,Jusqu’à tant que la mer sur nous fût refermée. »[5]
L’hypothèse d’une telle lecture est motivée par le décalage pour le moins surprenant entre l’histoire du héros de l’Odyssée et le récit du personnage de Dante. Ce dernier, au lieu de rentrer en son île d’Ithaque, choisit au contraire de tourner le dos à la Méditerranée et de s’enfoncer dans l’Atlantique. Clairement, Ulysse n’est pas Ulysse. Il pourrait s’agir d’une simple allégorie de l’hubris, mais le lien avec les frères Vivaldi peut se justifier par la direction prise par cette nouvelle Odyssée. Ulysse dirige son navire vers l’est et tente lui aussi de contourner l’Afrique, au-delà de toute prudence, qui est une vertu cardinale.
L’échec de l’expédition des frères Vivaldi n’en a pas marqué pour autant la fin de ces expéditions. D’autres navigateurs génois se sont aventurés au-delà des Colonnes d’Hercule, le long des côtes de l’Afrique. Ainsi, en 1312, Lancelotto Malocello parvint aux Canaries, donnant son nom à l’une des îles, Lanzarote. Le nom apparaît sur la carte d’Angelino Dulcert, en 1339.
On pourrait également citer Jaume Ferrer, récemment identifié avec Giacomino Ferrar di Casa Maveri, citoyen de Majorque issu d’une famille génoise installée à la fin du 13e siècle, qui lui aussi disparut en mer. Dans l’angle inférieur gauche de l’Atlas catalan, daté de 1375 et attribué au cartographe majorquin Abraham Cresque, on peut voir un navire qui ressemble assez à une galère avec quelques marins à bord. L’image est accompagnée d’un court texte :
« Le bateau de Jaume Ferrer est parti pour la rivière de l’or le jour de saint Laurent, qui est le 10 août et c’était en l’année 1346. »
Là encore, il s’agit d’une attestation à peu près unique d’une expédition sans retour.
Figure 1. Le navire de Jaume Ferrer, Atlas catalan, 1375 (Bnf)
Ces documents sont-ils des sources pour l’histoire globale ? Oui, incontestablement, dans la mesure où, même s’ils se situent dans la préhistoire de la globalisation, avant le tournant des 15e-16e siècles, ils illustrent un des mécanismes de mondialisation, à savoir le dépassement de l’horizon. Dans la mythologie gréco-romaine, le détroit de Gibraltar représentait les limites du monde (même si pour Ptolémée, le méridien d’origine passait par les îles Fortunées, c’est-à-dire les Canaries). Or la mondialisation tient en partie à l’audace d’aller « plus oultre ».
On a pu croire que la fameuse devise de Charles Quint faisait allusion aux explorations hispaniques outre-Atlantique et prenait à rebours une expression latine « non plus ultra ». Il s’avère en réalité que la devise a été adoptée, en français, par Charles de Habsbourg en 1516, alors qu’il n’était que jeune duc de Bourgogne. Elle apparaît alors pour la première fois lors de la réunion du dix-huitième chapitre de l’ordre de la Toison d’Or, sur une stalle du chœur de l’église Sainte-Gudule, à Bruxelles, décrite par le poète flamand Jan Smeken. La formule lui aurait été soufflée par son médecin Luigi Marliano, humaniste italien. Son sens s’inscrirait davantage dans le contexte de la lutte contre l’islam. Quant à la forme latine « Plus Ultra », elle daterait de 1517.
Cependant, il est possible que Luigi Marliano ait été inspiré par Dante et le fameux discours d’Ulysse : più oltre non. Du moins est-ce l’hypothèse d’Earl E. Rosenthal [1971, 1793]. Mais d’autres éléments ont pu jouer. Rosenthal fait le lien avec la formule inscrite au dos du chariot portant la dépouille de Ferdinand II d’Aragon lors des funérailles organisées à Bruxelles en mars 1516 : Ulterius nisi morte, « Plus loin, sinon la mort ». Située au-dessous d’une pomme d’or représentant le globe, elle faisait référence à l’ampleur des conquêtes du Roi Catholique. Par cette devise « Plus oultre », Charles de Hasbourg inscrivait donc ses pas dans ceux de son grand-père. Elle incarnait bien à la fois l’audace d’aller plus loin et la prétention à l’empire universel.
Pour terminer cette lecture globale de la devise de Charles Quint, citons cet extrait d’un mémoire de Pedro Fernandes de Queirós adressé à Philippe III (1598-1621), dans lequel il raconte son exploration de l’archipel du Vanuatu en 1606 :
« J’ai donné à toute cette région le nom de Terre australe du Saint-Esprit, et j’ai imposé divers noms à une vingtaine d’îles nouvellement découvertes, j’ai pris possession de tout ce pays au nom de Votre Majesté en faisant ériger deux colonnes sur lesquelles on a gravé votre devise plus ultra, qui convenait si bien ici, on a aussi dressé une croix sur le rivage et un autel en l’honneur de Notre-Dame de Lorette, sur lequel le sacrifice de la messe a été célébré plus d’une fois. »[6]
Bibliographie
Voyages en Afrique noire d’Alvise Ca’da Mosto (1455 & 1456), trad. de l’italien et prés. par F. Verrier, Paris, Chandeigne, 2003 (2e éd. remaniée).
Petro Abano, 1565, Conciliator controversiarum, quæ inter philosophos et medicos versantur¸ Venise, Giunta.
d’Avezac M.-A., 1845, « Notices des découvertes faites au Moyen-Âge dans l’océan Atlantique », Nouvelles Annales des voyages, Nouvelle série, Vol 4, pp. 20-58.
d’Avezac M.-A., 1859, L’Expédition génoise des frères Vivaldi à la découverte de la route maritime des Indes orientales au XIIIe siècle, Paris, Arthus Bertrand.
de Brosses C., 1756, Histoire des navigations aux terres australes, Paris, chez Griffon, deux volumes.
Dante, La Divine Comédie, trad. de l’italien, notes et commentaires d’H.Longnon,Paris, Garnier frères, 1962.
Fernández-Armesto F., 2007, Pathfinders. A Global History of Exploration, New York/Londres, W.W.Norton & Company.
Gråberg G., 1802, « Notizia Dell’Itinerario di Antoniotto Usodimare », Annali di geografia e di statistica, Vol. 2, pp. 280-291.
Hutchinson K., 2009, « The Antiquity of the “Injunction” Non Plus Ultra », Canadian Bulletin of Medical History, Vol. 26, n° 1, pp. 155-178.
Moore E., 1903, « The Geography of Dante », in Studies in Dantes, 3ème série, Oxford, Clarendon Press, pp. 109-143.
Rosenthal E., 1971, « Plus Ultra, Non plus Ultra, and the Columnar Device of Emperor Charles V », Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 34, pp. 204-228.
Rosenthal E., 1973, « The Invention of the Columnar Device of Emperor Charles V at the Court of Burgundy in Flanders in 1516 », Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 36, pp. 198-230.
Notes
[1] Le texte en latin est tiré de l’ouvrage Marie-Armand d’Avezac M.-A., 1859, L’Expédition génoise des frères Vivaldi à la découverte de la route maritime des Indes orientales au XIIIe siècle, Paris, Arthus Bertrand, p. 16. Trad. de VC.
[2] Petro Abano, Conciliator controversiarum, quæ inter philosophos et medicos versantur. L’édition utilisée est celle de 1565, Venise, Giunta, f°102r. Trad. de VC.
[3] Le texte en latin a été publié par Giacomo Gråberg A., 1802, « Notizia Dell’Itinerario di Antoniotto Usodimare », Annali di geografia e di statistica, Vol. 2, pp. 287-288. Trad. de VC.
[4] Le texte en latin a été publié par Giacomo Gråberg A., 1802, « Notizia Dell’Itinerario di Antoniotto Usodimare », Annali di geografia e di statistica, Vol. 2, pp. 290-291. Trad. de VC en tenant compte de la correction sur la date [d’Avezac 1945].
[5] Dante, La Divine Comédie, trad. de l’italien, notes et commentaires d’H.Longnon,Paris, Garnier frères, 1962, p.
[6] Mémoire de Pedro Fernandes de Queirós in Charles de Brosses C., 1756, Histoire des navigations aux terres australes, Paris, chez Griffon, vol. I, p. 338.