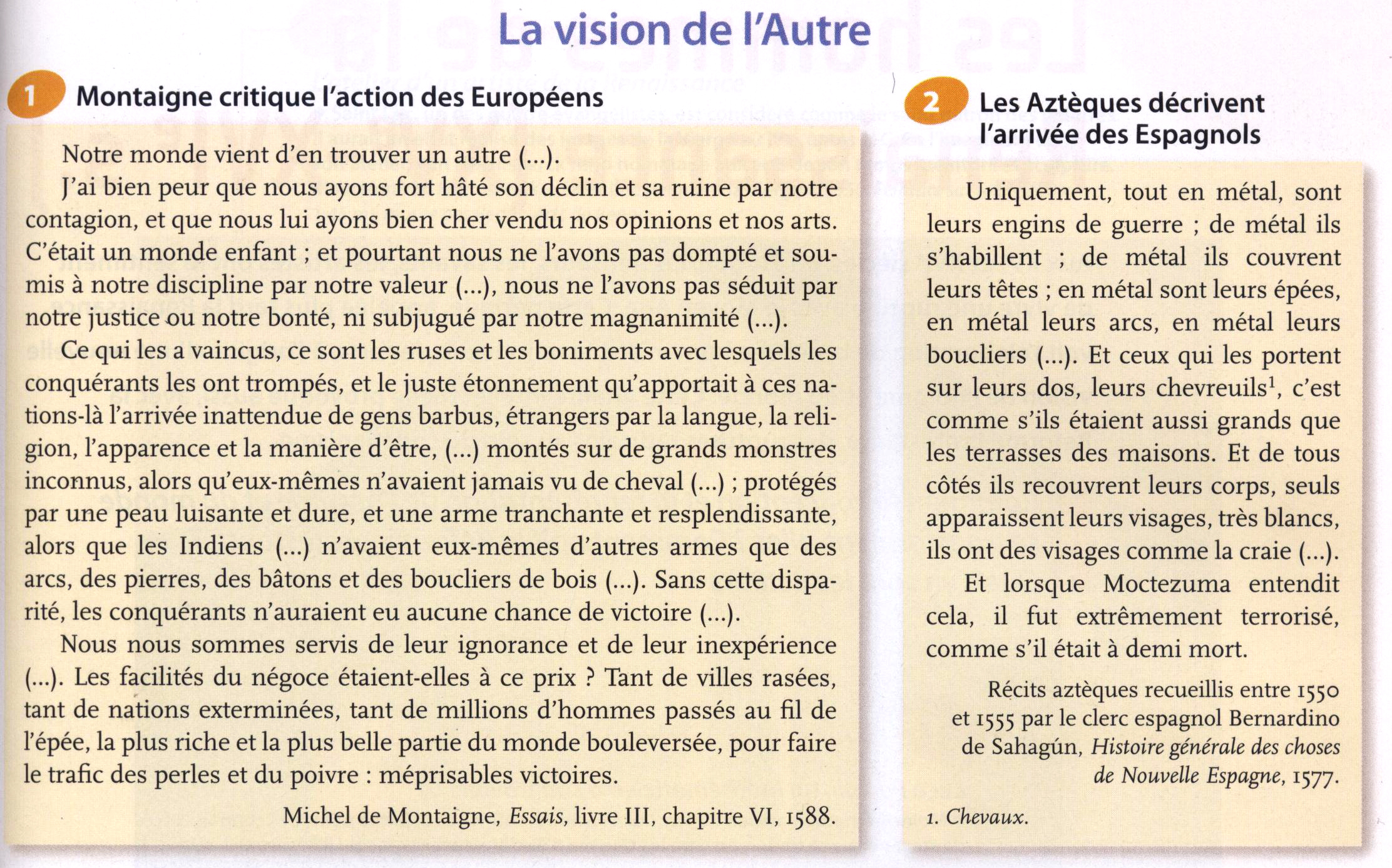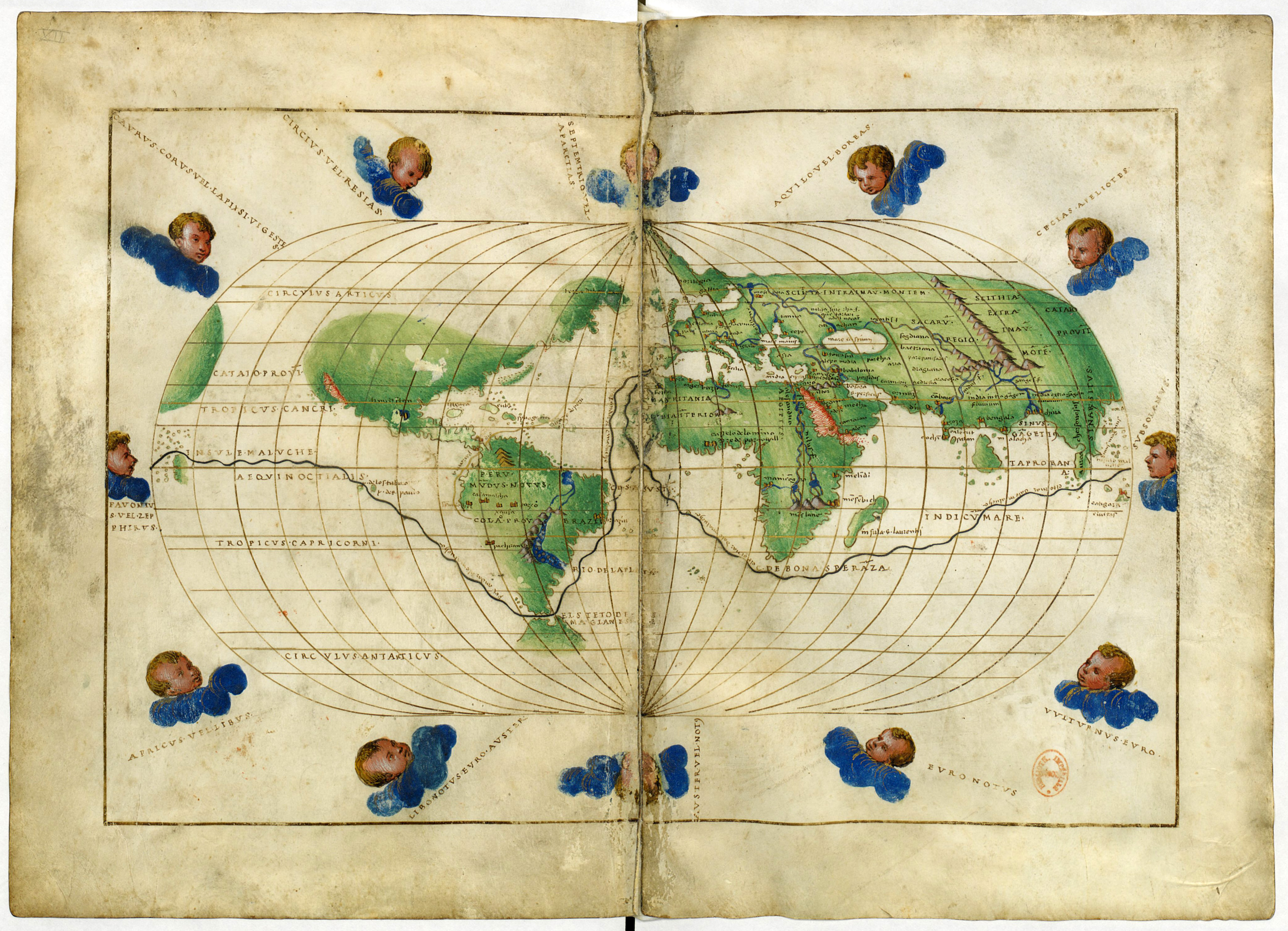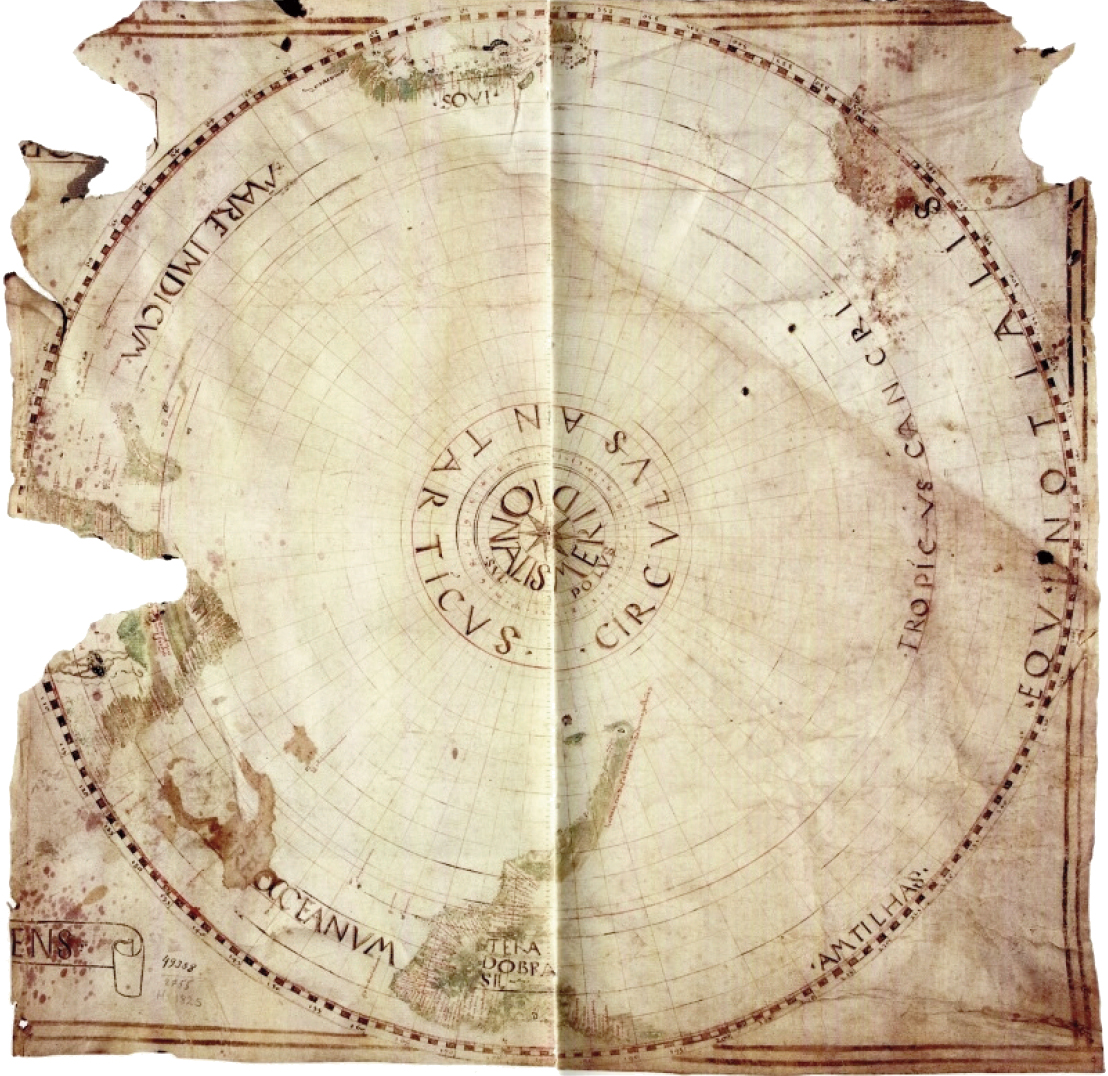Le silence a duré trop longtemps, et nous prions nos lecteurs de nous en excuser. Philippe Norel était l’instigateur de ce blog. Sa mort nous a privés d’un ami et d’un collaborateur irremplaçable. Nous ne pouvons à ce jour promettre de retrouver le rythme d’avant, mais nous essaierons de publier à nouveau, de façon régulière, un billet d’histoire globale. Tant nous avons bien perçu, au fil des ans, que ce blog distille des idées en faveur d’une autre histoire.
À la fin de l’année dernière est parue en France la traduction d’un ouvrage édité initialement par les Presses de l’Université de Columbia en 2010. Curieusement, le titre en français a gardé une partie de son origine étatsunienne : French Global. Une nouvelle perspective sur l’histoire littéraire – au risque, peut-être, de maintenir une certaine distance avec les études globales. Composé de trente chapitres, en comptant l’introduction, ce livre entend reconsidérer l’étude de la littérature en langue française sous l’angle de la mondialisation globale [1]. Je ne ferai pas ici une recension critique de l’ensemble du livre, tellement il se révèle extrêmement riche ; et je m’arrêterai même à son premier chapitre, écrit par Sharon Kinoshita, dont le titre est à lui seul tout un programme : « Worlding le français médiéval » – ce que j’ai repris sous forme interrogative en tête de ce billet.
 La notion de worlding fait explicitement allusion aux recherches menées à l’Université de Californie à Santa Cruz, et au livre édité en 2007 par R. Wilson et C.L. Connery, The Worlding Project : Doing Cultural Studies in the Era of Globalization. L’objectif est de tenir une posture qui « interrompt et critique une gamme d’imaginaires disciplinaires » et qui cherche « non seulement à augmenter la représentation des cultures auparavant sous-représentées ou même passées sous silence, mais plutôt à présenter les rapports toujours dynamiques entre cultures dominantes et cultures émergentes dans la spécificité de leurs contextes historiques et économiques ». Pourrait-on envisager une « mondialisation » de la littérature française au Moyen Âge ? Cette question, Sharon Kinoshita la décline sous trois angles, celui de la poétique et de la politique de translatio dans le roman du 12e siècle ; celui des traces littéraires d’une politique française dans la Méditerranée du 13e siècle ; et enfin, celui du système mondial qui sous-tend La Description du monde de Marco Polo.
La notion de worlding fait explicitement allusion aux recherches menées à l’Université de Californie à Santa Cruz, et au livre édité en 2007 par R. Wilson et C.L. Connery, The Worlding Project : Doing Cultural Studies in the Era of Globalization. L’objectif est de tenir une posture qui « interrompt et critique une gamme d’imaginaires disciplinaires » et qui cherche « non seulement à augmenter la représentation des cultures auparavant sous-représentées ou même passées sous silence, mais plutôt à présenter les rapports toujours dynamiques entre cultures dominantes et cultures émergentes dans la spécificité de leurs contextes historiques et économiques ». Pourrait-on envisager une « mondialisation » de la littérature française au Moyen Âge ? Cette question, Sharon Kinoshita la décline sous trois angles, celui de la poétique et de la politique de translatio dans le roman du 12e siècle ; celui des traces littéraires d’une politique française dans la Méditerranée du 13e siècle ; et enfin, celui du système mondial qui sous-tend La Description du monde de Marco Polo.
Un schéma métahistorique : la translatio
Le récit peut-être le plus souvent cité est celui de Chrétien de Troyes, dans le Cligès :
« Nos livres nous ont appris que la Grèce eut le premier renom de chevalerie et de science. Puis la chevalerie passa à Rome, et avec elle la somme de la science, et maintenant sont venues en France. Dieu fasse qu’elles y soient retenues et que le séjour leur plaise tant que jamais ne sorte de France la gloire qui s’y est arrêtée. Dieu ne l’avait que prêtée aux autres, car des Grecs ni des Romains on ne parle plus du tout, tous propos sur eux ont cessé et elle est éteinte, leur vive braise. » [2]
Se met alors en place l’idée d’un déplacement de la centralité, politique et culturelle, d’est en ouest, de la Grèce vers la France, via Rome, ce qu’on retrouve au début du 15e siècle, par exemple, sous la plume de Christine de Pizan :
« Ou temps Charles le Grant, vint un moult grant clerc de Bretaigne, qui avoit nom Alcun ou Aubin ; de ce maistre aprist le roy toutes les ars liberaulz. Celui maistre, pour la grant amour qu’il vid que Charles avoit a science, et par la prière qu’il lui en fist, tant pourchaça par son sens que il amena et fist translater les estudes des sciences de Romme a Paris, tout ainsi comme jadis vindrent de Grece a Romme ; et les fondateurs de la ditte estude furent celluy Alcun, Rabanes, qui fu disciple de Bedes, et Clodes, et Jehan l’Escot […]. » [3]
On peut considérer que ce schéma métahistorique est toujours celui qui structure notre enseignement. Pourtant, comme le souligne Sharon Kinoshita, on peut trouver au 12e siècle des textes qui ne suivent pas ce schéma et au contraire, même, qui s’en jouent, et qu’elle propose de rassembler en une « matière de la Méditerranée », sur le modèle de la classification proposée par Jean Bodel au siècle suivant.
Un roman, en particulier, pourrait servir d’exemple : Floire et Blanchefleur, écrit par Robert d’Orbigny aux alentours de 1150. Le récit raconte une histoire d’amour contrarié entre Floire, prince musulman d’Andalousie, et Blanchefleur, fille de la servante chrétienne, nés tous les deux le jour de la fête des rameaux. Élevés et éduqués ensemble, ils s’aiment ; ce que le roi ne peut à terme accepter. Il décide de se débarrasser de Blanchefleur, sinon par la mort, alors en la vendant à des marchands venus d’Égypte. En échange, ceux-ci donnent une splendide coupe en or apportée par Énée de Troie jusqu’en Italie, puis volée à l’empereur de Rome pour finir entre les mains desdits marchands. Tandis que Blanchefleur arrive en Égypte où elle est vendue à l’émir du Caire, qui l’emprisonne dans son harem, Floire, désespéré, part à sa recherche à travers la Méditerranée. Il finit par la délivrer et par amour pour elle, se convertit au christianisme.
Les trajectoires des hommes et des objets s’emmêlent et brouillent les clivages habituels. La Méditerranée, loin d’apparaître comme une zone de conflits, se révèle être un véritable espace-mouvement, fait d’échanges, de rencontres et de conversions – même si, bien entendu, l’amour et le christianisme, à la fin, triomphent.
Figure 1. Floire et Blanchefleur, essai cartographique
Un acteur central : Charles d’Anjou
Selon Sharon Kinoshita, « trop souvent passées sous silence dans l’historiographie de tendance nationale, la vie et la carrière politique de Charles d’Anjou constituent un moment clé autour duquel rassembler une histoire littéraire future de la Méditerranée francophone » (2014, p. 43). En 2005, Georges Jehel a consacré un ouvrage à Charles d’Anjou, sous-titré Un Capétien en Méditerranée, mais n’ayant pu le consulter, je m’en tiendrai à des considérations limitées. Rappelons tout d’abord que Charles d’Anjou (1226-1285), fils du roi de France Louis VIII et de Blanche de Castille, devint comte de Provence en 1246, qu’il participa à la septième croisade au côté de son frère Louis IX entre 1248 et 1251, qu’il devint roi de Sicile en 1266, grâce à l’appui de la papauté, et contre la maison de Haustofen, qu’il mena la huitième croisade après la mort de Louis IX en 1270, et qu’il fut roi de Jérusalem à partir de 1277. Les Vêpres siciliennes, en 1282, marquèrent un tournant dans la politique méditerranéenne française au profit du royaume d’Aragon. Il mourut en 1285. Le téléologisme hexagonal du roman national tend à occulter ces épisodes qui brouillent les frontières : quelle place pour un roi français dont le territoire englobe l’Anjou, le Maine, la Provence, la Sicile, le Sud de l’Italie, l’Achaïe, l’Épire, Corfou… et qui se trouve tout en même temps vassal du roi de France, du pape et du roi des Romains ? Jean Dunbabin (1998) parle d’un empire, ce que discute sans totalement le réfuter David Abulafia (2000). Quoi qu’il en soit, Charles Ier d’Anjou, au faîte de sa gloire, a pu être considéré comme le souverain le plus puissant de son temps. La Sicile apparaît aujourd’hui comme une périphérie européenne. Les conflits qui se nouèrent au 13e siècle pour la contrôler montrent bien à quel point il faut inverser notre regard. La multiplication des échanges à l’intérieur de l’espace méditerranéen à partir de la fin du 11e siècle en a fait au contraire un lieu central.
Figure 2 & 3. Les fresques de la tour Ferrande, à Perne-les-Fontaines : on peut y voir, notamment, Charles d’Anjou, comte de Provence, recevoir une bulle pontificale de la main de Clément V, l’investissant roi de Sicile, et la bataille opposant les troupes franco-provençales à l’armée impériale menée par Manfred (source : Wikipedia)
Toutes les histoires, toutefois, n’oublient pas cette complexité. Il serait juste, en particulier, de citer l’introduction du deuxième chapitre du volume de l’Histoire de France, publiée chez Belin en 2011, consacré à L’Âge d’or capétien, 1180-1328, et dû à Jean-Christophe Cassard :
« Le roi de Paris n’est pas au XIIIe siècle le souverain de tous ceux dont les descendants deviendront un jour, sur les mêmes territoires, des Français. À cette époque, le roi n’exerce nulle autorité sur les pays situés à l’est du Rhône, et ses États sont loin de border le Rhin en Alsace, mais ils s’étendent plus avant qu’aujourd’hui vers le nord, dans l’actuelle Belgique. En outre, à la cour de Londres comme à celle de Saint-Jean d’Acre en Syrie-Palestine, un temps même à celle de Constantinople, et plus durablement au palais de Famagouste à Chypre, les élites parlent et écrivent sa langue, leurs noms rappellent “la doulce France” dont leurs aïeux procédèrent jadis. C’est assez suggérer la complexité d’une géographie humaine, linguistique, politique aux combinatoires multiples dès lors que l’on prend en considération chaque région d’une aire continentale – pour ne rien dire de ses prolongements ultramarins – perçue en ce temps comme beaucoup plus vaste qu’elle ne l’apparaît actuellement, tant la lenteur des déplacements exagère les distances parcourues et vieillit prématurément toute information reçue. Le monde occidental vit alors à la fois sur un rythme lent et à une échelle très locale dont nous n’avons plus une conscience immédiate, et sur un mode déjà mondialisé pour ses références spirituelles et par certaines réalités tangibles, le tout demeurant bridé, faute de moyens techniques vraiment supérieurs à ceux de l’Antiquité romaine, les déchirements politiques en sus. Le cadre d’ensemble comme les paysages de détail s’en trouvent résolument complexes et décalés par rapport à nos “habitus”. Il convient de présenter ces mondes “français” dans leurs multiplicités. » [4]
Sharon Kinoshita, qui s’intéresse avant tout à la littérature de langue française, signale deux poèmes de Rutebeuf dans lesquels celui-ci défendait l’engagement militaire de Charles d’Anjou. Ainsi dans « la chanson de Pouille » et « le dit de Pouille », Rutebeuf appelle les chevaliers français à s’engager soutenir Charles dans sa conquête du trône de Sicile :
« 1
Que celui qui désire la santé de son âme
écoute ce qui se passe en Pouille !
Dieu a fait don de son Royaume :
ses serviteurs ne cessent de nous l’offrir
en prêchant pour la Terre Sainte.
Tout ce que nous avons fait de mal
nous sera pardonné si nous prenons la croix :
ne refusons pas un tel présent.
[…]7
Vavasseurs qui restez chez vous,
et vous, jeunes chevaliers errants,
n’ayez pas tant d’amour pour ce monde,
ne soyez pas insensés
au point de perdre la grande clarté
des cieux, où il n’y a aucune obscurité.
C’est maintenant que l’on verra votre valeur :
prenez la croix, Dieu vous attend. » [5]« 2
Le sujet que je veux aborder, c’est la Pouille
et le roi de Sicile, Dieu le rende prospère !
Qui au ciel veut semer la semence du salut
aille aider ce vaillant roi si digne d’estime.3
Le vaillant roi était comte d’Anjou et de Provence,
et il est fils de roi, frère du roi de France.
C’est clair, il ne veut pas faire un dieu de sa panse,
lui qui expose son corps pour sauver son âme. » [6]
Deux vers sont particulièrement intéressant :
« Il y a contre le roi trop d’Aumont, d’Agolant ;
le roi s’appelle Charles, mais lui manque un Roland. »
Rutebeuf reprend ici une identification largement répandue entre Charles d’Anjou et Charlemagne. Cette homonymie, qui était pour d’autres une véritable filiation, favorisait une prétention hégémonique sur la Chrétienté occidentale.
Autre exemple. En 1282, Robert d’Artois, neveu de Charles Ier, vint à Naples. Il était accompagné d’Adam de la Halle (ca.1240-1287). Même si cela reste discuté, il y aurait écrit et fait jouer Le Jeu de Robin et de Marion. C’est là également, peu après la mort de Charles Ier d’Anjou, qu’il composa, entre 1285 et 1288, un poème dans lequel il faisait l’éloge du roi défunt : « Le Roi de Sicile ». On pourrait toutefois complexifier encore davantage en rappelant l’opposition provençale à l’expansion angevine et l’existence d’une littérature en langue en occitan. Là aussi, on observe une diffusion de la langue d’oc vers l’Italie, à Gênes en particulier, où des troubadours l’utilisent, comme Perceval Doria.
Sur le plan des traductions, la Sicile n’a pas été l’Espagne. Cependant, on pourrait mentionner la traduction qui fut faite du Kitab al-hawi fi al-tibb du médecin persan Râzi (865-925). Le manuscrit arabe fut transmis à l’occasion d’une ambassade solennelle au sultan hafside de Tunis, envoyée par Charles d’Anjou. Traduit par Fargius (Faraj ben Salim) sous le titre de Liber continens, le livre de « Rhazes » s’imposa comme une référence auprès des médecins européens (cf. la conférence Jamel El Hadj).
Figure 4. Illustration initiale du manuscrit du livre de Rhazes, Havi seu continens (BnF) : on peut suivre la trajectoire du livre, des mains de l’émir hafside à celles de Charles Ier, et ensuite sa traduction.
Pour terminer, rappelons simplement que dans les programmes d’histoire de classe de seconde, entre 2000 et 2010, se trouvait un chapitre : « La Méditerranée au XIIe siècle, carrefour de trois civilisations ». Celui-ci a disparu et il y a aujourd’hui une lacune dans notre enseignement. Sharon Kinoshita aime à citer un extrait du Discours sur le colonialisme d’Aimé Césaire : « L’honnête contemporain de saint Louis, qui combattait mais respectait l’Islam, avait meilleure chance de le reconnaître que nos contemporains même frottés de littérature ethnographique qui le méprisent ». Je ne suis pas persuadé que l’histoire « globalisante » doive devenir le support d’une morale. Mais quoi qu’il en soit, l’élargissement du cadre et la prise en considération de la complexité née des imbrications et des interrelations suffisent à faire réfléchir.
Le livre de Marco Polo : un récit de voyage ?
Le texte des Voyages de Marco Polo fut composé à Gênes en 1298, il résultait de la collaboration de Marco Polo, un marchand vénitien revenu en Italie après deux décennies passées au service de Kubilaï Khan, et Rustichello de Pise, auteur d’un roman arthurien, Méliadus. Pourtant, malgré leur nationalité, tous deux écrivirent en français, ou plutôt en franco-italien, ce qui est bien le signe que le français, au 13e siècle, dépasse largement le cadre de l’espace restreint où il est parlé. D’autres auteurs firent alors le choix de cette langue. C’est le cas par exemple du prince arménien Hayton, qui, en 1306, se rendit à Avignon afin de rencontrer le pape Clément V et y composa La Flor des estoires de la terre d’Orient, qui se terminait par un projet de reconquête de la Terre Sainte ; mais surtout le cas d’auteurs italiens comme Brunetto Latini, Livres dou tresor, ou Martin da Canal, avec Les estoires de Venises (1275). Au long du texte de Marco Polo et Rustichello, on trouve plusieurs fois l’expression « ce qui veut dire en français », signe d’une volonté d’écrire en cette langue, même si Rustichello ne la maîtrisait pas bien.
Quelle est la nature exacte de l’ouvrage ? Aucun manuscrit ne peut être considéré comme le véritable texte et il faut prendre l’ensemble des versions qui ont circulé, en français, en toscan, en latin… Or la diversité des titres révèle une certaine ambiguïté de l’ouvrage quant à son horizon d’attente : Le Devisement du monde, Le Livre du Grand Caam, Le Livre des merveilles. L’erreur de catégorisation, selon Sharon Kinoshita (2013), viendrait de l’édition imprimée réalisée en 1559 par de Giovanni Battista Ramusio. L’inscrire dans l’ensemble constitué par les récits des voyages de découverte serait un anachronisme qui n’aurait de sens que dans le cadre de l’expansion européenne entamée à la fin du 15e siècle. Il y aurait au contraire tout intérêt à recontextualiser le livre de Marco Polo dans le cosmopolitisme mongol et dans le temps d’avant l’hégémonie européenne. Sharon Kinoshita parle même d’un « empire mondial des lettres », sur le modèle de l’expression forgée par Pascale Casanova, La République mondiale des lettres. Autrement dit, il faudrait moins considérer l’ouvrage du marchand vénitien à la lueur du Livre des merveilles de Jean de Mandeville ou du Voyage dans l’empire mongol de Guillaume de Rubrouck, qu’à celle d’ouvrages extra-européens comme L’Histoire du conquérant du monde, de l’historien perse Juvaini ; Le Livre des voyages agréables aux terres lointaines, d’al-Idrisi ; et Le Livre des routes et des royaumes d’Ibn Hawqal. Il résulte directement de l’arrimage du système économique constitué par les centres urbains de Flandre, de Champagne et d’Italie du Nord, à l’ensemble du système eufrasien centrée sur l’Empire de Gengis Khan et ses successeurs, au temps de la pax mongolica.
Deux passages pourraient être mis en avant. Le premier explique l’introduction de Marco Polo à la cour de Kubilaï Khan :
« Il arriva que Marco, le fils de messire Nicolo, apprit si bien les coutumes des Tartares, leur langue, leur écriture, leur façon de tirer à l’arc que c’était une merveille. Soyez sûrs et certains qu’il connut en peu de temps plusieurs langues et quatre de leurs écritures. Il était savant et prudent à tous égards. Aussi le seigneur lui voulait-il beaucoup de bien. » [7]
La maîtrise rapide des langues et des mœurs permit à Marco Polo d’intégrer une cour caractérisée par le cosmopolitisme (Kinoshita, 2013).
Le deuxième extrait montre à quel point la figure de Kubilaï Khan occupe une place centrale dans l’ouvrage et justifie un des titres : Le Livre du Grand Khan, qui rappelle celui de Juvaini.
« Je veux me permettre de raconter dans notre livre toute l’histoire et toutes les grandes merveilles du Grand Khan qui règne actuellement et est appelé Khoubilaï Khan, ce qui veut dire en français le seigneur des seigneurs, l’empereur. Il mérite bien ce nom et chacun doit savoir que c’est l’homme le plus puissant en hommes, terres et trésors qui ait jamais été au monde et qui soit, depuis le temps d’Adam notre premier père jusqu’à aujourd’hui. Je vais vous montrer très clairement dans notre livre que ce que je vous dis est vrai – nul n’aura rien à dire – : il est le plus grand seigneur qui ait jamais été et qui soit. » [8]
La thèse de Sharon Kinoshita est particulièrement intéressante. Délaissant l’européocentrisme traditionnel, elle s’appuie sur l’ouvrage de Janet Abu-Lughod pour appeler à provincialiser l’Europe médiévale, à remettre celle-ci à sa place de périphérie du système-monde eufrasien dont le cœur, lors de la seconde moitié du 13e siècle, est incontestablement constitué par l’Empire mongol. Car c’est bien la pax mongolica qui garantit la circulation des hommes et des biens d’un bout à l’autre du continent, et qui permet à des marchands issus de la Chrétienté européenne de parvenir en Chine, et d’en revenir. Pour certains, il y avait quelque chose d’impossible dans cette histoire. Pourtant, d’un point de vue mongol, cela en deviendrait presque banal.
Dans cette vision globale, l’ouvrage de Marco Polo et de Rustichello ne serait qu’un avatar ultra-périphérique de la production intellectuelle de l’Empire mongol tandis que le choix du français, mal maîtrisé et mâtiné d’italien, révèle l’influence exercée par la France – qui apparaît ainsi comme un foyer politique et culturel de la marge occidentale de l’Eufrasie.
Notes
[1] Par mondialisation globale, j’explicite l’expression plus commune de globalisation en la mettant en perspective avec le processus de mondialisation, plus long, plus complexe, et en soulignant la spécificité de la mondialisation qui se met en place à partir de la fin du 15e siècle : la globalité.
[2] Chrétien de Troyes, Cligès, éd. et trad. par A. Micha, Paris, Champion, CFMA, 1982, vv. 28-42.
[3] Christine de Pizan, Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V [1404], éd. S. Solente, Paris, 1940, t. II, p. 47.
[4] Jean-Christophe Cassard, 2011, L’Âge d’or capétien, 1180-1328, Paris, Belin, coll. « Histoire de France » dirigée par Joël Cornette, p. 57
[5] « La chanson de Pouille », in : Rutebeuf, Oeuvres complètes, éd. et trad. par M. Zink, Paris, Libraire générale française, 2001.
[6] « Le dit de Pouille » in : Rutebeuf, Oeuvres complètes, éd. et trad. par M. Zink, Paris, Libraire générale française, 2001.
[7] Marco Polo, 1998, La Description du monde, éd., trad. et présenté par P.-Y. Badel, Paris, Le Livre de poche, coll. « Lettres gothiques », p. 67.
[8] Marco Polo, op. cit., p. 189.
Bibliographie
David Abulafia, 2000, “Charles of Anjou reassessed”, Journal of Medieval, History, Vol. 26, No.1, pp. 93-114.
Sandro Baffi, 2008, « Martino da Canale : motivations politiques et choix linguistiques », in : François Livi (dir)., De Marco Polo à Savinio : écrivains italiens en langue française, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, pp. 35-46.
Jean-Christophe Cassard, 2011, L’Âge d’or capétien, 1180-1328, Paris, Belin, coll. « Histoire de France » dirigée par Joël Cornette.
Jean Dunbabin, 1998, Charles I of Anjou: power, kingship and state-making in the thirteenth-century Europe, Londres….
Georges Jehel, 2005, Charles d’Anjou (1226-1285) : un Capétien en Méditerranée, CAHMER Université de Picardie Jules Verne.
Sharon Kinoshita, 2007, “Deprovincializing the Middle Ages”, in : Rob Wilson et Christopher Leigh Connery (dir.), The Worlding Project : Doing Cultural Studies in the Era of Globalization, Santa Cruz / Berkeley, New Pacific Press / North Atlantic Books, pp. 61-75.
–––––, 2013, “Reorientations: The Worlding of Marco Polo”, in : Ed. John Ganim & Shayne Legassie (dir.), Cosmopolitanism and the Middle Ages, New York, Palgrave Macmillan, pp. 39-57.
Christie MacDonald & Susan Rubin Suleiman (dir.), 2014, French Global. Une nouvelle perspective sur l’histoire littéraire, trad. de l’américain, Paris, Classiques Garnier.
Marco Polo, 1998, La description du monde, éd., trad. et présenté par P.-Y. Badel, Paris, Le Livre de poche, coll. « Lettres gothiques ».
Rob Wilson et Christopher Leigh Connery (dir.), 2007, The Worlding Project : Doing Cultural Studies in the Era of Globalization, Santa Cruz / Berkeley, New Pacific Press / North Atlantic Books.