À propos de :
Atlas des empires maritimes. Une histoire globale vue des océans
Cyrille P. Coutansais, CNRS Éditions, 2013.
Ayant récemment dirigé un hors-série de Sciences Humaines Histoire consacré à « La nouvelle histoire des empires », j’ai été frappé, lors de mes lectures exploratoires du sujet, par une observation de Gérard Chaliand : si l’Inde a pu être conquise tout entière par les Britanniques, alors que les conquérants précédents (d’Alexandre le Grand aux Moghols, qui ne contrôlaient que l’Inde du Nord) s’y étaient cassés les dents, c’est qu’ils seraient arrivés par voie maritime, et non terrestre.
Voile et canons
Par un hasard amusant, l’image retenue en couverture de « La nouvelle histoire des empires » est celle d’un navire occidental des 17e ou 18e siècles, un brick peut-être (je ne suis pas spécialiste de technologie marine). En tout cas, il montre ce que Geoffrey Parker, dans La Révolution militaire (voir le billet « La guerre moderne, 16e – 21e siècles »), estime être le ressort de la puissance coloniale occidentale : au-delà de la capacité à mettre en œuvre des canons, l’habilité à les utiliser sur mer, émergeant des lignes de sabord, en ligne, au plus près de la ligne de flottaison, permettant d’envoyer par le fond tout rival assez téméraire pour s’y frotter. Des Portugais s’insérant de force dans les réseaux commerciaux de l’Asie côtière du 16e siècle aux Britanniques assiégeant la Chine au 19e siècle, les empires coloniaux européens s’imposent progressivement au monde par cette combinaison meurtrière d’artillerie et de voile (cette dernière étant remplacée tardivement par le cuirassé mû par la vapeur), comme le soulignait Caro M. Cipolla dans un livre au titre explicite : Guns, Sails, and Empires: Technological innovation and the early phases of European expansion, 1400- 1700 [Sunflower University Press, 1985].
D’Athènes à Albion, en passant par Sriwijaya et Venise, la mer a permis à des hégémonies différentes de s’imposer. N’ayant pas disposé du temps nécessaire à leur évocation dans « La nouvelle histoire des empires », je vais combler cette lacune en explorant un étonnant ouvrage : l’Atlas des empires maritimes. Une histoire globale vue des océans, de Cyrille P. Coutansais – premier atlas publié en français se revendiquant des apports de l’histoire globale.
Il est vrai que le terme empire, comme le souligne l’auteur, conseiller juridique à l’état-major de la Marine française, « évoque l’Égypte pharaonique, la Perse achéménide ou encore la Chine des Ming plutôt que les dominations crétoise, carthaginoise ou vénitienne. La raison ? Probablement une fascination pour ces grandes emprises continentales, aptes à rassembler peuples et territoires, et une méconnaissance des choses de la mer. L’apparent soft power vénitien n’a pourtant rien à envier au hard power gengiskhanide. » L’argument, en creux, ramène aussi à un paradoxe : en France, le terme empire renvoie d’emblée aux Premier et Second Empires des Napoléon, ou à l’Empire colonial d’une France successivement royaliste, révolutionnaire, impériale et républicaine – des entités qui avaient une dimension ultramarine plus ou moins affirmée, mais tenue pour périphérique.
Un empire maritime, poursuit Coutansais, est « une puissance détenant une flotte capable d’exercer sa force et son contrôle sur les mers, afin d’en maîtriser les principaux courants d’échange. » Telle quelle, elle détient ainsi une « capacité hégémonique. Si Venise peut faire face à l’Empire ottoman, elle le doit certes à sa puissance financière qui lui offre la possibilité d’armer sans cesse de nouvelles galères mais, plus encore, à son rôle d’intermédiaire obligé du commerce entre l’Orient et l’Occident. La Sublime Porte, dépendante des ressources que lui procurent ces échanges, est ainsi contrainte de se plier au bon vouloir de la Sérénissime. »
Course à l’hégémonie
On rejoint ici une notion souvent négligée, mais constitutive de la géopolitique, déjà ébauchée par Friedrich Ratzel, explorée par Karl Haushofer, systématisée par Alfred T. Mahan et rappelée par David Cosanday dans Le Secret de l’Occident (Arléa, 1997, rééd. Flammarion, 2007) : les échanges par voie maritime étant infiniment moins coûteux, plus performants en termes de volumes acheminés, moins dangereux que par route terrestre, ils amènent certaines puissances, souvent mineures, à constituer des flottes pour les contrôler – lesdites flottes nourrissant une course à l’amélioration technologique qui va leur permettre de conforter leur hégémonie naissante. La Grèce des cités va ainsi considérablement innover en matière de galère et de balistique (catapultes, balistes, pots de feu) embarquée, offrant à l’Athènes hégémonique de la ligue de Délos les outils de sa domination du bassin méditerranéen au 5e siècle av. notre ère. De même, les Hollandais des 16e-17e siècles, en butte à des puissances terrestres qui leur sont infiniment supérieures, perfectionnent l’optique (longue-vue) et l’usage de l’artillerie embarquée pour survivre et étendre leur zone d’influence. Coutansais prolonge : « Ce n’est ainsi pas un hasard si les cités maritimes de la Grèce antique (…) ont été le terreau d’autant de révolutions intellectuelles. Ces innovations et ouvertures scientifiques sont un moyen de conquérir le monde tout autant que le glaive – il n’est que de voir l’influence qu’exerce aujourd’hui le dernier empire maritime, celui des États-Unis. »
Si les routes maritimes peuvent être vitales pour les empires – Rome aurait péri sans le blé sicilien, égyptien et tunisien ; l’Espagne de Philippe II n’aurait pas été une telle puissance sans les métaux précieux des Amériques, etc. –, leur importance militaire a souvent pesé sur la victoire même quand les principaux affrontements se déroulent sur terre : la Perse défaite par les Grecs, Carthage succombant face à Rome, Napoléon terrassé par l’alliance entre Russie et Grande-Bretagne, la Chine des Qing brisée par l’irruption conjointe des puissances occidentales et de révoltes internes, Hitler tenu en échec dès le début de l’engagement par la Grande-Bretagne avant d’être défait sur terre par l’Union soviétique et les débarquements alliés en offrent autant d’exemples.
La thalassocratie se définit ainsi comme un centre, un hub « réunissant l’ensemble des ressources au service de la constitution puis de la préservation de monopoles commerciaux, et un imperium maritime jouant le rôle de démultiplicateur de puissance ». Au-delà de l’importance frumentaire et stratégique du contrôle des mers, Coutansais insiste donc sur une troisième dimension de la domination : celle de la conquête des esprits, de la civilisation phénicienne « dont l’alphabet devient celui de toutes les langues du bassin méditerranéen » à la lingua franca médiévale. Il souligne évidemment la rupture induite par la Révolution industrielle, qui pour lui prend sa source dans la maîtrise des océans : « Si l’Angleterre est le laboratoire de cette évolution, elle le doit à l’existence de marchés captifs qui encouragent la production industrielle. » La thèse n’est pas nouvelle, l’apport décisif des Indes occidentales (Amérique du Nord, Caraïbes) et des Indes proprement dites ayant déjà été amplement analysé.
Thalassocraties, de commerce et de puissance
L’ouvrage est divisé en trois parties. La première (la plus importante, 150 p. environ) s’intitule « L’ère des thalassocraties : de l’Antiquité à 1492 », la deuxième (100 p.) est titrée « L’âge des colonies : des Grandes Découvertes à 1945 », la troisième (30 p.) survole « Le temps des acteurs globaux : de la Seconde Guerre mondiale à nos jours ». Si ce découpage est incontestablement eurocentré, l’analyse l’est moins, l’auteur n’hésitant pas à varier les jeux d’échelle et à multiplier les zones étudiées dans ses textes denses, au renfort de cartes très lisibles et d’illustrations soignées. On en retiendra un bel ouvrage qui rejoint les grandes tendances de l’historiographie anglo-saxonne. Sous-tendu par une sorte de grand récit que l’on pourrait qualifier de « miracle océanique occidental », il se propose de décrire l’ascension de l’Occident vue des étendues salées, pour en arriver à la mondialisation contemporaine – incontestablement océanique, comme le soulignent une vague d’ouvrages récents portant, qui sur le rôle géopolitique du Pacifique à l’heure où les États-Unis délaissent le monde atlantique pour effectuer un redéploiement autour de leur rival chinois, qui sur la mise en containers du commerce mondial. À cette aune-là, ce livre constitue donc indéniablement une global history, dénuée de toute mise en perspective critique de la notion de supériorité européenne dans la période pré-industrielle.
La première partie (« L’ère des thalassocraties : de l’Antiquité à 1492 ») présente, outre un développement sur la « saga à part » des Vikings, le bassin méditerranéen en « laboratoire des empires maritimes ». Car il est le lieu de gestation de l’expansion européenne propulsée par les futures « Grandes Découvertes ». De la Crète minoenne (« matrice impériale » du 2e millénaire av. notre ère) aux Phéniciens (inventeurs de la « première économie de comptoirs »), puis Génois, Vénitiens… Ces puissances ont veillé à renforcer progressivement leur contrôle oligarchique des échanges, multipliant l’infrastructure des points d’ancrage sur les côtes (comptoirs, fortins, îles, rades…), « sans lesquels la navigation est impensable » faute de ravitaillement, de dépôts, de lieux de rencontres. À partir d’Athènes, les emporium qui se constituent sont autant de gigantesques pompes qui « vampirisent l’ensemble des produits rémunérateurs », captant les marchands étrangers, aspirant leurs devises. La contrepartie est la nécessité de s’organiser pour tenir les prédateurs à distance. Les opérations de Pompée en Méditerranée orientale contre les pirates valent bien par leur ampleur un affrontement interétatique. De même pourrait-on mentionner que les flottes de corsaires ou de flibustiers, à l’âge européen de la course, surpasseront parfois en effectifs et moyens leurs rivales étatiques.
Les ruptures technologiques peuvent ainsi s’effectuer dans le champ militaire, ou commercial. Le feu grégeois des Byzantins ou la caraque italienne des 14e-15e siècles, « gigantesque trois-mâts emportant sans peine un millier de tonnes de marchandise, sorte d’ancêtre de nos porte-conteneurs », révolutionnent ponctuellement les rapports de force comme les échanges, participent à l’effacement de circuits commerciaux comme à l’apparition d’autres. « Les événements mais plus encore les capacités politiques à exploiter le fait maritime sont décisifs dans la naissance, la mort ou l’avortement des empires. Les navigateurs arabes, explorateurs précoces (dès le 7e siècle) des côtes de l’Afrique orientale mais aussi de l’Inde, de l’Insulinde et de la Chine, dont les principales villes étaient dotées de fortes communautés de négociants musulmans, n’ont jamais pu convertir en puissance cette emprise commerciale, préfiguration de l’Empire portugais. » L’instabilité politique des empires terrestres d’Asie (ottoman, moghol, chinois…), liée aux problèmes de la gestion d’immenses étendues, y est pour l’auteur cruciale. L’Empire ottoman n’exploite pas le potentiel de sa flotte hors Méditerranée pour faire pièce aux ambitions portugaises au 16e siècle, et Zheng He, un siècle avant, n’a de mission que diplomatique et ostentatoire. L’avance chinoise en matière de technologie maritime, plus que manifeste au 15e siècle, est mise au placard, alors que les navires européens s’apprêtent à entrer dans les eaux pourtant sinisées de longue date de l’océan Indien : navigation sous les Han (2e siècle av. notre ère/2e siècle ap.) en Asie du Sud-Est, aux limites de la mer Rouge sous les Tang (7e-9e siècles), culminant en l’élaboration d’une puissance maritime inégalée sous les Song (9e-13e) et les Yuan (13e-14e), au service conjoint d’intérêts commerciaux et d’un « rêve d’hégémonie universelle ».
Un Monde liquide
Coutansais estime que « les Grandes Découvertes trouvent leur origine dans une soif de l’or », ce qui est quelque peu réducteur (la recherche de terres sucrières, entre autres, joue aussi un rôle), mais a le mérite de souligner le rôle de l’absence du métal jaune dans l’anomie économique dont souffre alors l’Europe. S’ensuit un résumé des progrès en matière nautique, de la caravelle à la boussole en passant par les portulans, pour culminer avec le vapeur (première traversée transatlantique en 1838) et le télégraphe. « La communication instantanée, couplée aux navires à vapeur, révolutionne la stratégie navale en permettant l’acheminement rapide des renforts. Le temps des empires mondiaux est venu. »
Avant cela, on aura eu droit à une apologie du rôle clé d’Henri le Navigateur – les sources de l’auteur auraient mérité de faire par moment mention de travaux récents qui réévaluent à la baisse le rôle supposé clé de certains éléments défendus par une histoire eurocentrée, que ce soit dans ce passage ou dans celui, antérieur, du déterminisme absolu qui verrait dans les typhons la seule cause des deux échecs mongols à envahir le Japon au 13e siècle. À sa décharge, soulignons qu’il a pleinement intégré la notion d’échange colombien exposée par Alfred W. Crosby et Charles C. Mann, ainsi que bien d’autres apports de l’histoire globale. Puis s’enchaînent, clairement exposés, les sous-chapitres évoquant : une Espagne trébuchant par chance sur les Amériques ; des Provinces-Unies instituées « fabrique du capital » ; la Ligue danoise ; Londres « impératrice des mers » ; le rôle intermittent des empires coloniaux français successifs. Avant de se clore de façon novatrice sur une évocation de la recherche de puissance sous-marine par l’Allemagne lors des deux Guerres mondiales, finalement mise en échec par le décryptage du système de communication allemand Enigma, et sur la « sphère de coprospérité asiatique » esquissée bien maladroitement par le Japon, tard-venu dans le grand jeu colonial. Au terme de ce grand jeu, s’affirme une nouvelle puissance hégémonique : les États-Unis, face à un outsider soviétique progressivement contenu, affaibli, agonisant.
Aujourd’hui, réémergence de l’Asie en général et de la Chine en particulier oblige, les géostratèges redécouvrent leurs classiques : l’océan Indien, « carrefour stratégique majeur réunissant les trois acteurs essentiels des décennies à venir : États-Unis, Chine et Inde », qui conditionne l’accès à une majeure part des hydrocarbures. L’auteur estime en conclusion qu’il est possible de dégager quelques invariants de cette histoire longue : « Maîtriser les océans offre en premier lieu la possibilité de monopoliser les réseaux d’échanges les plus lucratifs ou stratégiques. La volonté de Gênes de maîtriser les circuits de l’or rejoint celle des États-Unis, placés aujourd’hui au cœur d’un réseau intercontinental de câbles sous-marins. À l’heure des data centers et du cloud computing, la quasi-totalité des câbles trans-atlantiques mais surtout trans-pacifiques convergent vers Washington… Autre constante : la nécessité d’assurer une libre circulation des marchandises. » Nos sociétés, de par la dépendance aux échanges induite par la globalisation, sont plus que jamais liées par la mer. Qu’un axe d’approvisionnement flanche, par exemple pour cause de guerre, et des secteurs entiers de l’économie seront ébranlés. S’y ajoute une nouveauté : l’exploitation industrielle des ressources océaniques. Poissons, algues, minerais précieux, diversité génétique vitale pour les biotechnologies, énergie marémotrice des courants océaniques… Leur exploitation et leur partage, dont le droit international peine à gérer la complexité naissante, ne font peut-être qu’inaugurer une nouvelle frontière de la puissance.

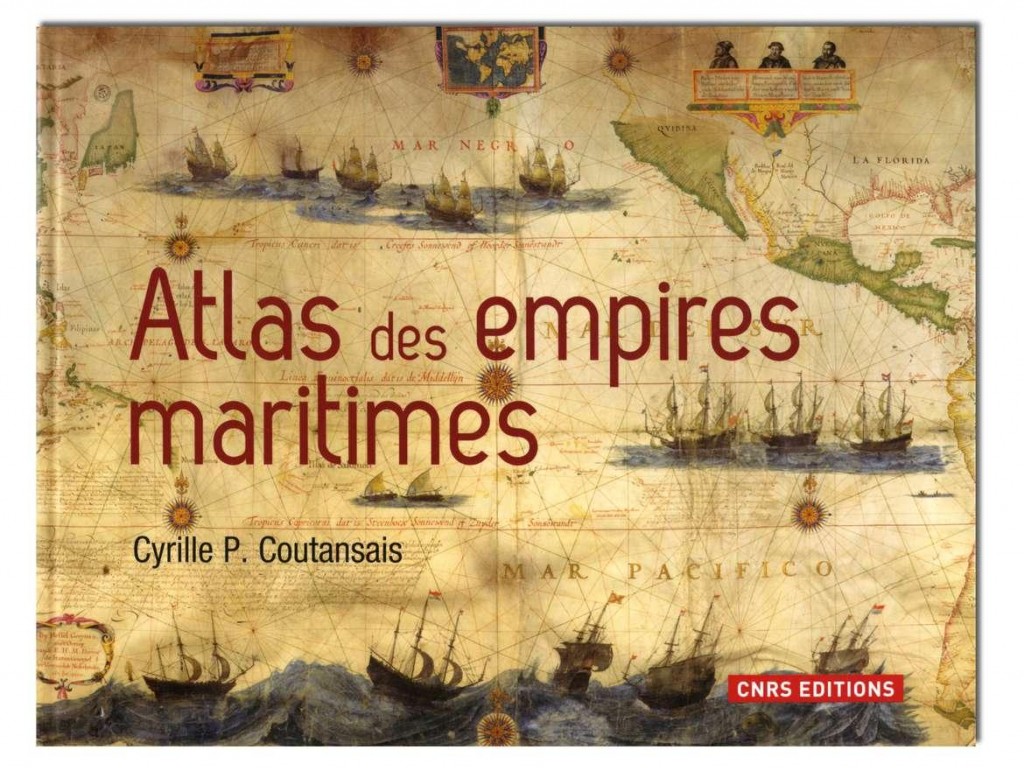
Ping : La péninsule ibérique et le monde, années 1470 – années 1640 | Pearltrees
Ping : La mer impériale (Histoire Globale) | G&...
Ping : La mer impériale | Histoire Globale | Hi...