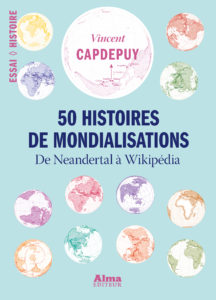Suite à la parution d’un livre expérimentant une narration spécifique d’histoire globale, nous en publions ici l’introduction.
Je suis un chien, et je vais vous raconter votre histoire.
« De quel droit ? », vous demandez-vous. Je dirais d’emblée que votre histoire a un besoin urgent. Celui d’un pas de côté pour être mieux comprise, davantage partagée. Parce qu’elle est extraordinaire. Nous autres les chiens en avons été les meilleurs témoins. Nous courons à vos côtés depuis tellement plus longtemps que les autres animaux. Grâce à vous, nous sommes de loin les carnivores de taille moyenne les plus communs sur Terre. En votre compagnie, nous avons colonisé l’essentiel des écosystèmes. Vous nous avez modelés à votre guise, ce qui nous permet d’endosser tous les rôles que vous souhaitez nous attribuer. Un costaud pour garder vos affaires ? On vous fournira un dogue de 100 kilos. Un affectueux bébé d’amour ? Prenez cette adorable boule de poils d’un ou deux kilos tout mouillé qu’est le chihuahua.
Ce n’était pas gagné ! Songez qu’il y a quelques dizaines de milliers d’années seulement, nous étions tous des loups gris, 50 kilos de sauvagerie Annales »(1). C’est que nous disposons de ressources infinies, à commencer par une plasticité génétique sans égale dans le monde des mammifères. Ce n’est pas le chat qui pourrait en dire autant, lui qui reste quasiment à l’identique de ses ancêtres sauvages. Ce pour quoi nous pouvons faire des tas de choses qu’il ne vous viendrait pas à l’idée de demander à un chat. Vous ne trouverez pas de chat sauveteur en mer, de chat d’avalanche, de chat guide d’aveugle. Ni de chat démineur, de chat de combat, de chat policier. Pas davantage de chat de traîneau. Et même quand il s’agit de traquer le rat, certains des nôtres, spécialisés, font bien mieux que ces flemmards de ronronneurs.
Je suis un chien, et je vais vous raconter votre histoire. En japonais, cette phrase pourrait commencer par la formule Wagahai wa inu de aru. Une phrase que tout écolier nippon reconnaît instantanément, car, à un mot près, elle ouvre un classique de la littérature, Wagahai wa neko de aru, signé par Natsume Sôseki. Un titre rendu en français par Je suis un chat (neko) Annales »(2). Pourquoi diable Sôseki a-t-il choisi d’élire comme témoin de la vie du Tôkyô des années 1900 un matou arrogant ? Cela reste une énigme, et un trait de génie. En toute discrétion, l’espion aux pattes de velours dissèque le comportement de ces drôles de singes que sont les humains.
Wagahai wa inu de aru peut-il dès lors se lire comme « Je suis un chien (inu) » ? C’est hélas là que se dévoile l’incommensurable barrière de la traduction, tant la formule est appauvrie. En japonais, Wagahai est une façon châtiée de dire « je ». Traduit littéralement, on obtiendrait quelque chose comme « Moi-seigneur chien je suis ». Qu’elle s’applique au chien ou au chat, la sentence résonne comme une inversion des rapports qui vous lient à l’animal. Vous autres humains êtes tellement habitués, en Europe encore davantage qu’au Japon, à nous nier toute subjectivité. Ce n’est pas faute que la science ait, ces dernières décennies, enfoncé les portes de la prison cognitive dans laquelle vous vous êtes complu à enfermer vos chères amies les bêtes. Vous savez aujourd’hui que les animaux souffrent, s’efforcent de coopérer avec vous, éprouvent de la jalousie, attribuent des intentions à autrui, ont conscience d’eux-mêmes et peuvent se projeter dans le futur…
Alors, bien que nous puissions désormais parler de cognition animale, comment puis-je me faire chien pour vous raconter notre histoire ? Un humain s’autorisant à parler à la place des canidés constitue un artifice narratif, largement expérimenté depuis au moins le 19e, sinon le 15e siècle, enrichi récemment de multiples travaux en sciences humaines Annales »(3). Pour la France, il suffit de se référer à l’historien Éric Baratay et à ses tentatives de retranscrire le vécu des animaux Annales »(4). Ou à l’anthropologue Marion Vicart, qui s’est mise, pour les besoins de sa thèse, à quatre pattes des journées entières afin de partager le vécu subjectif des chiens Annales »(5). Et qui souligne, avec malice, que ceux-ci perçoivent le monde plus vite que nous. Ce qui les rend à la fois capables de mieux observer les détails d’une action, mais aussi de ne rien voir de ce qui est statique devant leur nez. Un chien perçoit bien mieux le mouvement qu’un humain, mais échoue à scruter l’immobile.
Au fil des pages qui vont suivre, vous entendrez de nombreux discours, tous produits par des canidés. Des récits en kaléidoscopes, qui éclaireront d’un jour nouveau notre histoire. Les animaux qui témoigneront seront mentionnés en en-tête des chapitres.
Comme le rappelle Éric Baratay, l’historien Robert Delort, en 1984, appelait à bâtir une « zoologie historique, c’est-à-dire une histoire des espèces prises comme point central de repère, d’éclairage et d’analyse pour évoquer leurs relations avec les hommes mais aussi leurs évolutions biologiques, comportementales, géographiques, de même que leurs relations avec les autres espèces animales, en montrant les interactions entre les divers intervenants d’un milieu, les capacités d’initiative et d’adaptation de l’espèce étudiée et les influences sur les autres espèces, dont les hommes Annales »(6). » Cet appel ne fut guère suivi, même si Delort, de son côté, écrivit plusieurs monographies sur les criquets, les harengs et les éléphants, montrant en quoi ces animaux avaient influencé l’évolution des sociétés, tout autant qu’ils avaient été impactés par les activités humaines.
Je partage le diagnostic posé par Éric Baratay : ce désintérêt s’explique sans doute par la nécessité faite aux historiens désireux de poursuivre dans cette voie de maîtriser des sciences dites « dures », telles l’écologie, l’éthologie, la génétique. Toutes disciplines auxquelles ils préfèrent des approches plus littéraires, davantage compatibles avec une exploitation archivistique, comme l’anthropologie ou la sociologie quantitative. Mais surtout, nombre d’historiens craignent d’abandonner l’humain comme acteur de l’histoire.
L’histoire que nous écrivons est fatalement anthropocentrée. Rien de plus normal, puisque toute histoire s’écrit à partir du vécu de son narrateur. Je ne suis pas un chien, mais un journaliste. Mon expertise porte sur l’histoire, ce pour quoi je convoque aujourd’hui des conteurs canins pour la développer à nouveaux frais. Depuis 2005, je m’efforce de promouvoir en France, avec d’autres, une histoire globale/mondiale, pour l’essentiel produite aujourd’hui dans le monde anglo-saxon Annales »(7). Cette histoire appelle à travailler sur la longue durée et les grandes distances pour mieux comprendre les processus qui ont amené nos sociétés là où elles en sont. Elle repose sur une approche transdisciplinaire, associant à l’histoire la géographie, l’anthropologie, l’archéologie, l’économie, la démographie, la philosophie, les sciences de l’environnement… Ces sciences vont travailler de concert pour aborder des phénomènes sous plusieurs angles d’approche, multiplier les perspectives et fertiliser la réflexion.
L’ambition n’est pas d’écrire une histoire totale. Simplement une histoire restituant les moments-clés, les tournants qui ont fait bifurquer le passé sur de nouvelles trajectoires. Une telle histoire vise à abolir les frontières nationales (créations géopolitiques très récentes), comme à proposer des narrations dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître, mais qui exigent de prendre chair. Ce pour quoi cette histoire globale joue des échelles : les faits subjectifs, révélateurs des processus en cours, seront racontés par les yeux de témoins, en l’occurrence des chiens qui, en leur altérité, sauront mieux faire ressortir nos étonnantes manières d’animaux humains. La métahistoire, ce fleuve qui se forme dans la somme des vécus des êtres vivants en un moment déterminé, sera analysée du point de vue de Sirius, l’étoile de la constellation du Grand Chien. Étonnant hasard par ailleurs que Sirius soit aussi l’astre par excellence où devrait se positionner l’observateur distant et impartial.
À bien y réfléchir, il n’y a pas de moment de notre histoire qui n’ait été plus ou moins covécu avec les chiens. Même notre vision du monde s’est bâtie dans un lointain écho canin. Au 2e siècle de notre ère, quand le géographe gréco-égyptien Ptolémée a découpé le monde, il est parti des îles Fortunata pour poser son méridien de référence. Ces îles des Bienheureux, à l’extrémité du monde connu des Romains, étaient aussi identifiées comme les îles à Chiens, car, à en croire le naturaliste Pline l’Ancien, on y trouvait de grands mâtins agressifs. Ces îles sont dites aujourd’hui Canaries (du latin Canis, chien).
J’ai réuni en ce livre une meute d’historiens canins, qui chacun racontera son segment d’histoire. Leur chœur de gémissements, glapissements, aboiements et hurlements retissera la trame des histoires connectées de l’humanité et de la chiennerie Annales »(8). On interrogera Louve pour savoir ce que ressentent des survivants. On invoquera les esprits de ceux qui sont morts, tels Loup-Chien, le compagnon présumé de nos ancêtres préhistoriques, et Warg, qui fut la terreur de l’Ouest sauvage avant de semer une peur fictionnelle dans les Terres-du-Milieu de Tolkien. On croisera Renard, qui essaie encore de comprendre pourquoi il n’a pas été domestiqué. Ainsi que Xolo, un sacré cabot de boucherie. Dingo, le meilleur témoin de l’histoire des Aborigènes d’Australie. Bâtard, explorateur du monde interlope des « vrais chiens ». Patou le diplomate, fils de Dogue le guerrier. Akita le samouraï, témoin privilégié d’autres façons de vivre sa canitude. Lévrier, le véloce serviteur. Basset, l’esclave rôtisseur. Beagle le chasseur. Bichon le courtisan. Saint-bernard le sauveteur. Pitbull le voyou. Dalmatien la star. Et enfin Caniche, le miroir de notre humanité…
Tous ces chiens dévoileront des facettes multiples de notre histoire et donneront raison à Franz Kafka : « Seuls m’importaient les chiens, uniquement les chiens ! Car qu’y a-t-il en dehors des chiens ? À qui d’autre en appeler dans le grand vide de ce monde ? Les chiens sont tout le savoir, la somme de toutes questions et de toutes réponses (9). »
Introduction de Laurent Testot, Homo Canis. Une histoire des chiens et de l’humanité, Payot, 2018, pp. 7-11.
[1] Sauvagerie : qualifie l’état d’être « sauvage », par opposition à l’état de domestiqué, sans jugement péjoratif.
[2] Sôseki Natsume, Je suis un chat (éd. originale 1906), traduit du japonais et présenté par Jean Cholley, Paris, Gallimard/Unesco, 1978.
[3] Lire la nouvelle de Miguel de Cervantès, « Le Colloque des chiens », Le Mariage trompeur et Colloque des chiens/El Casamiento enganoso y Coloquio de los perros, Paris, Aubier/Flammarion, 1970.
[4] Lire notamment Éric Baratay, Le Point de vue animal. Une autre version de l’histoire, Paris, Le Seuil, 2012.
[5] Marion Vicart, Des chiens auprès des Hommes. Quand l’anthropologue observe aussi l’animal, Paris, Éditions Petra, 2014.
[6] Cité par Éric Baratay, Le Point de vue animal, op. cit., p. 23.
[7] Nous invitons le lecteur intéressé à se reporter à l’introduction de Laurent Testot, Cataclysmes. Une histoire environnementale de l’humanité, Paris, Payot, 2017, pour une synthèse de la démarche. Pour une analyse exhaustive, voir Laurent Testot (dir.), Histoire globale. Un nouveau regard sur le monde, Auxerre, Sciences Humaines Éditions, 2008, rééd. 2015.
[8] Chiennerie : néologisme renvoyant à l’ensemble des chiens, et par extension à la condition canine, à la manière dont « humanité » qualifie l’ensemble des humains.
[9] Franz Kafka, « Recherches d’un chien », La Muraille de Chine. Et autres récits, rédigé vers 1924, publié à titre posthume en 1936, traduit de l’allemand par Jean Carrive et Alexandre Vialatte, Paris, Gallimard, 1948, rééd. 2013.