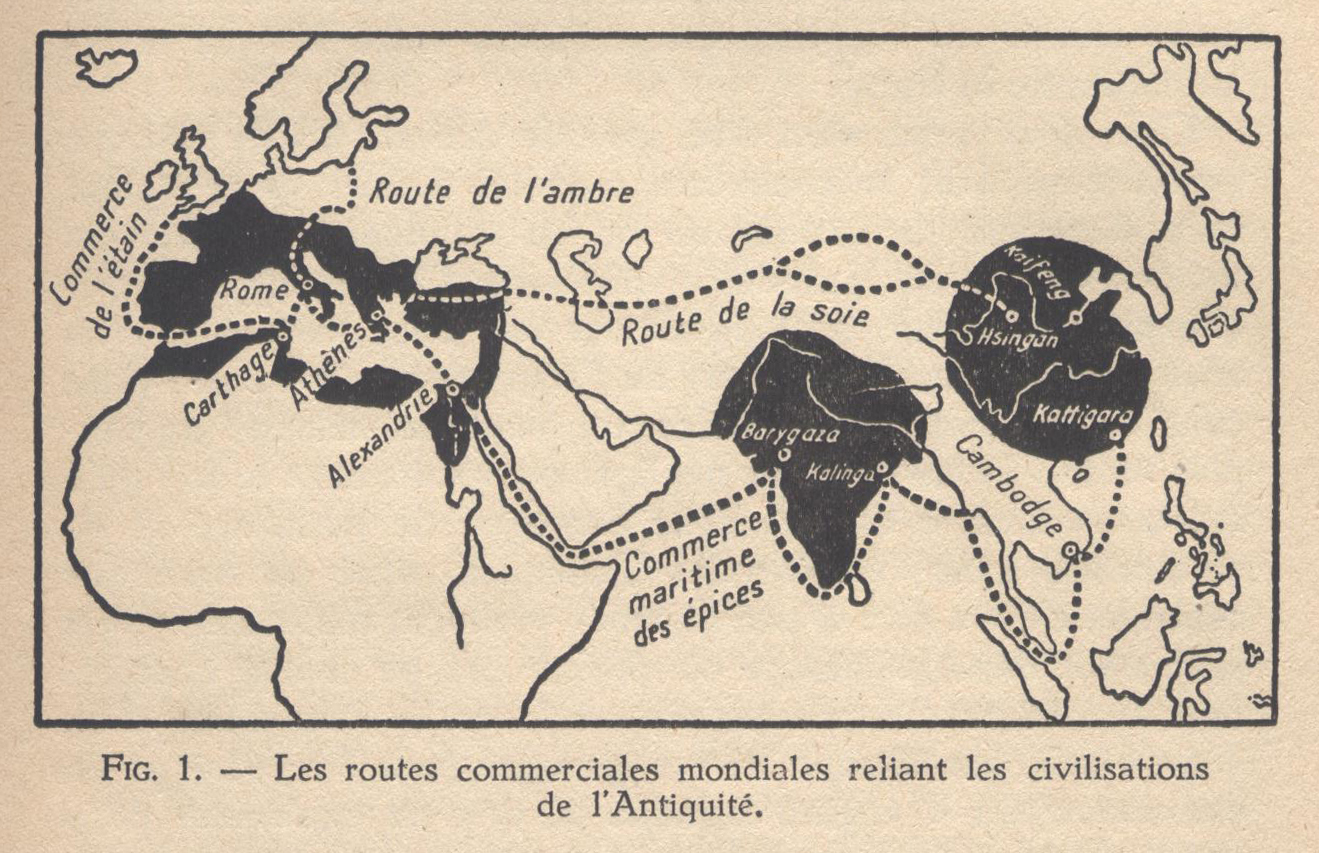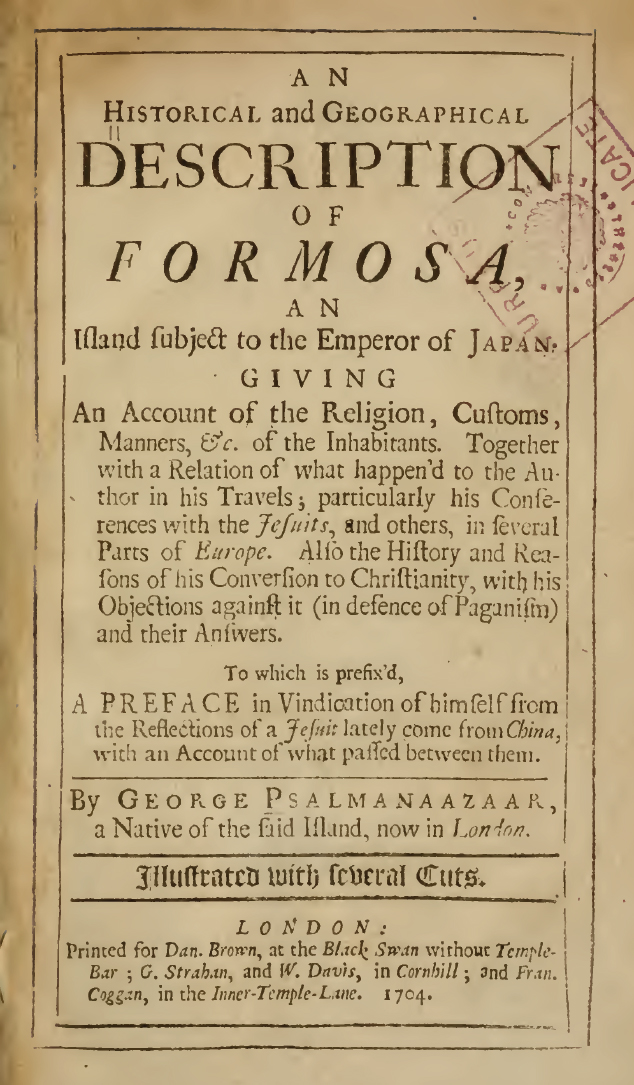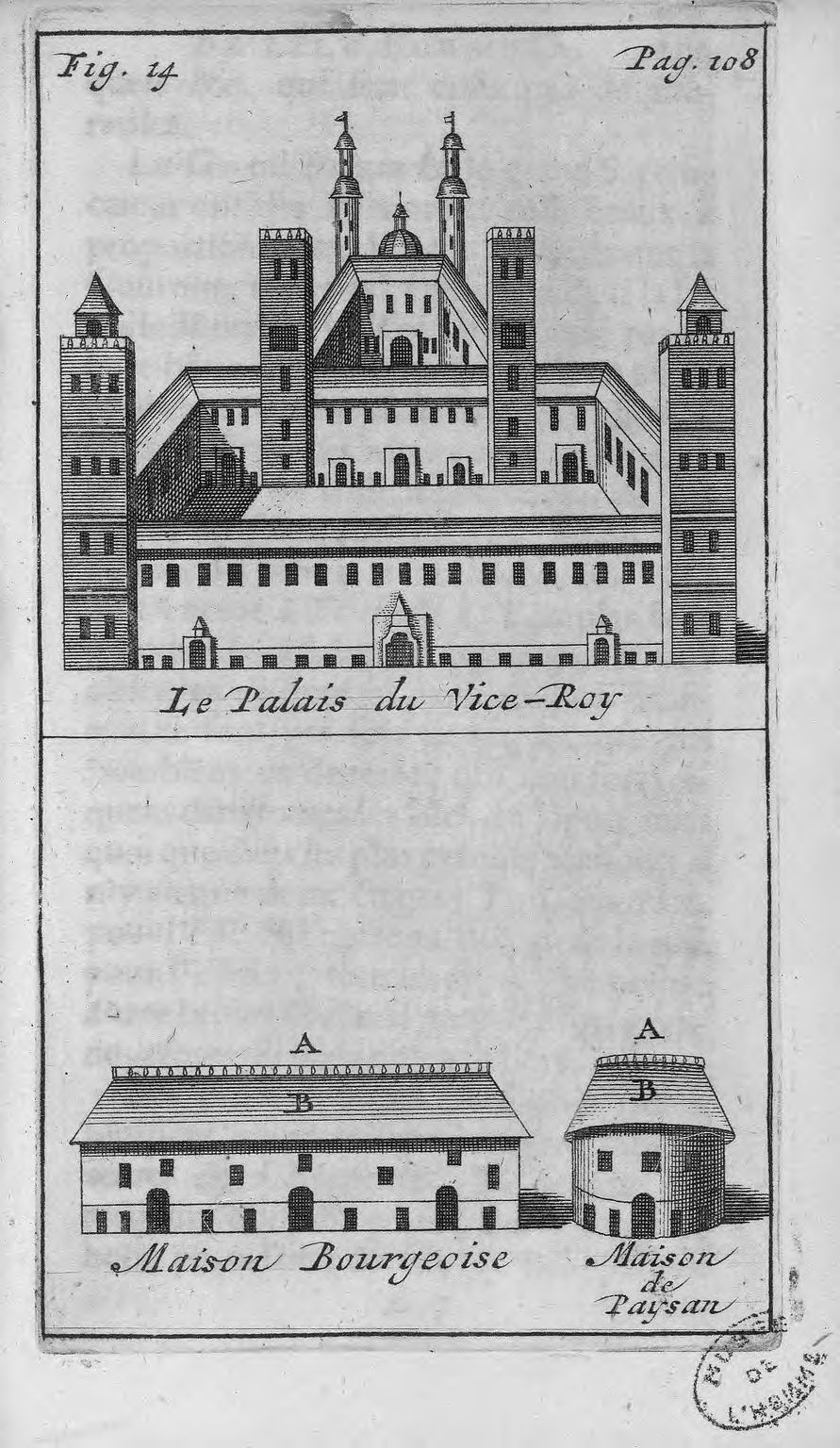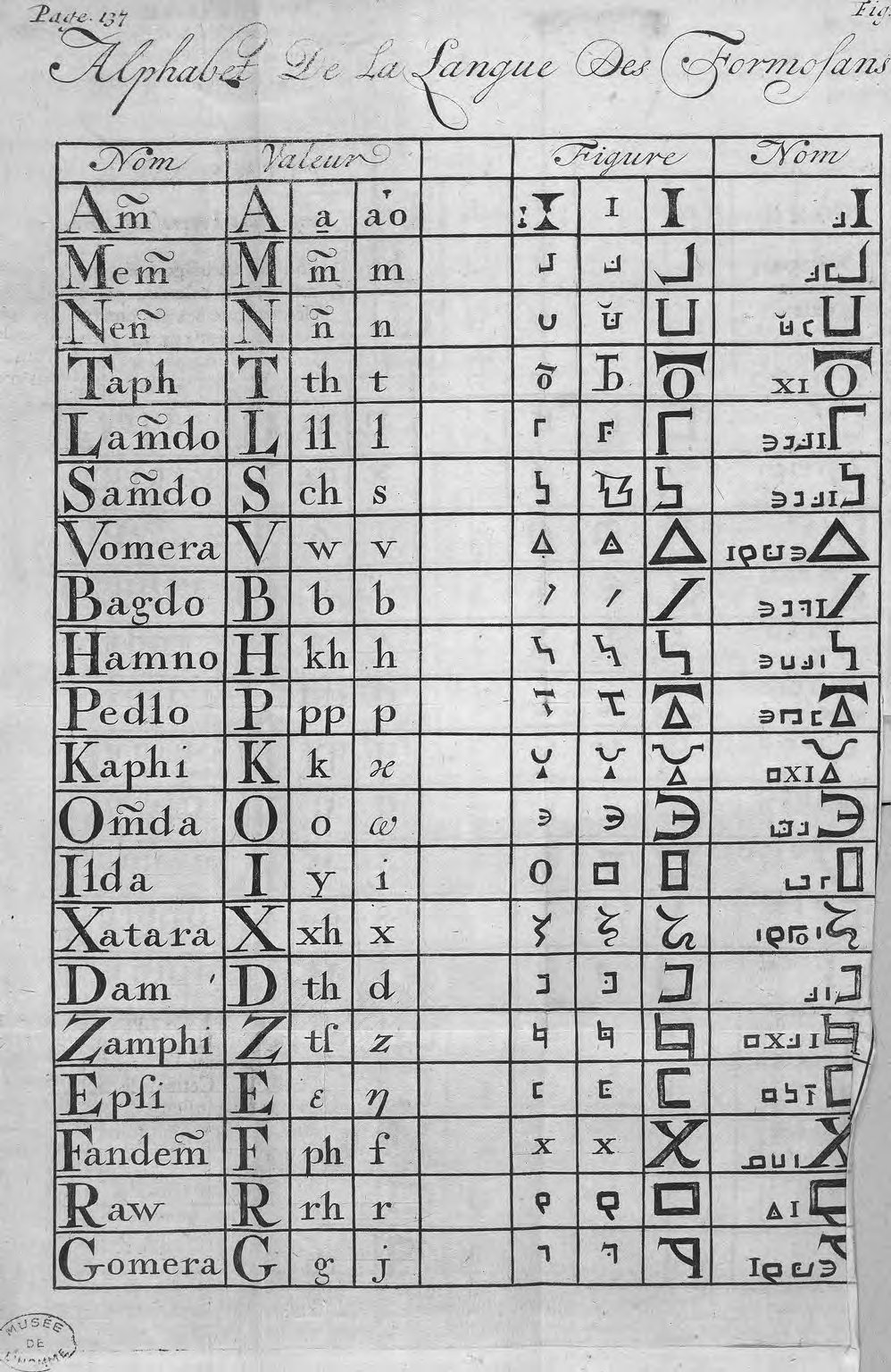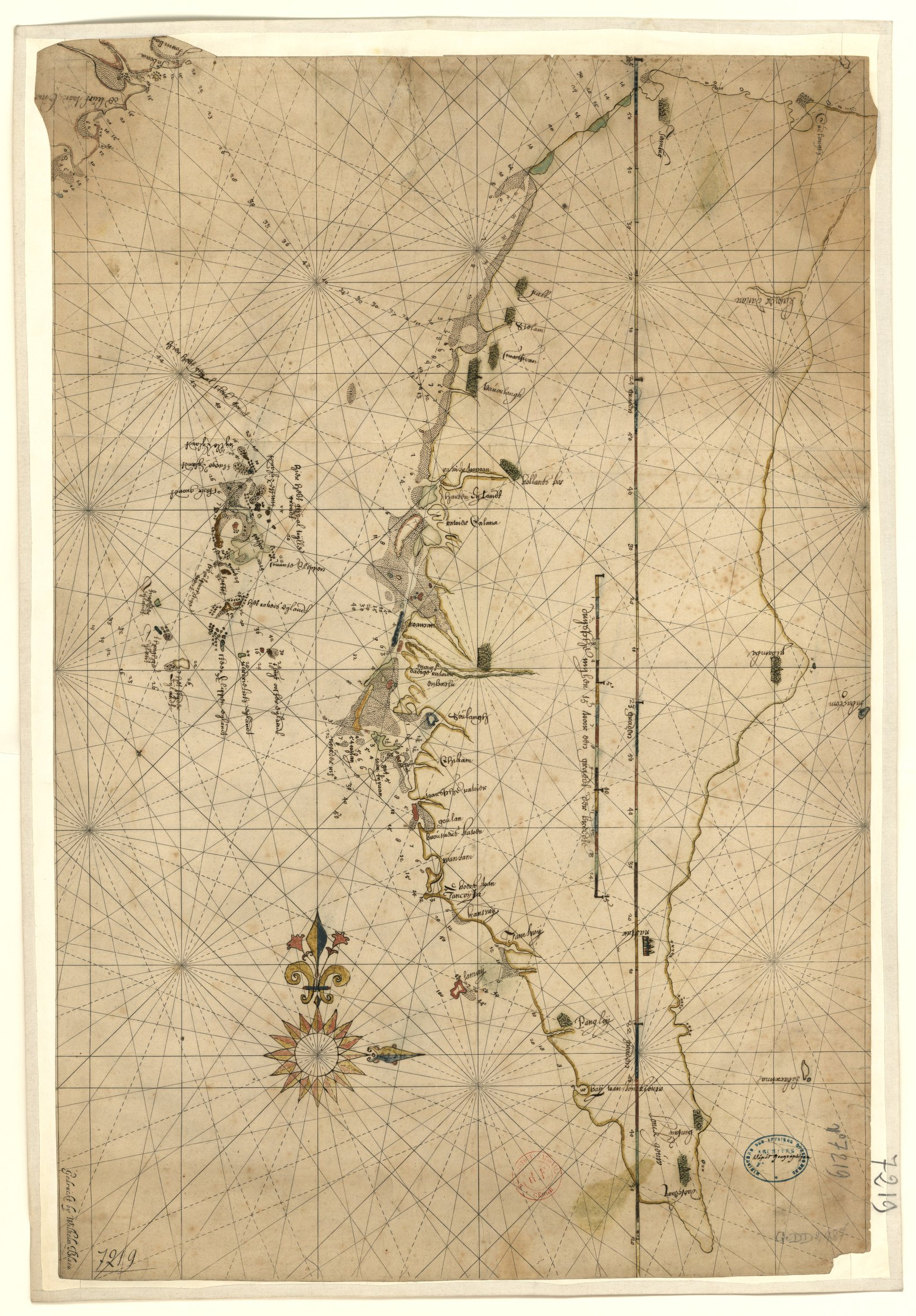« Chemin faisant, parmi les rochers, je remarquai quantité de crottes de gazelles dont plusieurs troupeaux bondissaient dans le lointain. Les excréments de cet animal ont la propriété de sentir le musc, sans doute à cause des herbes aromatiques dont il se nourrit. Les Arabes s’en servent pour composer des parfums, et les fument aussi quelquefois dans leurs pipes.
Je me suis souvent diverti à chasser les gazelles. Les habitants du désert les prennent en vie ou les tuent pendant qu’elles dorment, ou bien, montés sur leurs rapides juments ils les forcent avec leurs lévriers et leurs faucons. Les Seleibes surtout en font un carnage épouvantable, car ils se nourrissent de leur chair et s’habillent de leurs peaux. Ces Seleibes sont le rebut des Bedous, qui les méprisent souverainement et ne communiquent jamais avec eux. Ils sont petits, décharnés, mal faits et d’une physionomie tout à fait sauvage. Leur arme est le fusil à mèche ; ils habitent les replis du désert loin de toute habitation humaine. Ce sont les seuls Arabes chez lesquels on trouve des ânes, ils n’ont point d’autres animaux et ne possèdent ni chevaux ni moutons.
Autrefois, cette peuplade était fort nombreuse, mais il y a quelques années, les Wehabis, irrités de ce qu’elle s’était arrogé le droit de partager le désert entre ses familles, se sont attachés à les détruire, et il n’en reste plus aujourd’hui que quelques restes épars que la défense et la crainte rendent tout à fait inabordables. »[1]
Ce texte est extrait du récit écrit par Jean-Baptiste Rousseau (1780-1831), consul français en poste à Bassora, puis à Alep au début du 19e siècle. La scène se déroule en 1808, sur la route qui mène à Alep. Il évoque sa rencontre avec les Sleyb, ou Solubba – les orthographes sont multiples.
Si l’histoire globale a pour objet central les processus de mondialisation, on peut aussi s’interroger sur les espaces et les populations restées en marge. D’où le billet qui suit, repris pour partie d’un bref chapitre de ma thèse consacré à cette population méconnue vivant dans les steppes d’Arabie et leurs marges désertiques, et souvent méprisée par les Bédouins. Les sources sont cependant rares, et seuls les témoignages européens ont été pris en compte par les quelques études qui leur ont été consacrées.
Un des premiers textes européens que nous ayons sur cette population étrange est dû à Aaron Goodyear et Timothy Lanoy, en 1678, entre Alep et Palmyre, dont ils furent les redécouvreurs :
« Sur notre chemin, nous tombâmes sur deux Arabes avec deux ânes, l’un portant de l’eau et un peu de pain, l’autre qu’ils montaient par tour ; ils avaient un fusil, avec lequel ils chassaient l’antilope, la balle étant une pierre taillée en boule et recouverte de plomb ; ils avaient sur la paume des mains, les coudes, leurs genoux et leurs pieds, de la peau d’antilope attachée, ce qui leur permettait de mieux ramper sur le sol pour tirer ; un des ânes marchant comme un cheval d’abri, et l’Arabe imitant le cri de la gazelle jusqu’à ce qu’il soit à portée de tir : ces Arabes sont appelés Selebee. »[2]
On trouve un autre témoignage, plus ancien, dans la relation de voyage de Pedro Teixeira, mais le terme de « Sleyb » n’est pas employé. En 1604, alors qu’il a tout juste quitté Bassora, il rencontre dans le désert ce qu’il appelle des Bédouins :
« Là nous trouvâmes quelques gens qui prirent la fuite à notre vue, et dont on apprit qu’ils étaient de pauvres Bédouins, les plus pauvres des Arabes, qui erraient en familles à travers ces déserts ; nus, ou couverts de la peau des bêtes qu’ils chassaient pour vivre : daims, gazelles, ânes sauvages, loups, renards, lièvres, etc. »[3]
La description correspond assez peu à ce qu’on entend habituellement par Bédouin. Au contraire, les trois caractéristiques données renvoient précisément aux Sleyb : le fait de se déplacer en famille, et non en tribu ; le fait de vivre de la chasse, et non de l’élevage ; enfin, et surtout, le fait de s’habiller de peaux de bête, et non d’habits tissés. Teixeira mentionne ensuite à plusieurs reprises ces Bédouins, toujours décrits comme des marginaux, et jamais sujets de crainte pour les voyageurs, ce qui là encore ne correspond pas aux Bédouins arabes, dont les attaques sont en permanence redoutées.
Ulrich Seetzen, qui a rédigé une des premières synthèses sur les tribus arabes (1809), a consacré quelques paragraphes aux Sleyb, où on retrouve les mêmes éléments que précédemment :
« Dans la plaine déserte de el Hamad, on trouve des Arabes nommés Szlêb, qui mènent une vie absolument sauvage, et ne se nourrissent que des produits de la chasse. Chaque famille de cette tribu est absolument isolée des autres et occupe un espace de 4 à 5 lieues de circonférence. Les hommes et les femmes se couvrent de peaux de gazelles ou d’autres animaux ; ils ne vivent point sous des tentes comme les autres Arabes nomades, mais dans des cavernes ou fosses qu’ils creusent dans la terre, et n’élèvent ni chevaux, ni chameaux, ni moutons. Chaque famille tient seulement un âne sur lequel on charge le produit de la chasse de l’homme qui, armé d’un fusil, est obligé de pourvoir à la subsistance de toute la famille. »[4]
Par la suite, au fil du 19e siècle, les voyages à l’intérieur de l’Arabie se multiplient et offrent davantage de témoignages concernant cette population éparse. Ainsi, l’aristocrate anglaise Lady Blunt, dans le récit de son voyage à travers le désert de Syrie en 1878, consacre quelques lignes aux Sleybs, qu’elle décrit comme « les vrais enfants du Hamád, ne le quittant jamais, ni en été ni en hiver, mais suivant les troupeaux de gazelles selon qu’ils migrent vers le nord ou vers le sud »[5].
On trouve ainsi une brève présentation des Sleyb dans un rapport anonyme du ministère des Affaires étrangères français sur le Nejd, publié en 1875 dans le Bulletin de la Société de géographie. Dans le décompte démographique des tribus du Nejd, les Sleyb apparaissent comme le groupe le plus minoritaire : 600 tentes sur un ensemble évalué à 47 600 tentes, soit, « à raison de 5 habitants par tente », 3 000 habitants sur un total de 238 000 habitants[6].
Mais la présentation la plus complète est due à Charles M. Doughty, dans Travels in Arabia Deserta, qui est le récit de vingt-et-un mois passés en Arabie, entre novembre 1876 et août 1878.
« Comme nous nous rendions au mejlis, Zeyd me dit : “Je vais te montrer là-bas des vagabonds qui remontent à l’antiquité.” C’était une famille de pauvres vagabonds qui venaient d’arriver, des Solubba. […] Les Solubba vivent de la chasse et de leurs travaux de bohémiens, car ils rétament les marmites et réparent les armes, dans les menzils bédouins. Ils martèlent les hachereaux, jedūm (avec lesquels les bergers nomades émondent les branches d’acacia tendres, pour nourrir leurs troupeaux), et des faucilles pour couper le fourrage, et des lames d’acier pour faire du feu avec un silex, et bien d’autres outils. Ils menuisent en outre le bois d’acacia du désert, dont ils font de grossiers arceaux de selles pour les chameaux de bât, et des pommeaux de selles pour les thelūl, des roues de poulies (mahal) pour puiser l’eau des puits les plus profonds du désert, ainsi que des pots à lait grossiers, et autres ustensiles domestiques de même nature. Par surcroît ils pratiquent l’art vétérinaire, et dans toutes leurs activités (seulement d’un art plus frustre) on peut les comparer avec la caste des forgerons ou Sunna. Les Solubba obéissent au précepte de leur patriarche, qui leur a fait défense de posséder du bétail et leur a prescrit de vivre du produit de la chasse dans le désert, de descendre devant les abris des Bédouins, pour s’en faire inviter, et de travailler comme forgerons dans les tribus pour gagner leur vie. Ne possédant pas de bêtes laitières, ils demandent, où qu’ils se trouvent, du lait, aux tentes bédouines. La maîtresse de maison versera du leban de sa semīla aux pauvres Solubba, mais dans leurs bols à eux, car les Bédouins, autrement peu pointilleux sur ce chapitre, ne boiront pas volontiers après des Solubbis, qui pourraient avoir mangé de quelque futīs, ou créature morte de mort naturelle. Les Bédouins disent aussi d’eux, “ils mangent des insectes immondes et des serpents”. Ces mauvaises langues de Beduw les qualifient inconsidérément de “kuffār”, parce que peu de Solubbis sont capables de réciter les prières habituelles, mais les Bédouins ne sont guère mieux traités dans les villes. Les Solubba témoignent d’un zèle humble et louable pour la religion du pays dans laquelle ils sont nés et n’en connaissent pas d’autre. Ils sont tolérants et, à leur façon misérable, humains, étant eux-mêmes méprisés et opprimés.
En été, lorsque les Beduw n’ont plus de lait, les Solubba chargent leurs légères tentes et leurs ustensiles de ménage, avec ce qu’ils ont gagné, sur des ânes, qui sont tout leur bétail, et quittant le campement des Arabes, ils entreprennent leur voyage annuel dans la vaste khala. La famille Solubbi va alors s’installer à l’écart, auprès de quelques puits abondants, dans un désert qui n’est pas fréquenté, mais où il y a du gibier. Eux seuls (de tous les hommes) sont libres de voyager dans les déserts d’Arabie, partout où il leur chaut, versant à tous un tribut symbolique, sans que quiconque les maltraite. Bien qu’ils soient natifs du pays, aucune citoyenneté ne leur est reconnue dans la Péninsule. Pas un Bedouwi, dit-on, ne volera un Solubbi, le rencontrerait-il seul, dans la profondeur du désert, et avec une peau d’autruche dans la main, qui vaut le prix d’un thelūl. Mais le voyageur beduwi serait bien aise d’apercevoir l’abri d’un Solubbi, dressé sur quelque point d’eau isolé, et d’escompter y manger du contenu de sa marmite de chasseur. Même lorsqu’ils chassent, ils vont à dos d’âne. C’est aussi sur ces chétives brutes, qu’il faut abreuver de deux jours l’un, (à part cela l’âne est à peine moins une bête du désert que le chameau) qu’ils parcourent avec leur famille de vastes régions sans eau, où le Beduwi monté sur son véloce et puissant thelūl, endurant la soif trois jours, ne passerait pas aisément. Ces petits clans dispersés d’hommes du désert en Arabie, surpassent le Beduw dans tous les arts de la piste, autant que ces derniers devancent les villageois arriérés des oasis. Les Solubba (de misérables ignorants en toute autre chose) se transmettent de père en fils une science du terrain qui leur permet de retrouver les moindres points d’eau. Ils vagabondent sur l’immense face de l’Arabie, des hauteurs de la Syrie jusqu’à el-Yemen, au-delà d’et-Taïf, et Dieu sait combien plus loin encore ! De tout ce qui est dans leur entendement de rats, me disent les Arabes, c’est auprès d’eux qu’un homme peut le mieux s’enquérir.
Il faut qu’ils soient des chasseurs très expérimentés, pour pouvoir se nourrir dans une terre morte, où c’est à peine si les autres hommes seraient capables de voir la trace d’un gibier, alors qu’eux, les pauvres Solubbis, ils font souvent bouillir de la tendre chair de gazelle et de bedūn, et dans certains districts sablonneux, d’antilope. Partout ils connaissent les pistes et le vol de leurs proies. Ce sont les Beduw qui en disent ces merveilles. Ils disent, “Les S’lubba sont comme les bergers du gibier sauvage, car lorsqu’ils en voient une troupe ils peuvent les séparer et choisir parmi eux comme si c’était un troupeau, et disent ‘Ceux-ci seront pour aujourd’hui, quant à ces autres têtes-là, nous les attraperons après-demain’ ” Il est humain de magnifier et de plaisamment s’émerveiller, cette façon empathique de parler appartient à la magnanimité des Arabes, mais il est indéniable que les Solubba sont d’admirables voyageurs et des hommes hardis, zélés, comme de vivre de leurs deux mains, et ceux d’entre eux qui ont la vue la plus perçante sont de très excellents chasseurs. Outre le nom propre de leur nation, les Solubba ou Sleyb, en ont d’autres qui sont des épithètes. À l’ouest de Hāyil, on les appelle plus souvent el-Khlūa ou Kheluīi, “les délaissés”, parce qu’ils vivent séparés des Kabāil, n’ayant ni bétail ni compagnons, mot que les Beduw s’appliquent à eux-mêmes, lorsqu’au cours d’un voyage, ne trouvant pas de menzil aarabe, ils doivent s’allonger pour dormir comme des “solitaires” dans la khala vide. Ils sont appelés aussi bien dans la langue méprisante de ce pays, Kilāb el-Khala, “les chiens du désert”. El-Ghrunemi est le nom d’un autre groupe de Sleyb du Nejd oriental, et on dit qu’ils ne se marient pas avec les précédents. Les Arabes les supposent communément descendre tous de quelque ancienne race. »[7]
Charles Doughty narre également les débats qu’il a eus avec des Bédouins et avec des Solubbas à propos de l’origine de ceux-ci. La question laisse place à diverses réponses dont il ressort que personne n’en sait rien. Le Major Holt, qui explora l’Arabie du Nord au début des années 1920, rapporte un mythe que lui avait raconté son guide, Faraj, à propos de sa tribu. Lorsque dans le passé Allah eut divisé le grand désert parmi les cheikhs, le chef des Sleybs était absent et il n’eut donc rien. Quand il se réveilla et apprit la nouvelle, il vint voir Allah regrettant amèrement sa perte et demanda à avoir une part du monde. Allah lui dit que comme la Terre avait déjà été partagée, les Sleybs ne pouvaient avoir aucune part, mais en consolation ils auraient comme lot de vagabonder dans tout le monde en paix et libre de toute molestation (Holt 1923).
Le mandat français est l’occasion de nombreuses enquêtes ethnographiques. Le capitaine Raynaud et le médecin-major Martinet, officiers du Contrôle bédouin, dans leur étude des populations bédouines de la mouvance de Damas, publiée en 1922, dresse une riche synthèse, et repose notamment le problème de l’origine des Sleybs. Il rappelle ainsi que selon une version, les Sleybs seraient les descendants de musiciens indiens qui auraient fui la cour de Bagdad au moment de l’entrée de Tamerlan, ce qui les apparenterait aux Bohémiens. Une autre version en ferait les descendants des croisés : salib en arabe signifiant « la croix ».
De cette synthèse, je ne retiendrai qu’un passage, sur la danse des femmes, réputée très libérée :
« Alors que chez tous les autres bédouins, les femmes, sans nous fuir, se tiennent à l’écart en permanence, ici, c’est à grande peine que nous pûmes nous frayer un passage à travers les rangs serrés et profonds où les femmes Sleib n’étaient pas les dernières à satisfaire leur curiosité.
Il nous fut donné d’assister à une exhibition chorégraphique dont le souvenir charmant restera longtemps gravé en nous.
Par une belle fin de soirée d’un beau jour de juin, à l’heure où le soleil à moitié disparu derrière la montagne, ne regarde plus que d’un œil mi-clos la plaine qu’il illumine encore et que la brise fraîche qui s’élève alors fait doucement clapoter les cordages le long des tentes, un spectacle s’offrait à nos yeux émerveillés.
[…]
Deux des plus jolies femmes du campement, moulées dans leur sarrau de toile bleue, suivies de deux jouvenceaux Sleib pénétrèrent dans le cercle enchanté. Leur chevelure dénattée et épanouie en fines boucles ondulées, auxquelles un soupçon de henné a donné un ton discret de cuivre rouge, leur tombe jusqu’à la taille.
Les mouvements des hanches, des bras et des jambes, sont pauvres dans cette pantomine du baiser, la tête joue le rôle principal et cela suffit au régal des yeux. Les boucles folles et brunes suivent docilement tous les caprices de la tête qui se dresse tantôt face au ciel, qui s’incline tantôt à droite, tantôt à gauche se pliant elle-même à la cadence du chant que piaillent maintenant toutes les bouches féminines du camp. »[8]
Figure 1. Danse d’une femme Sleyb (Montagne, 1947)
Mais déjà, l’usage du textile notamment révèle l’intégration de cette population et annonce la fin de cette culture.
Plusieurs auteurs ont tenté d’élaborer une réflexion historico-anthropologique sur la base des quelques connaissances que nous avons sur cette population (Betts 1989, Simpson 1994). Il serait notamment très tentant de faire des Sleyb les derniers représentants des chasseurs ayant vécu des millénaires auparavant, une population-témoin d’un genre de vie antérieur à la « grande bifurcation » de la sédentarisation et de la domestication agro-pastorale. Mais l’idée serait immédiatement à nuancer, voire à réfuter. Leur utilisation de l’âne par exemple serait à la fois un signe de leur archaïsme, par rapport aux nomades qui utilisent chevaux et chameaux, et la preuve que celui-ci permettait de se déplacer dans le désert avant la domestication du dromadaire. Rien ne vient étayer l’hypothèse d’une origine très ancienne, rien ne pourrait prouver la généalogie directe entre les Sleyb et une population vivant quelques millénaires plus tôt. On peut simplement faire le constat qu’il y a une parenté dans le genre de vie et considérer qu’il y a une permanence de celui-ci dans les marges du désert syro-arabique, tout en soulignant que cela ne signifie pas l’absence de relations et de modernisation, puisque dès le 17e siècle les Sleyb semblent avoir adopté le fusil pour chasser (cf. supra le texte de Goodyear et Lanoy) et qu’ils viennent parfois en ville comme en témoigne Clément Huart au début du 20e siècle :
« La tribu des Çolaïbiyyé dont les seuls vêtements sont des peaux de gazelles séchées au soleil, et qui s’en vient de fort loin vendre dans les soùqs de Damas les gazelles qu’elle a tuées à la chasse ; c’est le Bédouin le plus misérable qui se puisse imaginer, et il est facile de se représenter, une fois qu’on a vu ces pauvres êtres, ce que pouvait être l’existence des chasseurs de lézards aux aventures desquels les lettrés de Bagdad se délectaient, au dixième siècle de notre ère. »[9]
L’exemple des Sleyb illlustre la possibilité d’une population extrêmement marginalisée dans l’isthme central de l’Eufrasie, c’est-à-dire dans un espace traversé depuis des millénaires par des processus de mondialisation. Certains lecteurs ne manqueront évidemment pas de trouver ici un écho au livre de James C. Scott, récemment traduit en français, Zomia, là où l’État n’est pas. La steppe syro-arabique, la badia, peut-elle être considérée une région anti-étatique, pour ne pas dire anarchiste ? De fait, l’Arabie Saoudite est sans doute un des derniers États créés ; il est officiellement reconnu en 1932. Mais il faudrait prendre en considération l’ensemble de la culture bédouine. Or, dans l’opposition binaire, un peu schématique, entre population nomade, rétive à l’organisation étatique, et population sédentaire, intégrée dans des États, les Sleyb constituent une véritable population interstitielle qui échappe en grande partie à notre connaissance. Il est étonnant de constater à quel point cette altérité radicale perdure jusqu’au 20e siècle. Ce qui ne signifie pas que ce groupe n’a pas d’histoire, mais pour l’heure, avouons qu’elle nous échappe et nous intrigue, et constatons simplement ce que sa disparition révèle de la force de la mondialisation contemporaine en termes d’intégration et d’uniformisation.
Bibliographie
Betts A., 1989, « The Solubba : Nonpastoral Nomads in Arabia », Bulletin of the American Schools of Oriental Research, N° 274, pp. 61-69.
Blunt A., 1879, Bedouin Tribes of the Euphrates, New York, Harper & Brothers.
Capdepuy V., 2010, Entre Méditerranée et Mésopotamie. Étude géohistorique d’un entre-deux plurimillénaire, mémoire de thèse, Paris Diderot.
Doughty C.M., 2002, Voyages dans l’Arabie déserte, trad. de J.-C. Reverdy (éd. originale 1888), Paris, Karthala.
Goodyear A. & Lanoy T., 1707, « An Extract of the Journals of two several Voyages of the English Merchants of the Factory of Aleppo, to Tadmor, anciently called Palmyra », in Miscellanea Curiosa, Vol. III, Londres.
Holt A.L., 1923, « The Future of the North Arabian Desert », The Geographical Journal, Vol. 62, N°4, pp. 259-268.
Huart C., 1912, Histoire des Arabes, Paris, Geuthner.
Montagne R., 1947, La civilisation du désert. Nomades d’Orient et d’Afrique, Paris, Hachette.
Raynaud & Martinet, 1922, Les bédouins de la mouvance de Damas, Beyrouth, Délégation française de Damas, Contrôle bédouin.
Rousseau J.-B., 1899, Voyage de Bagdad à Alep (1808), éd. par L. Poinsot, Paris, J. André.
Scott J.C., 2013, Zomia, ou l’art de ne pas être gouverné, trad. N. Guilhot, F. Joly, O. Ruchet (éd. originale 2009), Paris, Seuil,.
Seetzen U.J., « Mémoire pour servir à la connaissance des tribus arabes en Syrie et dans l’Arabie déserte et pétrée », Annales des voyages, de la géographie et de l’histoire, 1809, Tome VIII, Cahier 22.
Simpson S.T., 1994, « Gazelle-Hunters and Salt-Collectors: A Further Note on the Solubba », Bulletin of the American Schools of Oriental Research, N° 293, pp. 79-81.
Teixeira P., 1902, The Travels of Pedro Teixeira, trad. de W.F. Sinclair, Londres, Hakluyt Society.
Notes
[1] Jean-Baptiste Rousseau, Voyage de Bagdad à Alep (1808), éd. par L. Poinsot, Paris, 1899, pp. 112-113.
[2] Aaron Goodyear & Timothy Lanoy, « An Extract of the Journals of two several Voyages of the English Merchants of the Factory of Aleppo, to Tadmor, anciently called Palmyra », in Miscellanea Curiosa, Vol. III, Londres, 1707, p. 122.
[3] Pedro Teixeira, The Travels of Pedro Teixeira, trad. de W.F. Sinclair, Londres, 1902, p. 36.
[4] Ulrich J. Seetzen, « Mémoire pour servir à la connaissance des tribus arabes en Syrie et dans l’Arabie déserte et pétrée », Annales des voyages, de la géographie et de l’histoire, 1809, Tome VIII, Cahier 22, p.293.
[5] Anna Blunt, Bedouin Tribes of the Euphrates, New York, 1879, p. 326.
[6] Anonyme [Communication du ministère des Affaires étrangères, direction des Consulats et affaires commerciales], 1875, « Histoire de la fondation, en 1824, de la ville de Riad, capitale actuelle du Nedjd, et description géographique de ce pays », Bulletin de la Société de géographie, 6ème série, Tome 10, p. 76.
[7] Charles M. Doughty, Voyages dans l’Arabie déserte, trad. de J.-C. Reverdy (éd. originale 1888), Paris, 2002, pp. 367-370.
[8] Raynaud & Martinet, 1922, Les bédouins de la mouvance de Damas, Beyrouth, Délégation française de Damas, Contrôle bédouin, pp. 33-34.
[9] Clément Huart, Histoire des Arabes, Paris, 1912, Tome I, p. 36.