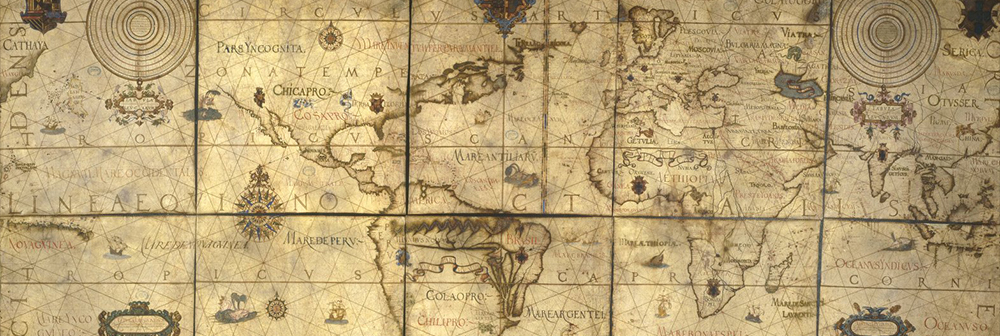Troisième partie de « Histoire globale, pensée globale », texte constituant l’introduction du dernier livre d’Alessandro Stanziani, Les Entrelacements du monde. Histoire globale, pensée globale (XVIe-XXIe siècles), CNRS Éditions, 2018.

Comparaison vs connexions
La globalisation des dernières décennies est en grande partie à l’origine de l’émergence de l’histoire globale ; inversement, cette dernière prend pour objet d’étude la globalisation. Si tous les observateurs s’accordent sur le caractère nouveau et massif de cette mondialisation, les avis divergent sur ses temporalités : quand tout cela a-t-il commencé (15) ?
Plusieurs auteurs soulignent la rupture majeure de la fin de la guerre froide, avec la mise en place d’une économie unique et dérégulée. Selon eux, la globalisation serait un produit des trente dernières années (16). D’autres, cependant, font remarquer que cette dynamique avait commencé plus tôt, pendant les années 1970, avec la fin de la décolonisation, les chocs pétroliers et la crise de l’État social, mais aussi avec le succès du néolibéralisme (17). D’autres encore ajoutent que la crise de 1929 était déjà un phénomène mondial ; ils en trouvent les origines dans les mouvements financiers d’après 1918, voire dans la période courant entre 1870 et 1914. À cette époque, les bourses, l’essor des communications et des moyens de transport avaient déjà initié un mouvement planétaire, touchant les personnes (migrations mondiales), les biens et les informations elles-mêmes (bourse des valeurs et bourse commerciale (18)).
Poursuivons cette quête des origines de la mondialisation et remontons encore plus loin dans le temps. Certains historiens repèrent en effet une première globalisation et donc une unification des échelles temporelles dès la naissance du capitalisme industriel, au tournant des 18e et 19e siècles. Cette démarche est même poussée plus avant par les partisans de la « longue durée », qui identifient une première globalisation au 17e siècle, à la suite des Grandes Découvertes, de la colonisation, mais aussi des progrès scientifiques, dans le domaine de la navigation en particulier (19).
Bien entendu, plusieurs médiévistes se sont empressés de montrer que des connexions tout aussi importantes étaient à l’œuvre dès le 12e siècle, en Europe et ailleurs (20). Les spécialistes de l’Antiquité ont répliqué en soulignant l’importance des échanges et transferts globaux durant l’Antiquité, tandis que les spécialistes du Néolithique et même du Paléolithique sont arrivés à la même conclusion au sujet de leur période de prédilection (21).
De nos jours, tout est globalisation. La globalisation en tant que catégorie prend de nos jours le rôle que la modernisation jouait à l’époque de la décolonisation (22). Tout était modernisation alors et tout est globalisation de nos jours, sans qu’on sache véritablement expliquer en quoi ce phénomène consiste. En réalité, l’histoire de la globalisation recoupe souvent une histoire européocentrique qui fait de l’essor de l’Occident son objet et argument principal, voire unique. Faire l’histoire à rebours attire davantage de lecteurs en accordant au temps présent et à ses préoccupations une valeur atemporelle, valable pour l’ensemble de la planète à toute époque. C’est oublier l’importance des choix et des bifurcations en histoire : sommes-nous certains que le monde était destiné à être globalisé ?
C’est précisément cette préoccupation qui est au cœur du débat sur la « grande divergence ». Le succès de l’ouvrage de Pomeranz est un sujet d’étude en soi. Au fond, d’autres ouvrages précédents avaient avancé des arguments similaires, celui de Wong et surtout celui de Bozhong Li, publié en Chine dès les années 1980, puis traduit en anglais (23). Mais Pomeranz a bénéficié d’un titre accrocheur et du succès rencontré auprès des économistes (24). Ce sont ces derniers qui font connaître cet ouvrage aux historiens et à un public généraliste, mais ce succès est aussi conjoncturel : au tournant du dernier millénaire, la Chine revient avec force sur la scène mondiale. Le temps n’est plus à une confrontation entre capitalisme et communisme, mais entre des formes différentes de capitalisme. C’est surtout la confrontation entre Occident et Asie, bien plus tendue qu’à l’époque de l’émergence du Japon et des « tigres asiatiques », dans la mesure où la Chine se pose d’emblée comme un concurrent redoutable des puissances occidentales et, qui plus est, hors de leur influence géopolitique. C’est dans ce cadre que les historiens, au même titre que les politologues et les économistes, commencent à s’intéresser à la Chine. Comment expliquer son retour rapide au rang de puissance mondiale ?
Depuis Max Weber, l’image conventionnelle de la Chine en Occident mettait l’accent sur les « insuffisances » en termes de protection de la propriété privée et de la concurrence et, au contraire, sur le rôle omniprésent et prédateur de l’État. Weber reliait ces caractéristiques au confucianisme, sans toutefois que ni lui ni d’autres après lui n’eussent jamais pu prouver ce lien. De manière tout aussi superficielle, de nombreux politistes et observateurs se sont également mis à expliquer le grand bond de la Chine au cours des dernières décennies à partir précisément du confucianisme qui, selon eux, inciterait à travailler sans se plaindre et à accumuler. Ce genre d’observations aurait sa place dans une brasserie ; dans une salle d’université ou une revue spécialisée, c’est différent. Voici alors que, face au paradoxe chinois, vers la fin des années 1990, des ouvrages d’histoire économique et sociale proposent une image tout à fait différente de la Chine et de son histoire : leurs auteurs montrent que la Chine d’avant le 19e siècle n’était pas hostile au marché, mais que, tout au contraire, elle était encore plus « capitaliste » et concurrentielle que la Grande-Bretagne. Ces éléments auraient donné vie à une croissance économique qui, contre les arguments conventionnels, n’aurait pas « divergé » de la croissance européenne au 16e siècle, mais bien plus tard, à partir du 19e. Cet écart ne s’explique pas par les mentalités ou les institutions (l’État en particulier) chinoises, mais tout simplement par une dotation différente en ressources. L’Angleterre bénéficiait de bassins de charbon et de fer à côté de rivières facilement navigables, alors que les mines chinoises, se trouvant loin des cours d’eau, étaient très difficiles à exploiter. De plus, la Grande-Bretagne aurait profité des marchés et des ressources américaines, donc de son empire puis post-empire colonial, alors que la Chine n’avait pas d’équivalent en Asie (25).
Ce n’est pas un hasard si les débats très vifs autour de l’ouvrage de Pomeranz ont focalisé l’attention sur les données quantitatives et les estimations des revenus par tête en Chine et en Angleterre, puis, progressivement, en Inde, au Japon et dans d’autres pays européens que l’Angleterre. Des légions d’économistes et leurs étudiants se sont évertués à trouver et analyser des données, à multiplier les estimations sans toutefois jamais se poser la question de leurs sources (26). Outre les problèmes sérieux que posent ces données prises telles quelles, cette attention obsessionnelle accordée à la croissance économique a conduit à ignorer les problèmes de distribution et d’inégalités à l’intérieur de chaque pays et entre les pays. L’enthousiasme pour la globalisation, vue pendant les années 1990 comme un facteur de bien-être pour l’ensemble de l’humanité, était bien à l’origine de cette posture. Les années suivantes ont balayé cette confiance. Le problème est que, malgré ses prémisses, la « grande divergence » renverse les thèses de Weber mais en garde les postulats principaux et donc, son européocentrisme. Pomeranz explique la dynamique chinoise à partir des mêmes critères que ceux utilisés par les autres historiens pour expliquer la suprématie européenne, à savoir l’essor démographique, la protection de la propriété privée, la dynamique commerciale et proto-industrielle (27). Autrement dit, il reste tributaire du modèle idéal anglais, fait de privatisations des terres communes, prolétarisation, industrialisation, esprit bourgeois et individualiste, etc., et il l’élargit ensuite à la Chine. Le débat sur la grande divergence est donc le résultat de la pensée unique et de la chute du Mur : il existe un seul modèle du développement, celui du capitalisme idéal. Ce débat reflète parfaitement l’enthousiasme pour le capitalisme comme seule voie vers la modernité des années 1990. Les différences entre les pays renvoient à leurs dotations respectives en ressources, tandis que des institutions partout uniformes (protection de la propriété privée, de la concurrence) garantissent le bien-être universel.
C’est une des raisons pour lesquelles de nombreux sinologues ont critiqué cette approche et accusé Pomeranz de gommer les spécificités de la Chine (28). Nous trouvons là un « mur contre mur » tout à fait emblématique : d’un côté, l’accent mis sur la connaissance des langues et du savoir local, qui finit par mettre en avant la « spécificité » d’une aire, jamais réellement définie (29). D’un autre côté, l’ambition d’imposer une seule et même méthode, qualifiée de scientifique, sans trop de sources solides à l’appui. Singularité et spécificité des langues et des civilisations contre « scientificité » d’un modèle (30). Voilà un des enjeux méthodologiques fondamentaux de l’histoire globale : afin de comprendre le monde, faut-il s’appuyer sur la connaissance des langues et des « cultures », ou bien sur un schéma interprétatif général ?
Afin de dépasser ces interprétations concurrentes, deux possibilités se présentent à nous. La première invite à regarder de près les valeurs et catégories des pensées non occidentales, par exemple le bouddhisme, l’hindouisme, l’islam… Une seconde option consiste à mettre l’accent sur les connexions entre ces cultures. Dans le premier cas, suivant Gramsci, des auteurs, surtout indiens, se réclamant des subaltern studies ont montré que la langue constitue un élément de pouvoir et un facteur de hiérarchie. C’est le cas en particulier de l’anglais, qui s’est imposé dans l’Inde coloniale, puis partout dans le monde. Chakrabarty a insisté avec force sur ce point : des catégories telles que le salarié, le capital, le sujet, la société civile ont été élaborées en Europe et exportées dans d’autres contextes, dont l’Inde (31). Il suggère d’avoir recours à d’autres notions et catégories issues des traditions indiennes (32).
Ce processus serait facile à généraliser à d’autres contextes ; les traductions, les médias, la circulation des normes juridiques et le langage des organisations internationales ont été désignés comme autant d’instruments du pouvoir et de la domination du « Nord » sur les « Sud ». Cette asymétrie entre les valeurs occidentales et les autres se poursuit jusqu’à nos jours au sein même des universités : les historiens et étudiants des mondes non-occidentaux sont censés connaître aussi l’histoire, l’économie, la philosophie occidentales, alors que l’inverse n’est pas vrai. Dans les cursus d’histoire en Occident, l’histoire nationale domine tandis que celle des autres mondes est soit absente, soit marginalisée. Alors qu’un futur historien de la Chine doit étudier l’histoire européenne, un historien de la France peut tranquillement ignorer l’histoire africaine ou chinoise.
La démarche de Chakrabarty a le mérite de poser la question des catégories avec lesquelles nous pensons notre monde par rapport aux autres et la nécessité de prendre aussi en considération les valeurs d’autres cultures. Il est ainsi tout à fait légitime de se demander si des notions telles que les droits de l’homme (33), la société civile, le cosmopolitisme (34), voire le religion et la laïcité (35) ne connaissent pas d’équivalents dans d’autres cultures. Ces questions sont de taille à l’heure où ce sont précisément les rencontres entre mondes et valeurs qui semblent poser le plus problème, non seulement en Europe et aux États-Unis – vis-à-vis de l’Islam – mais également dans d’autres contextes (conflits entre l’Inde et le Pakistan, oppositions de valeurs à l’intérieur même de l’Afrique). Cette attention envers les valeurs « autres » est nécessaire et bienvenue ; mais elle présente aussi un risque. L’insistance sur les « véritables » valeurs hindoues, chinoises ou musulmanes fait partie des projets nationalistes (36) ; de manière générale, l’accent mis sur des entités plus ou moins monolithiques appelées « cultures » ou « civilisations » ignore la question de leur rencontre, dans le passé comme de nos jours (37), de leur métissage et de leurs influences réciproques. C’est une des critiques principales que l’histoire connectée a soulevées envers les subaltern studies. Dans ses meilleures contributions, l’histoire connectée montre l’influence mutuelle entre plusieurs mondes. Qu’il s’agisse des formes de gestion impériale, des religions et savoirs techniques, des notions et pratiques du droit et de la souveraineté, l’histoire connectée montre que les valeurs et pratiques européennes ont été profondément affectées par les interactions et dynamiques avec les mondes non européens (38). C’est un pas en avant fondamental dans la tentative de percevoir la globalité non comme une confrontation, mais comme un dialogue entre mondes.
Cette posture est néanmoins souvent contredite dans les faits. Il faut détailler les conditions dans lesquelles des personnes, des ouvrages, des idées circulent ou ne circulent pas transports, relations, influences, marchés, lien religieux. L’absence de transferts et de circulation est tout aussi importante à étudier que les connexions. La circulation des savoirs mérite d’être inscrite dans les dynamiques structurelles – économiques et sociales –, et ces dernières ne peuvent pas se limiter à quelques passages en début de chapitre (39). L’histoire connectée a tendance à délaisser les hiérarchies sociales telles qu’elles sont mises en avant dans les approches marxiste et wébérienne, mais aussi par les subaltern studies. L’accent mis sur les circulations conduit souvent à négliger le fait que ces circulations ne se font jamais d’égal à égal, mais ont tendance à créer des hiérarchies, certes réversibles sur la longue durée (comme le montre de nos jours le retour de l’Asie), mais néanmoins importantes. Ces inégalités ne relèvent pas tellement d’une supériorité intrinsèque de telle ou telle valeur et pensée, mais plutôt de l’interrelation forte entre valeurs, idées, d’un côté, et dynamiques structurelles – économiques, politiques et sociales – de l’autre. Ce sont ces tensions entre circulations et hiérarchies, métissages et exclusions qui méritent d’être analysées dans une perspective de longue durée (40). Ce n’est pas un hasard si l’histoire connectée se concentre souvent sur les passeurs de savoirs et néglige ceux qui se déplacent moins et produisent peu de sources, entre autres et notamment les paysans (41).
C’est aussi la raison pour laquelle il paraît inutile d’opposer l’histoire croisée et connectée à l’histoire comparée (42). Cette opposition entre comparaison et connexion, l’une supposée être subjective, l’autre objective et découlant de source, affaiblit en réalité l’une et l’autre. Les connexions exhumées dans les archives ne sont pas moins subjectives que les comparaisons faites par l’historien. Les archives et les documents ne sont jamais là tout prêts, ils constituent le produit de l’effort des administrations, des entreprises, des acteurs qui en sont à l’origine, puis des archivistes et de leurs classifications, et finalement des historiens qui sélectionnent tel et tel document et le présentent d’une manière tout aussi particulière (43).
Alessandro Stanziani
Prochain article (à venir) : « Histoire globale à la française ? »
(15) Jürgen Osterhammel, Niels Peterson, Globalization: A Short History, Princeton, Princeton University Press, 2009.
(16) Peter Steerns, Globalization in World History, New York, Routledge, 2010.
(17) Frederick Cooper, Colonialism in Question, Berkeley, University of California Press, 2005, trad. fr. Le Colonialisme en question, Paris, Payot, 2010, en particulier le chapitre 4.
(18) Philippe Aghion, Geoffrey Williamson, Growth, Inequality and Globalization: Theory, History and Policy, Cambridge: Cambridge University Press, 2000 ; Kevin O’Rourke, Geoffrey Williamson, Globalization and History: The Evolution of a 19th Century Atlantic Economy, Cambridge, MIT Press, 1999.
(19) Anthony G. Hopkins (dir.), Globalization in World History, Londres, Pimlico, 2002.
(20) Jacques Le Goff, Faut-il vraiment découper l’histoire en tranches ?, Paris, Seuil, 2014 ; Benjamin Kedar, Merry Wiesner-Hanks, Expanding Webs of Exchange and Conflict: The Cambridge World History, vol. 5, Cambridge, Cambridge University Press, 2015.
(21) Pour une synthèse, voir David Christian, Maps of Time: An introduction to Big History, Berkeley, University of California Press, 2004.
(22) Frederick Cooper, Colonialism in Question, op. cit.
(23) Bozhong Li, Agricultural Development in Jiangnan, New York, St Martin’s Press, 1998.
(24) Voir sur ce point les discussions, présentation et commentaires, in Annales HSS, 2001/4 ; Patrick O’Brien, « Ten Years of Debate on the Origin of the Great Divergence », Review in History, nov. 2010, consultable sur https://www.history.ac.uk/reviews/review/1008
(25) Robert Allen, Jean-Pascal Bassino, Debin Ma, Christine Moll-Murata, Jan Luiten Van Zanden, « Wages, Prices, and Living Standards in China, 1738-1825: in Comparison with Europe, Japan and India », Economic History Review, n° 64/1, 2011, pp. 8-38, consultable sur http://personal.lse.ac.uk/mad1/ma_pdf_files/allen%20et%20all%20ehr.pdf ; Kenneth Pomeranz, The Great Divergence, Princeton, Princeton University Press, 2000, trad. fr. Une grande divergence, Paris, Albin Michel, 2010.
(26) Stephan Broadberry, Bishnupriya Gupta, The Early Modern Great Divergence: Wages, Prices, and Economic Development in Europe and Asia, 1500-1800, Warwick University, 2003, consultable sur https://eml.berkeley.edu/~webfac/olney/e211_fa03/e211-gupta.pdf ; Robert Allen, The British Industrial Revolution in Global Perspective, Cambridge, Cambridge University Press, 2009 ; Prisanan Parthasarathai, Why Europe Grew rich and Asia did not. Global Economic Divergence, 1600-1850, Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
(27) Kenneth Pomeranz, The Great Divergence, op. cit.
(28) comptes rendus in Annales HSS, n° 61/6, 2006 ; débat in The Journal of Asian Studies, n° 61/2, 2002, articles de Philip Huang, Robert Brenner, Christopher Lee et al.
(29) Robert H. Bates, « Area Studies and the Discipline: A Useful Controversy? », Political Science & Politics, n° 30, 1997, pp. 166-169.
(30) Fred Eidlin, Reconciling the Unique and the General: Area Studies, Case Studies, and History vs. Theoretical Social Science, Working Paper 8, mai 2006, C&M Committee on Concepts and Methods, 2008. Michel Cartier, « Asian Studies in Europe: From Orientalism to Area Studies », in Tai-Hwan Kwon, Oh Myungk-Seok (dir.), Asian Studies in the Age of Globalization, Seoul: Seoul National University Press, 1998, pp. 19-33.
(31) Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe, Princeton: Princeton University Press, 2000, trad. fr. Provincialiser l’Europe. La pensée coloniale et la différence historique, Paris, Amsterdam, 2009.
(32) Nous reviendrons plusieurs fois sur cet aspect tout au long des chapitres suivants.
(33) José Manuel Barreto (dir.), Human Rights from a Thirld World Perspective, Cambridge, Cambridge Scholars, 2013.
(34) Corinne Lefèvre, Ines Zupanov, Jorge Flores (dir.), Cosmopolitismes en Asie du Sud. Sources, itinéraires, langues, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, EHESS, 2015.
(35) Nilufer Göle, « La laïcité républicaine et l’islam public », Pouvoirs, n° 115/4, 200, pp. 73-86.
(36) Sebastian Conrad, What is Global History, op. cit.
(37) Sanjay Subrahmanyam, « Du Tage au Gange au XVIe siècle. Une conjoncture millénariste à l’échelle eurasiatique », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2001, pp. 51-84 ; « Connected Histories. Notes Towards a Reconfiguration of Early Modern Eurasia », Modern Asian Studies, n° 31/3, 1997, pp. 735-762.
(38) Sanjay Subrahmanyam, Is Indian Civilization a Myth?, Delhi, Permament Black, 2013.
(39) Conrad, What is global history, op. cit.
(40) Roger Chartier, « La conscience de la globalité », Annales HSS, n° 56/1, 2001, pp. 119-123.
(41) Des exceptions importantes : Nancy Green avec l’histoire de l’émigration et Bénédicte Zimmermann avec une sociologie historique du monde du travail en Allemagne et en France. Voir aussi mon chapitre « Les paysans et la terre », in Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre (dir.), Histoire du monde au XIXe siècle, Fayard, 2017, pp. 35-49.
(42) Michael Werner et Bénédicte Zimmermann (dir.), De la comparaison à l’histoire croisée, Paris, Seuil, 2004.
(43) Heinz-Gerhard Haupt, Jurgen Kocka, Comparative and Trans-national History, New York, Berghahn, 2009.