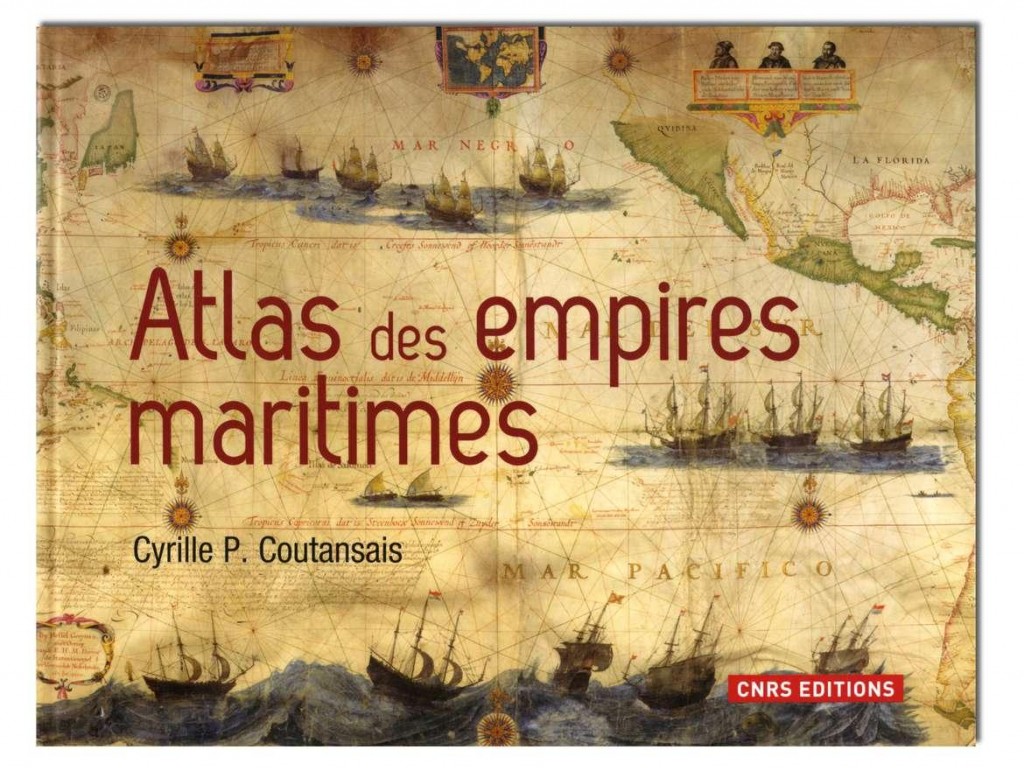Invité la semaine dernière par Louise Benat-Tachot (du CLEA) et Miguel Rodriguez (du Crimic) à prendre part à un colloque intitulé « Le Pacifique, du 16e au 21e siècle », j’y ai ébauché une brève synthèse des rapports que l’histoire mondiale entretient avec la Chine, courant sur les derniers siècles. Sans surprise, le sujet renvoie à nombre de billets parus sur ce même blog.
Pourquoi l’Asie, pourquoi la Chine ? D’abord un chiffre, extrait de l’œuvre de l’économiste Angus Maddison : 75 %, part supposée de l’Asie dans le PIB mondial durant le premier millénaire de notre ère, contre moins de 10 % pour l’Europe. Ensuite un travail collectif (« L’histoire des autres mondes », Les Grands Dossiers des sciences humaines, n° 24, sept.-oct.-nov. 2011), que j’ai dirigé il y a deux ans, et qui inspire pour partie cet article : une vraie histoire mondiale, comprendre non eurocentrée, ramène en quelque sorte l’Asie au centre. Et souligne bien involontairement que sans la Chine, l’histoire du monde n’aurait pas été la même. Si Christophe Colomb n’était pas parti vers l’ouest dans l’idée de trouver le grand khan de Chine afin de le convertir et de lui soutirer son or pour financer une croisade, nous n’aurions pas eu d’objet pour ce colloque, initié pour le 500e anniversaire de la « découverte » du Pacifique par Vasco Núñez de Balboa. La politique des Grandes Découvertes européennes, du 15e au 18e siècle, peut se résumer en une obsession : trouver une voie d’accès vers la Chine, les Indes, leurs richesses.
Indéniablement, la Chine est au centre d’un grand pan de l’histoire mondiale. Le monde chinois, ce sont de vastes plaines cultivées, une grande civilisation qui a représenté, au moins depuis le début de notre ère, de 30 à 20 % aujourd’hui de l’humanité. Cette densité explique que les Chinois soient à l’origine de nombre d’inventions, dont je dresse une liste très loin d’être exhaustive : la boussole, la poudre, le papier, l’imprimerie, la bureaucratie (résumée en une constante : les fonctionnaires ont représenté, ces deux derniers millénaires, quelque 10 % de la population chinoise). Ajoutons-y pour faire bonne mesure le papier-monnaie, le gouvernail d’étambot, le caisson étanche pour les bateaux, le haut-fourneau, l’arbalète, la brouette, la poste d’État, etc. Pour une liste exhaustive, se référer à l’encyclopédique œuvre dirigée par Joseph Needham.
Toutes ces inventions ont été diffusées vers l’Europe, qui les a améliorées et en a fait les outils de son hégémonie mondiale, qui court en gros peut-être du 16e, en tout cas au moins du 19e à la moitié du 20e siècle. Ces emprunts se font d’abord par la steppe, puis l’océan Indien via le monde musulman, enfin la route de la Soie quand les Mongols l’unifient au 13e siècle – ce « grand désenclavement » auquel Jean-Michel Sallmann a récemment consacré un bel ouvrage. C’est par cette route que Marco Polo peut témoigner des fastes de la cour du grand khan. C’est Marco Polo avec d’autres qui inspirent Christophe Colomb dans son équipée. L’histoire est connue, pour plus de détails, voir le beau livre que Bernard Vincent a consacré à 1492. L’année admirable, ou la biographie de Christophe Colomb. Héraut de l’apocalypse par Denis Crouzet : Colomb cherchait la Chine, il trouve les Amériques. C’est la première mondialisation, au moins selon l’acception des historiens hispanisants – les économistes voient souvent leur première mondialisation au 19e siècle, avec l’extension mondiale du libre-échange. Cette première mondialisation est d’abord ibérique. Espagnols et Portugais se partagent le monde en 1494, avec le traité de Tordesillas.
Les premiers à arriver en Chine sont les Portugais. Ils contournent l’Afrique et le Moyen-Orient, s’insèrent assez brutalement dans les denses réseaux commerciaux, déjà connus des Chinois, qui sillonnent l’océan Indien depuis le début de notre ère et auxquels Philippe Beaujard a consacré une anthologie [commentée en 2 billets, ici et là]. Cela ne va pas sans mal, comme le montre Serge Gruzinski dans L’Aigle et le Dragon. Si les Espagnols terrassent les Aztèques et les Incas, les Portugais échouent à dicter leur loi à la Chine : trop peuplée, trop bien organisée, familière des canons, et surtout indifférente aux maladies véhiculées par les Européens. Ces pandémies, la variole en tête, seront le facteur décisif des conquêtes espagnoles. Car l’Eurasie, avec ses civilisations qui commercent et qui élèvent des animaux, a été un gigantesque bouillon de culture. En Asie comme en Europe, les populations partagent les mêmes agents pathogènes depuis des millénaires et sont immunisées. Les Amérindiens, à l’écart de ce grand brassage microbien, vont payer le prix lourd : au 16e siècle, leur population s’effondre, peut-être à 10 ou 20 % de ce qu’elle était à l’arrivée des Blancs – ce qui explique l’aisance des conquêtes.
Très vite, les Espagnols arrivent à contourner les Amériques et ouvrent à leur tour une voie vers la Chine à travers le Pacifique. Des Amériques jaillit un flux de métaux précieux, or et surtout argent. Qu’y a-t-il alors à acheter ? De la soie (de Chine), des cotonnades (d’Inde), de la porcelaine (de Chine)… Dès le 16e siècle, l’Asie draine peut-être la moitié de l’or et de l’argent du Nouveau Monde. En témoigne la mise en place du galion de Manille. Le but est d’aller droit au client final, sans transiter par l’Europe.
Les puissances émergentes du moment, la France, l’Angleterre, les Pays-Bas, veulent aussi leur part du gâteau. Elles se heurtent à une première difficulté : comment accéder à la Chine alors que Portugais et Espagnols contrôlent les chemins non bloqués par les puissances asiatiques terrestres, telles la Russie, la Perse, L’Empire ottoman, l’Empire moghol en Inde ? De deux façons : d’abord en cherchant d’autres voies. Une anecdote à ce sujet, contée par Timothy Brook dans son splendide livre Le Chapeau de Vermeer : Samuel Champlain coordonne pour la couronne française l’exploration de l’Amérique des Grands Lacs. Il achète, probablement à Paris, une robe de cérémonie chinoise d’immense valeur, on l’imagine toute de soieries et dorures, dans l’idée que l’agent qui arrivera à la cour impériale chinoise doit paraître à son avantage. Et ce sont les Hurons qui profitent du spectacle, alors qu’un employé de Champlain s’adresse à leurs chefs déguisé en mandarin.
Ces tentatives de contournement échouent, il n’y a pas d’autre voie. Seconde option, qui se révèle efficace dès le 17e siècle : la concurrence, au besoin armée. Les bateaux anglais et néerlandais pillent et détruisent leurs rivaux ibériques. C’est l’acte de naissance d’un certain capitalisme, en tout cas un essor formidable du secteur privé, des compagnies par actions, les Compagnies des Indes. Et ces nouveaux venus écartent les Ibériques du grand jeu.
Seconde difficulté, partagée par tous les États européens : la Chine n’est pas intéressée par le commerce. Les hommages venus de loin, oui. Quelques échanges bien contrôlés dans des comptoirs verrouillés, pourquoi pas ? Elle veut bien des métaux précieux. Alors, pour acquitter une balance commerciale toujours plus déséquilibrée, les Espagnols envoient leur argent en Chine, quand les pirates anglais ne font pas main basse dessus.
Si, à la fin du 18e siècle, on avait posé à un Candide extraterrestre la question : demain, qui dominera le monde ?, il aurait sans hésiter répondu : la Chine, évidemment ! Superpuissance militaire, prémices d’industrialisation et de consommation, population homogène… Elle avait apparemment tous les atouts. Au milieu du 19e, elle se fait pourtant humilier lors des deux guerres de l’Opium livrées par les puissances occidentales afin de l’obliger à jouer le jeu du libre-échange, et s’effondre. Dépassée technologiquement, certes. Mais aussi, on l’oublie trop souvent, ravagée de l’intérieur par un conflit civil à l’ampleur inégalée dans l’histoire, la guerre messianique des Taiping, qui fait peut-être 30 millions de morts (1851-1864).
Un autre facteur qui a pu jouer a été exposé par Kenneth Pomeranz dans Une grande divergence. Comparant l’Angleterre de la Première Révolution industrielle et le bassin du Bas-Yangzi, qui connaissent à la fin du 18e siècle une situation socio-économique similaire, il souligne que les deux sociétés en étaient arrivées à une sorte de piège malthusien écologique : le déboisement empêchait d’accroître une activité liée au charbon de bois, et les limites de productivité agricole obéraient une extension économique en Chine. Alors que l’Angleterre disposait d’énormes réserves en charbon fossile, et jouissait de 20 millions d’« hectares fantômes » dans le Nouveau Monde dont elle pouvait extraire les ressources agricoles. Elle était aussi en mesure d’imposer à l’Inde de cesser de produire des cotonnades et de devenir un fournisseur de matières premières – l’Inde, rappelons-le, est restée sous la coupe d’une société anonyme fondée en 1600, la Compagnie anglaise des Indes orientales, du milieu du 18e siècle jusqu’en 1858…
Un autre historien américain, non traduit en français, John R. McNeill, plonge lui aussi dans l’histoire environnementale pour montrer, dans Mosquito Empires, pourquoi l’Amérique latine est restée hispanophone et lusophone. Les Anglais voulaient mettre la main dessus, ils en avaient les moyens militaires, ils ont échoué. À cause des moustiques, qui ont offert un avantage décisif aux primo-arrivants. En déportant des esclaves africains par millions dans le Nouveau Monde, les Européens y ont aussi acclimaté le paludisme Plasmodium falciparum – le plus meurtrier – et la fièvre jaune. Les populations déjà sur place, au moins celles dont les ancêtres avaient survécu, y avaient gagné une immunité. Même en infériorité numérique, Espagnols et Portugais ont ainsi résisté aux invasions britanniques. Il leur suffisait d’attendre quelques mois, retranchés dans leurs fortins, que les fièvres anéantissent 90 % des contingents adverses. D’autres ouvrages, tels ceux de Charles C. Mann (1491 ; 1493) ou, de Nicholas A. Robins, Mercury, Mining and Empire, qui montre la destruction des communautés andines par la pollution liée à l’activité minière, soulignent le riche apport de l’histoire environnementale quant aux sujets ici évoqués.
Ensuite, la Chine connaît l’Occupation japonaise, la parenthèse maoïste, les dizaines de millions de morts liés à ces événements, bref un grand bond… en arrière. 1979, Deng Xiao-Ping initie une libéralisation progressive. À partir de 1985, les entreprises japonaises envoient leurs usines en Chine. Par cette délocalisation induite par la flambée du yen, elles diffusent leur modèle d’industrialisation. Une main-d’œuvre active et peu rémunérée s’emploie alors à édifier l’atelier du monde.
En moins de trois décennies, la Chine fait irruption dans l’économie mondiale, avec des taux de croissance annuels de 10 % – même s’ils se réduisent ces dernières années. Elle émerge, ou plutôt ré-émerge. Elle valide ce nouveau statut en 2000, par son entrée dans l’OMC (Organisation mondiale du commerce). En 2008, détenant les plus grandes réserves financières de la planète, c’est la Chine, conjointement au Japon, qui sauve de la banqueroute le dollar en rachetant à tour de bras de la dette américaine. En 2009, elle devient le premier exportateur mondial. En 2010, la Chine acquiert le rang de deuxième économie mondiale, dépassant le Japon. Quatre entreprises chinoises figurent en 2010 dans les dix premiers groupes mondiaux. Quelque part dans les décennies 2020-2030, pense-t-on aujourd’hui, elle doublera les États-Unis et reviendra à la place qui serait la sienne dans l’arène internationale : la première. Tout ça a déjà été dit.
François Gipouloux, dans son ouvrage La Méditerranée asiatique, a campé la vaste fresque des flux marchands de ces cinq derniers siècles. Derrière l’ampleur d’un phénomène qui n’a pas de précédent historique en termes d’échelle, il relativise les atouts chinois.
Quand la Chine a sauvé le dollar, on prête à Hillary Clinton la phrase suivante : « On ne sermonne pas son banquier. » Il y aurait pourtant matière à gronder, en ce qui concerne le sort des minorités culturelles ou ethniques (Tibétains, Ouighours…). Les camps de travail existent toujours. Sans être une dictature, la Chine reste un régime autoritaire, et l’appareil de surveillance du Web est un véritable Léviathan. La liberté de religion n’existe pas. L’État contrôle tout en la matière, une vieille obsession chinoise dérivant d’une histoire scandée par les rébellions messianiques. Plus largement, la liberté d’entreprendre est balbutiante. Paradoxe : le secteur entreprenarial chinois est un des plus dynamiques du monde. Le secteur bancaire est le mieux nanti de la planète, car faute de Sécurité sociale et de retraite, les Chinois affichent le plus haut taux d’épargne du monde, 40 % de leurs revenus. Or les banques se montrent plus que rétives à financer le secteur privé. Car tout est régi par le triumvirat banques d’État – Parti unique – entreprises publiques.
Selon Gipouloux, en Europe, le capitalisme s’est bâti sur une fragmentation des pouvoirs politiques propice au développement du droit privé. Rien de tel en Chine. L’État a toujours, et il continue, gardé les marchands sous sa coupe. Une des conséquences est l’apparition aujourd’hui de la plus grande diaspora de l’histoire mondiale, jaillie du monde chinois depuis une dizaine d’années : de 30 à 50 millions de personnes, rêvant de faire fortune ailleurs que chez eux sous l’ombrelle qu’étend complaisamment un État expansionniste sur toute la planète. Conséquence : il y a une ChinAfrique, et il existe une ChinAmérica del Sur, que décrivent par exemple les journalistes espagnols Heriberto Araujo et Juan-Pablo Cardenal dans Le Siècle de la Chine. Ils consacrent ainsi des passages édifiants au pillage des ressources minières du Pérou par des conglomérats chinois.
Ceci dit, historiquement parlant, les Chinois ont été, dans des secteurs qui leur étaient propres, parfois plus libéraux que les Européens. Un exemple, extrait des Bâtisseurs d’empire d’Alessandro Stanziani : l’auteur estime que sous la dynastie Qing (du milieu du 17e siècle au début du 20e), l’État finance son armée et son importante expansion territoriale par le recours massif au secteur privé – ce qui le fragilisera à terme. Et cela se passe au moment où le monopole étatique de la violence est constitutif, en Europe, de l’émergence des États-nations. Il souligne aussi que la Chine a connu, ces deux derniers millénaires, autant de périodes de fragmentation entre États rivaux que de moments où elle était unifiée sous la bannière de dynasties. À l’encontre d’autres auteurs, qui perçoivent, dans la succession dynastique qui rythme l’histoire de Chine telle qu’elle est traditionnellement exposée, une continuité manifeste des formes institutionnelles. Ce qu’il faut en retenir, c’est que, comme partout, la société chinoise sait évoluer et s’adapter. Elle n’est pas immuable.
Certains problèmes spécifiques méritent un éclairage bref. J’en retiens deux : la démographie et l’environnement.
On connaît la politique de l’enfant unique. On sait moins que la Chine subit un problème massif, comme l’Inde et le Pakistan, de déséquilibre de la balance entre les sexes. Le fœticide féminin, pratiqué clandestinement à grande échelle, a abouti à laisser vivre 117 garçons pour 100 filles, le rapport biologique s’établissant normalement à 100 garçons pour 105 ou 106 filles. D’où une Chine qui aujourd’hui se masculinise, en sus de vieillir… Avec des conséquences difficilement prévisibles.
La Chine est devenue le premier pollueur mondial. Paradoxe : pour nourrir sa soif d’énergie, elle inaugure deux centrales à charbon par semaine. Elle bloque, de concert avec les États-Unis, comme le montre Jean-Paul Maréchal dans Chine/USA : le climat en jeu, toute négociation internationale visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre impliqués dans le réchauffement. Parce qu’elle estime que les pays industrialisés doivent payer pour leurs émissions passées (l’Europe et les États-Unis comptent chacun pour 30 % des émissiosn passées, alors que la Chine est reponsable de 10 %), quand les États-Unis souhaitent, réduisant leur pollution, ne payer que pour les émissions à venir. Mais la Chine s’est imposée comme le leader mondial des énergies vertes, ses nouvelles centrales à charbon sont bien plus performantes que celles des États-Unis, et comme l’Inde et l’Europe, elle reboise massivement.
La Chine nous apprend beaucoup : elle fait d’abord voler en éclats le dogme qui voudrait que développement économique et démocratisation marchent de concert. Les économistes Giovanni Arrighi, Michel Aglietta, Guo Bai ou Kaoru Sugihara cernent qui une voie chinoise, qui un modèle est-asiatique de développement qui pourrait constituer une alternative au néolibéralisme, car basé non sur l’accumulation du capital, mais sur l’intensification du travail. Et la Chine nous rappelle aussi que nous vivons aujourd’hui une parenthèse hégémonique. La Grande-Bretagne a dominé le monde au 19e siècle. Dans la première moitié du 20e elle n’était plus en mesure de jouer ce rôle, et les États-Unis ne souhaitaient pas l’endosser. Période d’incertitude, marquée par deux guerres mondiales et une crise économique majeure. Ce n’est qu’à l’issue du second conflit mondial que les États-Unis se sont imposés : suprématie du dollar, superpuissance militaire et économique, en rivalité avec l’URSS. Or l’économie mondiale, comme la géopolitique, sont aujourd’hui en passe d’entrer dans une nouvelle ère. Dans L’Asie et le Futur du monde, Yves Tiberghien souligne que les pays de l’OCDE comptaient pour 60 % du PIB mondial de 1950 à 2000, avec 13 % de la population mondiale. En 2010, cette part s’était réduite à 50 %. Elle devrait continuer à décroître, pour atteindre 25 % vers 2050.
Retenons que la prospective est une science aléatoire. J’ai relu récemment un rapport de ce type publié par l’Europe en 2007 – Le Monde en 2025 –, et même s’il signale que l’économie américaine était fragile, il ne pouvait anticiper la crise des subprimes aux États-Unis (en attendant demain en Chine ?, dont la bulle immobilière reste menaçante) et ses conséquences. En cascade, celles-ci chamboulent déjà la plupart de ses pronostics. Mais notons qu’un constat émerge de cette littérature : pour les prochaines décennies, les prospectivistes envisagent des évolutions vers une économie mondiale soit tripolaire (Amérique, Asie, Europe), soit multirégionale (polarisée autour de puissances locales), soit dominée par la Chine et accessoirement l’Inde – une asiatisation du monde donc, prophétisée par Kishore Mahbubani et Nayan Chanda… Mais une très forte majorité anticipe le recul de l’Occident au bénéfice soit de l’Asie, soit des émergents dans leur ensemble. Les élites chinoises devront choisir leur stratégie, avec pour option à déterminer de favoriser plus ou moins les diverses institutions dont elles sont membres : Bric’s (Brésil-Russie-Inde-Chine-Afrique du Sud), G20, G77 ou intégration régionale avec le Japon et la Corée du Sud.
Pour conclure et ouvrir à la fois ce bref tour d’horizon, je signale que la prochaine édition du Festival international de géographie de Saint-Dié des-Vosges aura cette année pour thème : « La Chine, une puissance mondiale ».
Bibliographie indicative
• Michel Aglietta et Guo Bai, La Voie chinoise. Capitalisme et Empire, Odile Jacob, 2012.
• Heriberto Araùjo et Jùan Pablo Cardenal, Le Siècle de la Chine. Comment Pékin refait le monde à son image, Flammarion, 2013.
• Giovanni Arrighi, Adam Smith à Pékin. Les promesses de la voie chinoise, 2007, trad. fr. Nicolas Vieillecazes, Max Milo, 2009.
• Isabelle Attané, Au pays des enfants rares. La Chine vers une crise démographique, Fayard, 2011 ; En espérant un fils… La masculinisation de la population chinoise, Ined, 2010.
• Philippe Beaujard, Les Mondes de l’océan Indien. t. I : De la formation de l’État au premier système-monde afro-eurasien ; t. II : L’Océan Indien, au coeur des globalisations de l’Ancien Monde, Armand Colin, 2012.
• Marie-Claire Bergère, Capitalismes et capitalistes en Chine. Xixe-xxie siècle, Perrin, 2007.
• Roy Bin Wong, China Transformed: Historical Change and the Limits of European Experience, Cornell University Press, 2000.
• Luce Boulnois, La Route de la Soie. Dieux, guerriers et marchands, Olizane, 2001, rééd. 2010.
• Timothy Brook, Le Chapeau de Vermeer. Le xviie siècle à l’aube de la mondialisation, 2008, trad. fr. Odile demange, 2010, rééd. 2012 ; Sous l’œil des dragons. La Chine des dynasties Yuan et Ming, 2010, trad. fr. Odile Demange, 2012.
• Gérard Chaliand et Michel Jan, Vers un nouvel ordre du monde, Seuil, 2013.
• Nayan Chanda, 2007, Au commencement était la mondialisation, La grande saga des aventuriers, missionnaires, soldats et marchands, trad. fr. Marie-Anne Lescourret, CNRS Éditions, 2010.
• Axelle Degans, Les pays émergents : de nouveaux acteurs. BRIC’s : Brésil, Russie, Inde, Chine… Afrique du Sud, Ellipses Marketing, 2011.
• Jean-Luc Domenach, La Chine m’inquiète, Perrin, 2009.
• Jacques Gernet (1921), Le Monde chinois. t. I : De l’âge du Bronze au Moyen Âge ; t. II : L’Époque moderne (10e-19e siècle) ; t. III : L’Époque contemporaine, 1972, Armand Colin (1 vol.), rééd. Pocket, 2006.
• François Gipouloux, La Méditerranée asiatique. Villes portuaires et réseaux marchands en Chine, au Japon et en Asie du Sud-Est, xvie-xxie siècle, CNRS Éd., 2009.
• Nicole Gnesotto et Giovanni Grevi (dir.), Le Monde en 2025, trad. fr. Béatrice Bocard, Pocket, 2007.
• Vincent Goossaert et David A. Palmer, La Question religieuse en Chine, CNRS, 2012.
• Christian Grataloup, Géohistoire de la mondialisation. Le temps long du monde, Armand Colin, 2007, rééd. 2010.
• Serge Gruzinski, L’Aigle et le Dragon. Démesure européenne et mondialisation au 16e siècle, Fayard, 2012.
• Yang Jisheng, Stèles. La Grande Famine en Chine, 1958-1961, trad. fr. Louis Vincenolles, Sylvie Gentil et Chantal Chen-Andro, Seuil, 2012.
• Johannes Jütting, Le Basculement de la richesse, OCDE, 2010.
• Parag Khanna, The Second World. Empires and influence in the new global order, Random House, 2008.
• Charles C. Mann, 1493. Comment la découverte des Amériques a transformé le monde, 2011, trad. fr. Marina Boraso, Albin Michel, 2013. L’auteur, journaliste scientifique, a déjà publié une remarquable étude avec 1491. Nouvelles révélations sur les Amériques avant Christophe Colomb, 2006, trad. fr. Marina Boraso, Albin Michel, 2007.
• Kishore Mahbubani, Le Défi asiatique, 2008, trad. fr. Rita Sabah, Fayard, 2008.
• Jean-Paul Maréchal, Chine/USA : Le climat en jeu, Choiseul, 2011.
• John R. McNeill, Mosquito Empires. Ecology and war in the Greater Caribbean (1620-1914), Cambridge University Press, 2012.
• Joseph Needham, La Science chinoise et l’Occident, 1969, trad. fr. Eugène Simion, Seuil, coll. « Points », 1973.
• Joseph Needham et Robert Temple, The Genius of China: 3,000 Years of Science, Discovery, and Invention, Andre Deutsch, 2007.
• Philippe Pelletier, L’Extrême-Orient. L’invention d’une histoire et d’une géographie, Gallimard, 2011.
• Kenneth Pomeranz, Une grande divergence. La Chine, l’Europe et la construction de l’économie mondiale, 2000, trad. fr. Nora Wang et Mathieu Arnoux, Albin Michel/MSH, 2010 ; La Force de l’Empire : Révolution industrielle et écologie, ou pourquoi l’Angleterre a fait mieux que la Chine, È®e, 2009.
• Nicholas A. Robins, Mercury, Mining and Empire. The Human and Ecological Cost of Colonial Silver Mining in the Andes, Indiana University Press, 2011.
• Jean-Michel Sallmann, Le Grand Désenclavement du monde. 1200-1600, Payot, 2011.
• Alessandro Stanziani, Bâtisseurs d’empires. Russie, Chine et Inde à la croisée des mondes, 15e–19e siècles, Raisons d’agir, 2012.
• Gabriele Steck et al., Allianz Global Wealth Report 2010, Allianz, 2010.
• Yves Tiberghien, L’Asie et le Futur du monde, Presses de SciencesPo, 2012.
• Odd Arne Westad, Restless Empire. China and the World since 1750, Bodley Head, 2012.
• Fareed Zakaria, Le Monde postaméricain, 2008, rééd. Perrin, 2011.