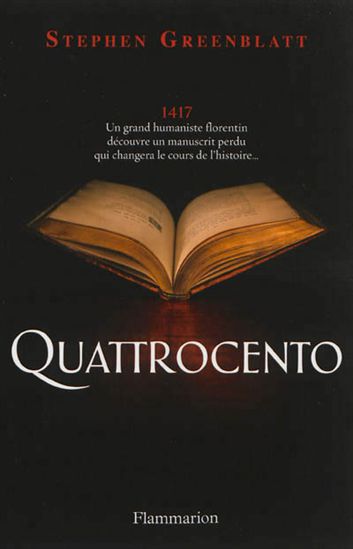Le billet du 29 octobre 2012, « La guerre prémoderne, 5e – 15e siècles », se terminait par une conclusion provisoire ouvrant sur ce qu’il est convenu d’appeler les Temps modernes. Une modernité marquée par un phénomène sans précédent historique, celui d’une société exerçant progressivement son hégémonie à l’échelle mondiale. Sachant que l’Europe finit par dominer le monde au terme du 19e siècle, nombre d’historiens ont essayé d’analyser les causes de cet « essor de l’Occident », à commencer par William H. McNeill avec The Rise of the West [1963]. Nombre d’explications ayant intégré le facteur militaire comme décisif dans ce « miracle européeen », nous rebondissons ici sur le choix de la guerre comme thématique des Rendez-vous de l’histoire de Blois cette année, du 10 au 13 octobre 2013. Nous allons explorer la genèse de cette supériorité militaire occidentale.
Si l’histoire militaire européenne est connue, certaines trajectoires illustrent hors de l’Europe de façon spectaculaire l’entrée dans une nouvelle ère de la guerre. La poudre est à cet égard décisive. Elle est d’abord utilisée en Chine dès le 9e siècle, puis perfectionnée avec le savoir-faire des ingénieurs en balistique perses et des fondeurs européens réunis sous la bannière des Mongols lors de leur expansion continentale. Elle entraîne enfin, dans toute l’Eurasie, l’affirmation progressive du canon – renforcée en Europe par l’irruption de la bouche à feu portative, ancêtre du mousquet –, arme pivot du champ de bataille à partir du 15e siècle. Les Otttomans font ainsi usage d’une monstrueuse bombarde en assiégeant Constantinople (1453).
Et le Japon renonça aux armes à feu
Mais à l’autre bout de l’Asie va prendre place une étonnante trajectoire, celle du Japon. Ses habitants découvrent les arquebuses à la faveur de l’arrivée (sur un navire chinois) de marchands portugais en 1543. Ils les dupliquent dans les années qui suivent, et produisent rapidement en série des armes d’acier d’excellente qualité – introduisant un système de rayage inédit qui en améliore grandement l’efficacité. Alors que les Occidentaux n’auront de cesse, dans les siècles qui suivent, d’améliorer la vitesse du tir afin d’arroser l’adversaire, les Japonais se focalisent sur la précision du tir, rendant cette arme bien plus meurtrière.
Le Japon est alors déchiré dans un interminable conflit civil opposant des seigneurs de guerre en compétition pour la suprématie sur l’ensemble de l’archipel. L’un d’entre, Oda Nobunaga, a en sus l’idée, devançant les Européens de quelques décennies, du feu roulant : en tirant à tour de rôle sur trois rangées, ses arquebusiers viennent à bout de tous ses rivaux (le film Kagemusha. L’ombre du guerrier, d’Akira Kurosawa, 1980, en offre une bonne illustration). Si le fusil détrône l’arc, en Europe comme au Japon, ce n’est pas qu’il soit plus efficace, c’est qu’il faut beaucoup moins de temps pour former un soldat à s’en servir. Le plus étonnant : après avoir acquis une avance indéniable sur le reste du monde en matière de technologie et de stratégie, le Japon prend la décision politique – unique dans l’histoire – de renoncer aux armes à feu alors qu’il interdit l’accès à son marché aux Européens, aux débuts de l’ère Tokugawa (soit entre 1600 et 1650). Nul progrès ne sera plus fait en matière d’armes à feu jusqu’à ce qu’en 1853, la flotte américaine du commodore Matthew Perry intime à l’archipel l’ordre d’ouvrir ses ports au commerce international sous la menace de canons infiniment plus efficaces que l’artillerie du 16e siècle conservée par les Japonais.
Alors que le Japon tourne le dos au « progrès », l’Europe embrasse avec ferveur la « Révolution militaire ». Geoffrey Parker la caractérise comme l’ensemble des évolutions liées à l’irruption de l’artillerie. Les canons, très lourds donc longtemps mis en service immobile lors des sièges, deviennent de plus en plus puissants, et les fortifications de plus en plus vulnérables. Les États les plus riches de l’Europe (Italie, puis France…) adoptent la « trace italienne » : des forteresses bastionnées pour multiplier les possibilités de défense, aux murs en pente pour dévier les boulets, au détriment des fortifications médiévales aux murs droits, conçues pour résister aux attaques de fantassins.
Il est intéressant de noter qu’il s’agit là d’un choix technologique, d’autres options étaient ouvertes : ainsi en Asie (Empire moghol en Inde du Nord, Chine, Japon…), les murs restent droits, on s’acharne simplement à les construire suffisamment épais pour qu’ils résistent aux canons, quitte à donner dans le monumental – lors de la première guerre de l’Opium (1839-1842), des artilleurs britanniques se plaindront de ne pouvoir écorner certaines murailles chinoises, alors que celles-ci sont vieilles de plusieurs siècles.
Les évolutions militaires, toujours plus coûteuses, imposent et se nourrissent de l’affirmation du pouvoir étatique : en Europe, la guerre devient l’affaire des États et leur principale source de dépenses. Les effectifs militaires des guerres en Europe connaissent des hausses colossales qui permettent en quelques siècles aux armées d’atteindre des effectifs qui rivalisent avec ceux des plus puissants États asiatiques, pourtant davantage peuplés. Quant aux tâches militaires, elles subissent en Europe une rationalisation croissante.
L’artillerie embarquée
Le progrès décisif en matière d’artillerie est réalisé à bord des bateaux : la conjonction de navires de plus en plus puissants et de canons toujours plus performants, que les Européens travaillent de manière à optimiser leur usage en mer (tir au canon par le travers, chargement par la bouche, mise au point de chariots…), les rend maîtres des océans dès le 16e siècle. À cet égard, il est intéressant de noter que les Coréens, pour contrer l’invasion japonaise de 1592, recourent à des bateaux-tortues recouverts de plaques d’acier, véritables cuirassés avant leur apparition officielle au 19e siècle – leur puissance de feu surpassait celle des navires japonais d’un facteur de 10 pour 1. Mais cette innovation technologique ne sera pas entretenue, avant d’être oubliée.
Inlassablement, fruit de la concurrence féroce que se livrent les États européens en situation de guerre quasi permanente, se tisse un réseau mondial de fortins coloniaux côtiers. Dans un premier temps, exception faite des Amériques aux populations décimées par le choc microbien, les Espagnols, Portugais, puis Français, Britanniques et Néerlandais ne pénètrent pas à l’intérieur des terres : l’Afrique intérieure (sauf l’Afrique australe) reste inexplorée, trop bien défendue par les maladies endémiques tel le paludisme, et il faudra attendre la seconde moitié du 19e siècle pour assister au dépeçage de l’Afrique. De plus, les traites négrières alimentent les royaumes africains esclavagistes en mousquets, monnaie d’échange parmi d’autres. Mais les rares observateurs conviennent que l’on s’y bat de façon désordonnée, le but semblant de tirer le maximum de munitions pour montrer son courage. C’est qu’en Europe, l’objectif étant d’éradiquer l’adversaire, on améliore sans cesse. Ainsi les comtes de Nassau, commandant une armée hollandaise confrontée à des forces bien supérieures, en sus d’« inventer » le feu roulant, découpent de façon stakhanoviste les gestes élémentaires nécessaires au chargement d’un fusil ou à la mise en œuvre d’une pique dans les années 1590-1610. Un siècle plus tard en Afrique, ou un siècle avant en Méso-Amérique, on ne se bat que dans le but de capturer – donc de ne pas tuer – dans un cas de futurs esclaves, dans l’autre des condamnés à sacrifier aux dieux.
L’efficacité de l’arme à feu n’est donc rien sans le contexte culturel qui pousse à « optimiser » son usage. Sans les infrastructures sociales et économiques qui avaient engendré la machine de guerre européenne, utiliser ou copier la technologie qui en était issue ne permettait jamais d’acquérir l’efficacité visée. Car la guerre à l’occidentale était basée sur tout un appareil de mobilisation des masses, de logistique en armes et ravitaillement qui exigeait, en temps de conflit, un État en mesure de mobiliser d’immenses ressources. Simultanément à l’essor européen, seuls les grands États asiatiques (Chine, Inde moghole et Russie étudiés par Alessandro Stanziani, auxquels on peut rajouter l’Empire ottoman) sont en mesure de rivaliser. Mais si ces États sont bien des « empires de la poudre » (ils se servent de leur artillerie pour réduire des rebellions), leur arme reine reste la cavalerie usant du sabre – les canons sont bien trop lourds pour les déplacer sur les immenses étendues qu’ils contrôlent.
Jusqu’au 19e siècle, Chine, Japon et Corée repoussent les nouveaux-venus. De toute façon, l’avance technologique européenne est faible : en cas de choc frontal, les arquebuses sont longues à recharger, et si les plastrons et les sabres d’acier offrent un avantage au corps à corps dans la plupart des situations, ces armes n’entraînent pas la décision face à un adversaire déterminé (en témoigne la mort de Fernand de Magellan en 1521). Certaines civilisations, comme la Chine, valent l’Europe en matière de technologies militaires, et y ajoutent, se battant à domicile, des effectifs militaires largement supérieurs à ceux que l’Europe peut projeter au loin.
Le grand bond a lieu au long du 19e siècle. Vers 1800, l’Europe domine 30 % de la surface du globe. En 1900, elle en contrôle 80 %. Cette expansion s’explique par la conjonction de toutes sortes de facteurs. La Révolution industrielle dope la production d’armement, la maîtrise du charbon permet de mettre d’immenses bateaux sur les mers, capables de transporter les grandes masses de soldats ou de migrants générés par la transition démographique. La technologie militaire suit : armes à répétitions, canons toujours plus performants, mitrailleuses… Si on commence à se battre à partir de 1830 en Algérie à armes égales (fusils turcs et français se valent bien) mais à démographie déséquilibrée (la France est bien plus peuplée), il n’en est pas de même des guerres entre Occidentaux. La guerre de Sécession des États-Unis d’Amérique d’abord, la Première Guerre mondiale ensuite ouvrent la voie aux conflits totaux : instrumentalisation des médias ; mobilisation des transports (chemins de fer…), des télécommunications (télégraphe…), des industries et de l’ensemble des forces de travail de la nation, d’un arsenal toujours plus assassin culminant avec des bombardements aériens apocalyptiques… Le tout conduisant à des pertes massives. Encore peut-on relativiser, rappelle Lawrence H. Keeley : il fallait tirer des centaines d’obus et des milliers de balles pour tuer un seul soldat lors de la Première Guerre mondiale, et au Rwanda, en 1994, armés pour l’essentiel de machettes, les génocidaires tueront en trois mois environ 800 000 personnes – à comparer au bilan humain de guerres menées avec des armes à feu, comme au Liban (de 1975-1990, de 150 000 à 250 000 morts) ou en ex-Yougoslavie (de 1991 à 1995, de 150 000 à 250 000 morts).
Après le règne de la bombe atomique, que l’on put croire un temps constituer l’apogée de l’art de tuer, à tel point que l’équilibre de la terreur postulait qu’être détenteur de ladite arme revenait à être à l’abri de la guerre, est venu le temps des guerres asymétriques et des raids de drones. Il est possible, probable, que les robots, téléguidés ou même autonomes, domineront dans nos journaux télévisés les champs de bataille de demain. La guerre se joue d’ores et déjà dans les circuits électroniques, un signal lancé à bon escient suffisant à paralyser les technologies que l’on vendait hier à l’ennemi d’aujourd’hui. Il n’empêche : la meilleure arme du monde ne sert à rien dans un contexte social inadapté. Les troupes de la coalition envoyées en Afghanistan avaient beau être technologiquement très supérieures à leurs adversaires insurgés, les voici qui se retirent sans résultat. La guerre, toujours, se gagne dans les esprits.
Bibliographie
Les faits non sourcés sont issus, pour une part majeure, de l’ouvrage de Geoffrey Parker [1988] et secondairement de celui de William H. McNeill [1982].
PARKER Geoffrey [1988], The Military Revolution. Military innovations and the rise of the West, 1500-1800, Cambridge, Cambridge University Press, trad. fr. Jean Joba, La Révolution militaire, Gallimard, 1993, rééd. coll. Folio / Histoire », 2013.
McNEILL William H. [1982], The Pursuit of Power. Technology, armed forc, and society since A.D. 1000, The University of Chicago Press, trad. fr. Bernadette et Jean Pagès, La Recherche de la puissance. Technique, force armée et société depuis l’an mil, Paris, Économica, 1992.
McNEILL William H. [1963], The Rise of the West. A history of the Human community, London, The University of Chicago Press, 1963, rééd. 1991
STANZIANI Alessandro [2012], Bâtisseurs d’empires. Russie, Chine et Inde à la croisée des mondes, XVe-XIXe siècle, Paris, Raisons d’agir.
KEELEY Lawrence H. [1997], War Before Civilisation. The myth of the peaceful Sauvage, Oxford University Press, trad. fr. Jocelyne de Pass et Jérôme Bodin, Les Guerres préhitoriques, Paris Le Rocher, 2002.
HOLEINDRE Jean-Vincent et TESTOT Laurent, coord. [nov.-déc. 2012], « La guerre. Des origines à nos jours », Auxerre, Hors-série / Grands Dossiers des sciences humaines Histoire, n° 1.